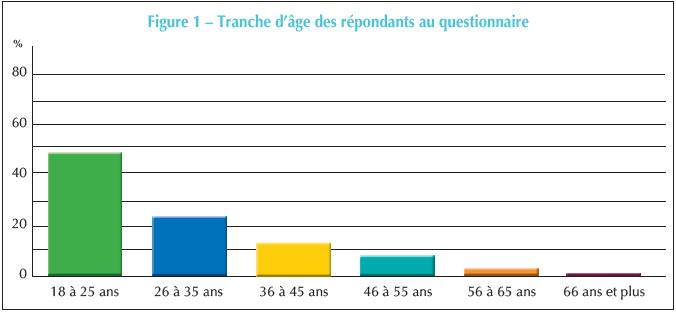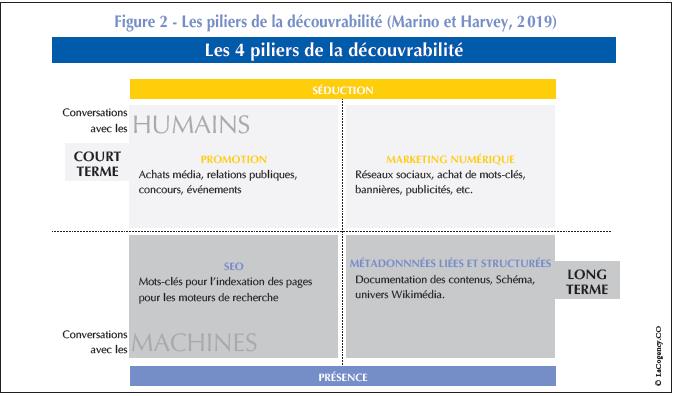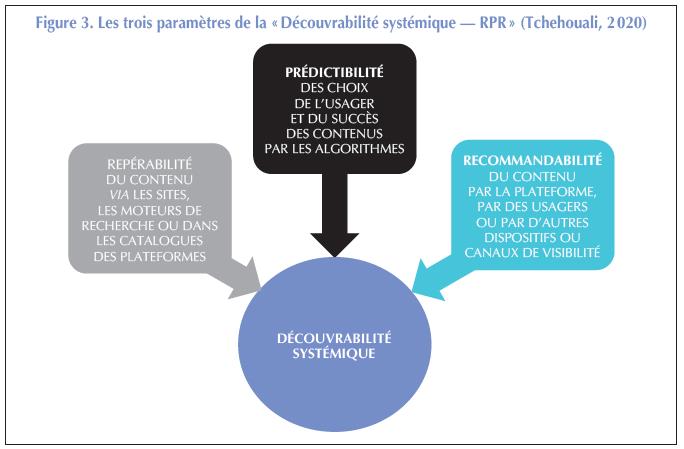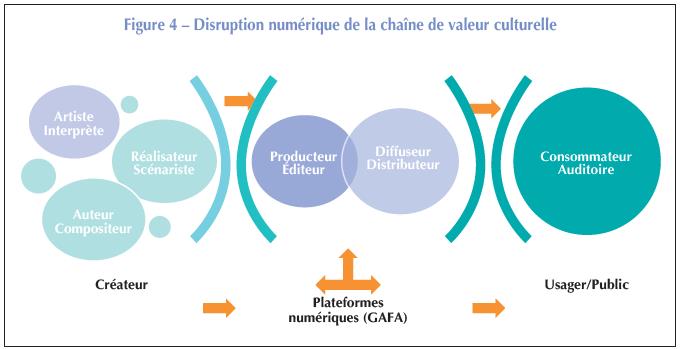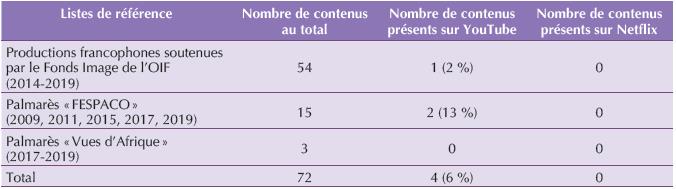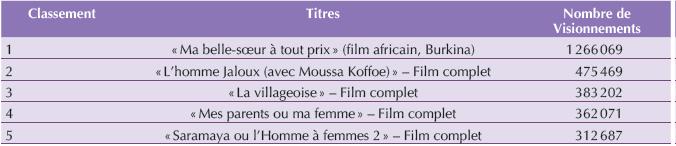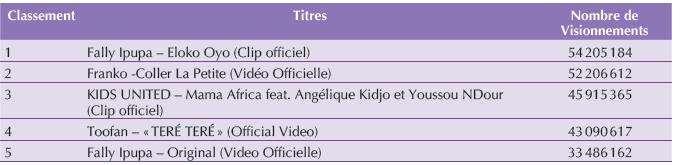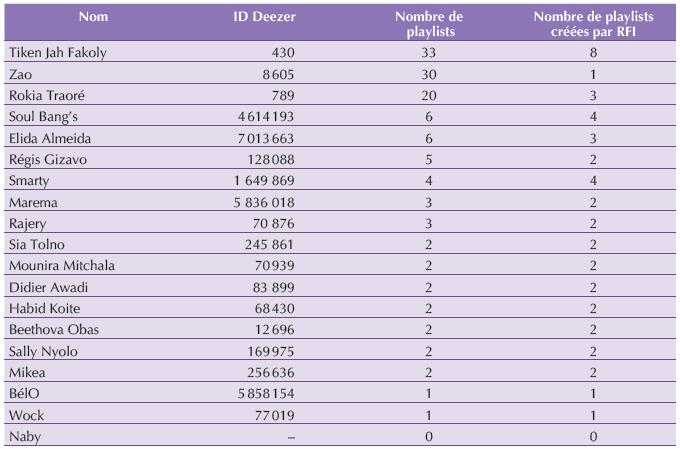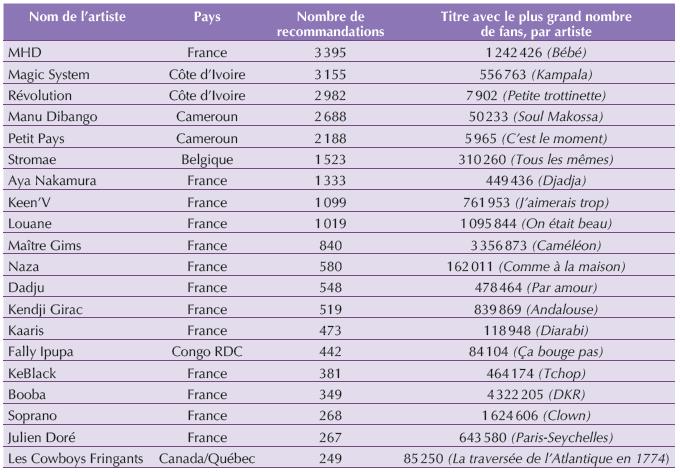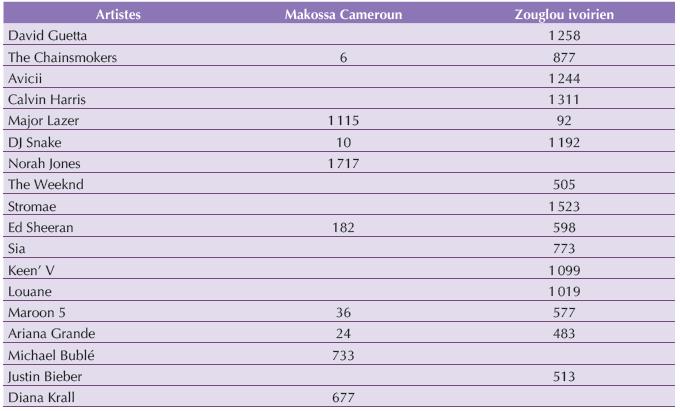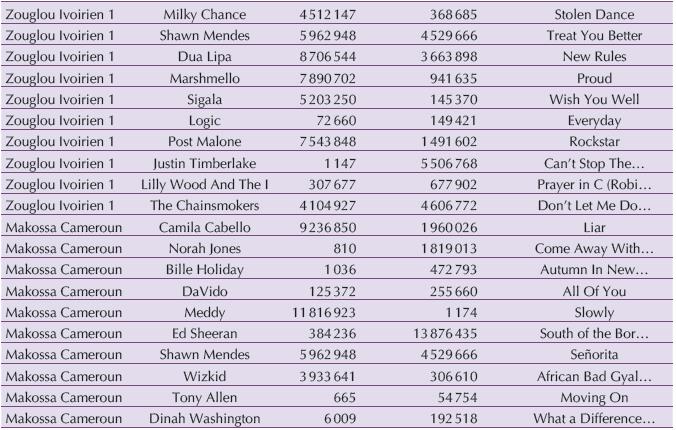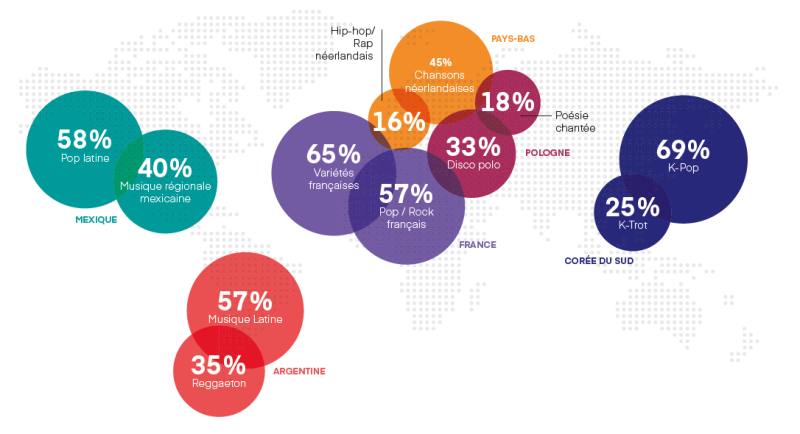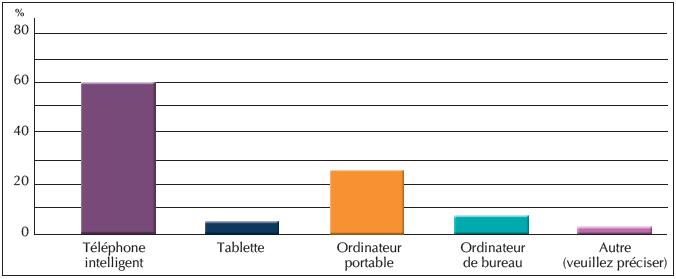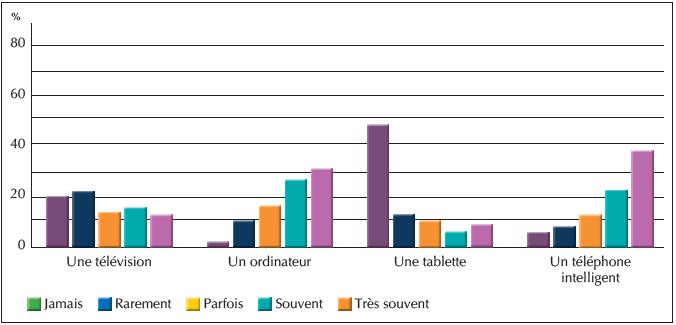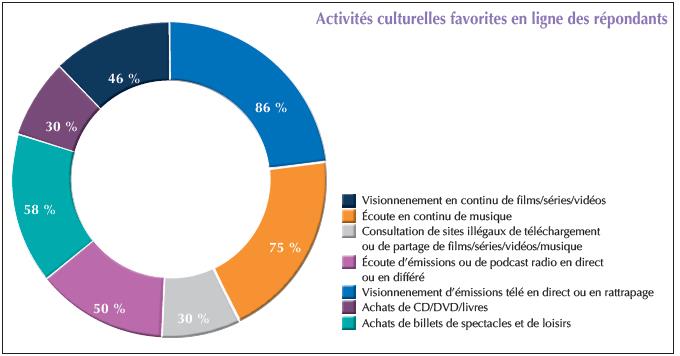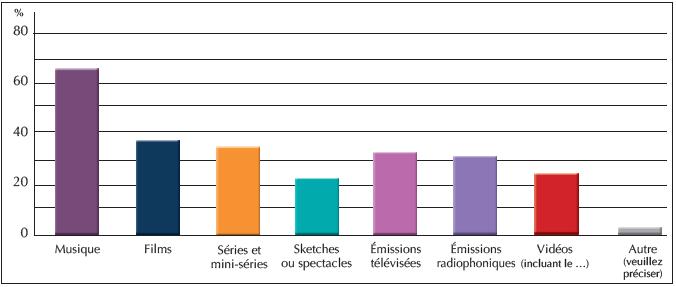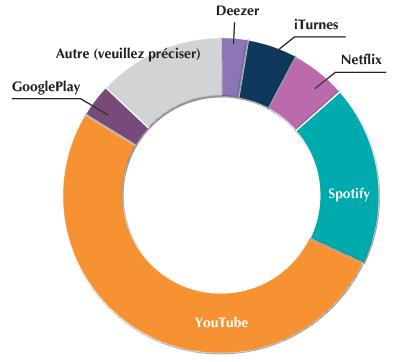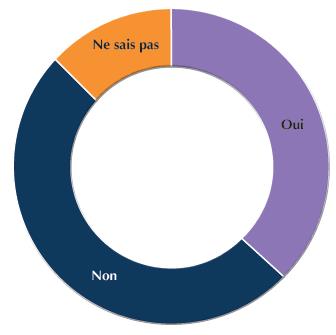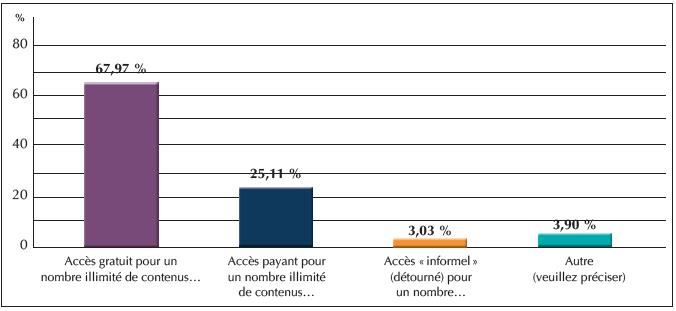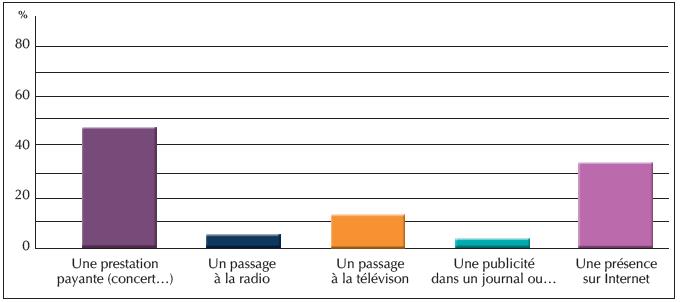Avertissement
Le contenu de cette étude1 ne constitue pas une position officielle de l’Organisation internationale de la Francophonie et n’engage que les auteurs qui ont contribué à son élaboration, chacun gardant la responsabilité de ses propos.
Remerciements
L’Organisation internationale de la Francophonie remercie particulièrement les auteurs qui ont mené et rédigé cette étude avec leur équipe d’étudiants et d’assistants de recherche qui a activement contribué à la revue critique de littérature, à la collecte et la compilation des données d’enquête.
Elle remercie également les experts consultés, les organismes partenaires ainsi que tous les professionnels de la culture, décideurs publics et citoyens des différents pays francophones pour leur témoignage et leur participation aux enquêtes et pour la pertinence de leur contribution qui a permis la réalisation de cette étude.
Préface par Catherine Cano, Administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie
Certes, elles semblent moins visibles et accessibles sur Internet si l’on compare aux plateformes de diffusion et de distribution numériques, notamment anglo-saxonnes, qui dictent aujourd’hui la forme, la nature et la circulation des flux de produits culturels numériques avec leurs algorithmes. Mais ces dernières n’encouragent manifestement pas l’accès à une offre culturelle diversifiée.
L’OIF a très vite pris la mesure de l’impact des technologies de l’information et de la communication (TIC) sur la promotion de la langue française et sur la préservation et la valorisation de la diversité culturelle et linguistique en soutenant la création et la diffusion de contenus francophones numériques.
Mais nous devons faire plus ! Je pense notamment à l’accompagnement de nos États et gouvernements à prendre part à la gouvernance de l’Internet et à mettre en place des politiques culturelles appropriées à l’environnement numérique tout en répondant aux enjeux liés à la fracture numérique.
Le renforcement des compétences des acteurs de la culture dans le domaine du numérique, l’accessibilité et la connectivité, la diffusion, la distribution, la promotion et la consommation des contenus francophones sur Internet sont autant de défis majeurs qui justifient que la Francophonie renforce sa mobilisation et fasse du numérique, une composante essentielle du projet francophone.
À travers ce rapport sur « l’état des lieux de la découvrabilité et de l’accès aux contenus culturels francophones sur internet », l’OIF a noué un partenariat entre 2018 et 2020 avec la Chaire Unesco en communication et technologies pour le développement de l’Université de Québec à Montréal et l’Observatoire des réseaux et interconnexions de la société numérique (ORISON) qui lui est rattaché pour mettre en lumière les enjeux, les défis, les tendances et les pratiques en matière d’accessibilité et de découvrabilité des produits culturels (filières audiovisuelle, cinématographique et musicale) de l’espace francophone.
Bonne lecture !
Avant-propos
La pénétration des technologies numériques dans toutes les sphères de la vie en société, avec ses impacts indéniables sur la création, la diffusion, l’accès et la consommation de produits culturels de différentes nations, redessine progressivement une nouvelle carte culturelle du monde sur laquelle la Francophonie doit se positionner comme défenseur et garante de la promotion et de la découvrabilité d’une riche diversité d’expressions culturelles, notamment dans l’environnement numérique.
En effet, dès ses origines, l’OIF s’est attachée à promouvoir le dialogue et la cohabitation des langues et des cultures de ses territoires en œuvrant à travers un ensemble de programmes et d’actions concrètes qui contribuent à valoriser les identités et les expressions culturelles diversifiées, limitant ainsi les risques d’une uniformisation culturelle à l’échelle globale.
Toujours est-il qu’aujourd’hui, à l’ère du numérique, il reste beaucoup à accomplir au sein de l’espace francophone, au Sud comme au Nord. Il s’agit de garantir que les avancées, les acquis et les aspirations des peuples et des nations en matière de diversité culturelle et linguistique ne soient pas simplement balayés par la déferlante d’une « hyper-culture » globalisante, véhiculée par les nouvelles égéries de la mondialisation culturelle que sont les plateformes transnationales de diffusion et de distribution numérique de contenus/produits culturels.
C’est dans ce contexte que la Direction Langue française et diversité des cultures francophones (DLFDCD) de l’OIF a souhaité, dès 2017, mettre en place des mécanismes afin d’identifier et d’étudier les enjeux et les problématiques permettant de documenter les mutations, les stratégies, les pratiques innovantes et les tendances à l’œuvre au sein de la Francophonie, en matière de diversité culturelle et linguistique.
Cette étude constitue une des premières recherches qui propose une analyse exploratoire des tendances et des pratiques en matière de découvrabilité de contenus culturels francophones dans des régions aussi diverses que l’Afrique, l’Europe et l’Amérique francophones. Son objectif est de nourrir la réflexion de la Francophonie institutionnelle ainsi que celle de tous les acteurs concernés. Elle doit faciliter l’identification des défis à relever, des opportunités à saisir et des stratégies à mettre en œuvre pour accroître la disponibilité, l’accessibilité, la promotion et la visibilité de la diversité des expressions culturelles francophones dans l’environnement numérique.
Les auteurs de cette étude, Destiny Tchéhouali et Christian Agbobli, Professeurs au département de communication sociale et publique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), remercient l’OIF pour le soutien apporté à la réalisation et la publication de cet ouvrage. Ils remercient également toutes les personnes qui ont contribué à la production de ce travail de recherche.
Introduction
Le numérique s’impose aujourd’hui comme un catalyseur de créativité et d’innovation qui offre de nombreuses opportunités à saisir, notamment pour les artistes et les professionnels de la culture de l’espace francophone. Il met au défi les États et gouvernements francophones d’élaborer ou d’adapter leurs politiques culturelles à travers des stratégies, des mesures et des actions concrètes de soutien aux industries culturelles2, de promotion et de protection de la diversité des expressions culturelles au sein de la Francophonie. Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de vision claire, s’appuyant sur des données actualisées, les pouvoirs publics ne peuvent définir des stratégies et des politiques adéquates et efficaces garantes de diversité et de souveraineté culturelles. Cela en particulier devant l’ampleur des transformations numériques et des risques d’uniformisation culturelle que font peser les innovations technologiques disruptives sur les domaines de la culture et de la création au cours deux dernières décennies.
Le nouveau modèle d’impérialisme culturel que tentent d’imposer les géants multinationaux du secteur du Web soulève de nombreuses questions quant à la régulation de ces acteurs qui se sont constitués en oligopole de la découvrabilité, en jouant un rôle central et déterminant dans la manière dont nous découvrons, accédons, et consommons des contenus culturels francophones sur Internet.
Face à cette situation préoccupante, et dans l’attente de l’élaboration de cadres réglementaires plus adaptés aux diffuseurs et distributeurs mondiaux de contenus culturels numériques, cette étude identifie et analyse les pratiques et les stratégies mises en œuvre par les acteurs culturels des pays francophones (artistes et créateurs, producteurs et diffuseurs, utilisateurs et consommateurs) afin d’accroître la diffusion, la distribution et la visibilité de leurs produits et de leurs contenus sur les plateformes numériques.
L’étude répond aux principales questions suivantes :
a) Sur la diffusion, la visibilité, le processus de mise en œuvre de la découvrabilité : quels sont les mécanismes, les processus, les outils et les techniques qui permettent de rendre plus visibles et donc plus facilement découvrables une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou musicale francophone sur Internet ? Quelles sont les plateformes qui favorisent le mieux la diffusion et la découvrabilité des artistes et des œuvres culturelles francophones ?
b) Sur la réception et la circulation des produits et des contenus : par quels canaux ou moyens les utilisateurs accèdent, choisissent et consomment-ils des contenus culturels numériques francophones parmi la multitude de contenus disponibles en ligne ? Les œuvres cinématographiques, audiovisuelles et musicales francophones promues ou primées dans des grands festivals de films ou de musique sont-elles par la suite disponibles, mises en avant et accessibles au grand public en ligne ?
c) Sur les défis, enjeux et opportunités des contenus culturels francophones sur Internet : quels sont les défis que pose la découvrabilité aux acteurs culturels francophones et comment ces acteurs intègrent-ils cet enjeu dans leurs pratiques ? Quelles opportunités ou retombées peuvent-ils tirer de la découvrabilité de leurs œuvres ? Quelles stratégies ou jeu d’alliances faut-il mettre en œuvre pour permettre aux productions culturelles francophones d’être plus visibles et accessibles en ligne, principalement sur les grandes plateformes numériques telles que Netflix, Spotify, iTunes, YouTube, ou encore Amazon ?
d) Sur les États francophones, les décideurs publics et leurs responsabilités : Les décideurs publics et les responsables des politiques culturelles dans les pays francophones sont-ils sensibilisés à l’enjeu de la découvrabilité et quelles mesures ou initiatives ont été prises par les gouvernements de ces pays pour accroître la présence et la visibilité́ de leurs productions culturelles nationales sur les grandes plateformes transnationales ? Quels sont les pays francophones qui soutiennent le mieux la diffusion, la promotion et la découvrabilité de leurs produits culturels sur Internet et quels sont les leviers d’action (institutionnels, réglementaires, industriels) les plus efficaces qu’ils utilisent ?
Cette étude sur l’état des lieux de la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique pose ainsi un diagnostic inédit et actualisé des enjeux et défis ainsi que des tendances et pratiques en matière de diffusion et de distribution, de promotion et de consommation des expressions culturelles francophones en ligne. Elle démontre notamment à quel point les transformations provoquées par le numérique dans les filières audiovisuelle, cinématographique et musicale créent un déséquilibre entre les productions anglo-saxonnes destinées au marché mondial et les productions locales/nationales francophones qui sont moins accessibles, moins visibles, moins promues et recommandées, et donc moins « découvrables ».
C’est un fait que les nouvelles plateformes numériques émergent comme de puissants vecteurs d’intermédiation à l’échelle de la planète et déterminent les contours d’une nouvelle industrie culturelle mondiale qui dicte la forme, la nature et la circulation des flux de produits culturels numériques, surtout dans un contexte de guerre des contenus exclusifs.
I. Problématique et méthodologie
Cette section de l’étude présente la problématique de la découvrabilité des œuvres culturelles francophones dans un contexte de numérisation généralisée de nos sociétés, où les activités de production, de diffusion et de consommation de contenus en ligne atteignent un paroxysme sans précédent. Elle inclut également une recension synthétique et sélective des écrits et des travaux récents sur les effets de l’expansion structurelle des technologies et des plateformes numériques dans les différentes filières des industries culturelles et médiatiques (telles que la musique, le cinéma, l’audiovisuel, l’édition). La croissance exponentielle de la quantité de contenus étrangers/internationaux disponibles et recommandés sur Internet a exacerbé les problèmes d’accessibilité et de visibilité des contenus locaux/nationaux en ligne.
1. Mise en contexte et problématique
En octobre 2012, lors du XIVe Sommet de la Francophonie de Kinshasa, les chefs d’États et de gouvernements ont réaffirmé leur volonté de contribuer à l’édification d’une société de l’information ouverte, inclusive, transparente et démocratique, en adoptant la Stratégie de la Francophonie numérique, intitulée Agir pour la diversité dans la société de l’information3. Cette Stratégie constitue une feuille de route visant, entre autres, à favoriser la diversité culturelle et linguistique et l’intégration de la Francophonie dans l’économie numérique4 à l’horizon 2020.
Parmi les quatre axes stratégiques d’intervention identifiés, deux constituent des socles à la réflexion développée dans le cadre de la présente étude : l’axe 3 « Développer l’intelligence numérique au service de la diversité et du partage » et l’axe 4 « Produire, diffuser et protéger les biens communs numériques », notamment les contenus francophones (français et langues nationales) et les nouveaux modes d'expression numériques.
Cette Stratégie numérique intervient dans un nouveau contexte où les enjeux géoculturels liés à la présence de contenus diversifiés en ligne deviennent un facteur déterminant dans la profonde transformation que subissent les industries culturelles à l’ère du numérique. L’OIF a très tôt pris conscience de la nécessité de mobiliser les potentialités offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC) afin de les mettre au service de la promotion de la langue française, de la préservation et de la valorisation de la diversité culturelle et linguistique, en donnant notamment la priorité à la création et à la diffusion de contenus francophones numériques, avec un accent sur les contenus locaux et nationaux contextualisés.
Aujourd’hui, les créateurs et artistes francophones disposent de multiples possibilités pour jouir d’une diversité d’exposition de leurs œuvres dans l’environnement numérique. De même, les usagers et consommateurs francophones n’ont jamais été autant exposés à une hyper-offre de contenus culturels numériques à regarder, écouter ou lire via Internet. Pourtant, il n’en demeure pas moins que la découvrabilité de l’offre culturelle francophone en ligne reste problématique face à l’explosion et à la forte concurrence de l’offre internationale.
S’il est donc plus simple pour les créateurs, les producteurs ou les éditeurs francophones de produire ou de diffuser aujourd’hui des films, des morceaux de musique ou des livres à l’ère du numérique, le véritable défi, une fois les œuvres mises en ligne, consiste plutôt à faire en sorte qu’elles attirent l’attention nécessaire afin de rencontrer leurs publics, malgré le fait que ceux-ci soient submergés par un hyperchoix. La menace, pour l’offre culturelle francophone, est de se retrouver totalement noyée dans la surabondance de contenus internationaux, sachant que les contenus recommandés ou mis en valeur sur les catalogues ou les pages d’accueil des plateformes mondialisées telles que Netflix, YouTube, Spotify ou Amazon, ne sont pas aussi diversifiés qu’ils tentent de le faire croire à leurs usagers et abonnés.
La principale hypothèse de cette étude est que la concentration, la standardisation et la mise en marché de l’offre culturelle globale obéissent avant tout à un processus organisationnel structurant, avec des logiques éditoriales et des prescriptions algorithmiques qui s’appuient sur la pérennité des modèles d’affaires et des intérêts mercantiles. Cette démarche ne cherche pas à intégrer des critères ou des paramètres spécifiquement favorables à l’accès et à la découverte d’une diversité d’expressions culturelles en situation de minorité sur le Web, comme les contenus francophones.
Désormais, la découvrabilité des contenus francophones sur Internet constitue un défi majeur et une condition préalable pour l’accès et la consommation d’une offre culturelle diversifiée. Alors que la prolifération des plateformes numériques aurait pu constituer un véritable atout pour la découvrabilité et l’accès en ligne à la production culturelle francophone dans des filières des industries culturelles telles que la musique, l’audiovisuel, le cinéma ou le livre, des tendances récentes semblent plutôt indiquer le contraire.
L’Observatoire de la langue française5 mentionne, dans son dernier Rapport 2015-2018, que le français, toutes applications confondues, est la quatrième langue de l'Internet (6,8 %), derrière respectivement l'anglais (27,36 %), le chinois (10,41 %) et l'espagnol (9,83 %)6. Cependant, d’après l’organisation W3Techs qui réalise des études sur les technologies du Web, si l’on considère les 10 millions des principaux sites web les plus visités au monde, seulement 2,7 % de ces sites proposent des contenus en langue française (7e rang pour le français), comparativement à 59,5 % de sites web en anglais (1er), 8,6 % en russe (2e) et 4 % en espagnol (3e)7.
Ces données montrent que pour assurer la présence effective et le rayonnement du français en ligne, il importe que les pays francophones (surtout ceux en développement) se dotent des moyens pour accroître la production et la diffusion des contenus et des créations francophones numériques, susceptibles de se démarquer par leur grande qualité et leur pertinence, de telle sorte à pouvoir être recommandés et découvrables dans la multitude de contenus disponibles sur Internet.
2. Méthodologie de l’étude
L’approche méthodologique adoptée dans cette étude s’appuie sur l’utilisation, de façon complémentaire, de plusieurs outils et méthodes de collecte de données. Il s’agit d’une approche mixte, associant les éléments d’une démarche à la fois qualitative et quantitative pour saisir toute la complexité de la réalité couverte par notre objet d’étude, soit les enjeux, les défis, les opportunités et les pratiques en matière de découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique. La méthodologie mixte est la plus appropriée afin de réaliser une collecte de données qui puisse être la plus instructive possible compte tenu de la nature exploratoire et multidimensionnelle des objectifs et des questions de recherche relatifs à la découvrabilité.
Les méthodes quantitatives sont nécessaires, d’une part pour mesurer la présence des contenus culturels francophones sur les plateformes étudiées, et d’autre part pour recueillir des métriques nécessaires pour quantifier l’efficacité et la précision des systèmes de recommandation algorithmique, à partir de l’analyse des interactions entre les éléments recommandés par la plateforme et les profils d’utilisateurs-consommateurs de contenus culturels francophones. Les méthodes qualitatives permettent, quant à elles, de cerner le problème de découvrabilité dans sa totalité, en tenant compte de ses implications économiques, culturelles, technologiques et juridiques, en lien avec le contexte des pays francophones.
Le périmètre couvert par l’étude se circonscrit davantage aux pays du Sud membres de la Francophonie, en particulier les pays d’Afrique subsaharienne comme le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo. Cependant, l’étude rend également compte de quelques tendances, pratiques, mesures et politiques innovantes dans des pays francophones du Nord, comme le Canada/Québec, la France et la Belgique/Wallonie, ayant démontré des avancées notables en matière de découvrabilité en ligne de contenus nationaux, dont peuvent s’inspirer d’autres pays en développement.
L’étude s’appuie sur quatre modes de collecte de données : 1) une veille et recherche documentaire ; 2) le forage de données à partir de l’observation de plateformes ciblées ; 3) un questionnaire administré par voie électronique ; 4) des entrevues individuelles semi-directives ciblées en face-à face.
Le processus de collecte s’est déroulé en deux phases. Dans un premier temps, nous avons procédé à un enchaînement séquentiel de type exploratoire avec la réalisation de la veille et de la recherche documentaire qui a débouché sur une revue de littérature et une nécessaire synthèse des connaissances et savoirs produits sur le sujet de la découvrabilité. Dans un deuxième temps, nous avons privilégié une démarche inductive et explicative, en partant du forage de données quantitatives sur les plateformes.
Les données qualitatives du questionnaire électronique et des entrevues individuelles ont permis d’expliciter les observations et les faits particuliers mis en exergue par les données quantifiant la présence des contenus culturels francophones et la précision des algorithmes de recommandation sur les plateformes étudiées. Ceci a particulièrement été utile pour l’identification et l’analyse des facteurs déterminants ou explicatifs des conditions de réception des œuvres francophones tels que révélés par les résultats de l’enquête sur les habitudes de consommation culturelle des internautes dans les pays francophones.
2.1. Veille et recherche documentaire
La veille et la recherche documentaire ont donné lieu à une revue critique de littérature constituant une synthèse analytique des connaissances actualisées sur la question de la découvrabilité. Les enjeux et les phénomènes étudiés sont spécifiés aux pays en développement francophones, qui ont un besoin plus accru que les autres de promouvoir et de rendre visibles leurs expressions culturelles numériques.
En nous appuyant sur une littérature grise et une littérature scientifique, nous avons mobilisé un riche corpus de données préexistantes sur les caractéristiques et l’évolution des industries culturelles francophones et sur les effets du numérique (technologies, plateformes, usages) sur l’accès à la culture dans les pays francophones. Il s’agit d’un véritable inventaire constitué de rapports et documents officiels relativement récents tels que : les profils culturels des pays du Sud, membres de la Francophonie ; le rapport mondial 2018 Repenser les politiques culturelles ; le rapport sur l’état des lieux de la Francophonie numérique ; le panorama de la consommation de la musique dans le monde en 2019, etc. Ces rapports de référence sont complétés par : une sélection variée de travaux de recherche sur le cadre conceptuel et théorique de la découvrabilité, sur la base d’une bibliographie pertinente et actualisée ; des études diverses, de portée internationale et nationale ; différents documents de politiques, de planification stratégique dans les domaines de la culture, de la créativité, et de l’innovation numérique dans l’espace francophone.
La synthèse des connaissances réalisée à partir de cette vaste recherche documentaire permet d’appréhender, de manière contextualisée, la réalité globale dans laquelle ont lieux les tendances et dynamiques en matière de découvrabilité sur Internet des produits culturels nationaux et locaux des pays francophones. Elle donne également lieu à des analyses et des explications sur le savoir ainsi produit, dans le but de mieux orienter et de justifier les actions à venir et les mesures adéquates à prendre par les différentes parties prenantes.
2.2. Forage de données sur des plateformes ciblées
Une série d’opérations de moissonnage de données quantitatives a été réalisée sur cinq plateformes (YouTube et Netflix au niveau de l’audiovisuel et Deezer, iTunes/Apple Music et Spotify au niveau de la musique). Il s’est agi de collecter des données sur la disponibilité (présence et accessibilité des contenus sur le catalogue) et la mise en valeur (visibilité, promotion et valorisation des contenus sur le catalogue) d’artistes et de produits culturels francophones (essentiellement films et musique), à travers une combinaison de méthodes manuelles et automatisées de requêtes et d’interrogation de catalogues (par mots-clés, noms d’artistes, titres de films ou de chansons, pays d’origine).
La plupart des prises ou captures de données ont été effectuées durant les mois d’avril, de mai et de juin 2019, sauf pour les plateformes YouTube8 et Deezer où des opérations de collecte se sont poursuivies sur une période prolongée jusqu’en février 2020, pour des raisons de validation méthodologique de certains types de données requérant une observation longitudinale.
En ce qui concerne les données liées aux contenus audiovisuels et cinématographiques, trois listes de référence ont été utilisées :
-
Liste des productions francophones du Sud (Cinéma/Fiction) du Fonds Image9 de l’OIF, sur la période 2014-2019.
-
Palmarès du Festival international du Cinéma « Vues d’Afrique », sur la période 2017-2019.
-
Liste des films lauréats du Palmarès officiel du Festival panafricain du Cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO), sur la période 2009-2019.
Quant aux contenus musicaux, les listes de références considérées pour le forage de données sont les suivantes :
-
Liste des artistes lauréats francophones des « Prix Découvertes »10 de Radio France International (RFI), sur la période 1981-2017.
-
Liste des lauréats francophones des « Syli d’or »11 de la musique du monde, sur la période 2007-2018.
-
Liste des lauréats des Prix Kora de la musique en 2012.
Nous avons fait le choix d’un échantillonnage ciblé (et non aléatoire) puisque le caractère exploratoire de l’étude ne nous soumet pas à l’exigence d’une exhaustivité ou d’une représentativité « acceptable » de l’ensemble des contenus francophones disponibles et accessibles sur les plateformes numériques. D’autant plus qu’il existe des limites méthodologiques pour définir de manière consensuelle l’origine ou la nationalité d’une œuvre, surtout d’un point de vue des réalités de chaque filière culturelle des industries culturelles. L’option d’un échantillonnage par choix raisonné nous a, en revanche, permis de mobiliser quelques indicateurs quantitatifs ayant généré des données utiles et valides, pour dresser un portrait (certes sommaire et fragmenté, mais réaliste) de la présence des produits culturels francophones sur les plateformes internationales. Celui-ci met en exergue les nuances et spécificités relatives à la découvrabilité en fonction de certains types, genres ou formats de produits ainsi que des observations relevant plus des spécificités liées à la consommation de produits culturels numériques dans certaines régions géographiques, au sein même de l’espace francophone. Pour affiner nos analyses, les opérations de moissonnage de données et de caractérisation de l’offre de produits culturels francophones disponibles sur les plateformes numériques ont été croisées avec les données qualitatives collectées via les questionnaires électroniques et les entrevues.
2.3. Questionnaire électronique
Un questionnaire électronique12 conçu, à l’aide de l’outil Survey Monkey, a été diffusé en ligne d’octobre 2019 à mars 2020 et relayé via les réseaux de l’OIF et d’autres organismes culturels de la Francophonie. Il s’adressait à un panel d’utilisateurs d’Internet (âgés entre 18 et 75 ans) des pays membres de la Francophonie et visait à recueillir des données sur leurs habitudes de consommation en ligne ainsi que leurs modes d’accès et de découverte de films, de séries, d’émissions télévisées, de vidéos et de musique sur Internet. Le questionnaire a recueilli 231 réponses de la part de répondants, dont 60 % de femmes, 40 % d’hommes, 50 % de 18 à 25 ans et 23 % de 26 à 35 ans).
Les répondants proviennent de 20 pays de la Francophonie (Belgique/Wallonie, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Canada/Québec, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, France (incluant la Martinique et la Réunion), Haïti, Guinée, Liban, Mali, Maroc, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Suisse, Togo, Tunisie).
Figure 1 – Tranche d’âge des répondants au questionnaire
2.4. Entrevues semi-directives
Des entrevues individuelles semi-dirigées ont été réalisées auprès de 30 artistes et professionnels de la culture dans cinq pays-témoins (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Canada/Québec, Togo), de septembre à décembre 2019. Il s’agit essentiellement de travailleurs culturels, notamment des : artistes-interprètes, des auteurs-compositeurs, des acteurs, des humoristes, des agents d’artistes, de managers et de promoteurs, des réalisateurs-producteurs et des distributeurs. Chaque entrevue, d’une durée minimum de 45 à 60 minutes, a été réalisée en respectant une grille d’entretiens13, préalablement élaborée. Les questions posées visaient à recueillir des données sur les parcours personnels, les expériences de pratiques et d’utilisation d’Internet et des outils numériques dans le cadre des activités professionnelles, les défis et obstacles liés à la découvrabilité des contenus culturels francophones sur Internet ainsi que des propositions pour surmonter ces défis.
La collecte de données s’est effectuée auprès de deux populations, l’une cible (les artistes et les créateurs) confrontée directement à la promotion et à la découvrabilité de leurs œuvres et l’autre dite témoin, constituée des intermédiaires traditionnels (les producteurs, les éditeurs, les diffuseurs et les distributeurs) de la chaîne de valeur culturelle dont les pratiques sont profondément affectées par les mutations numériques des écosystèmes culturels locaux et nationaux.
II. Revue de littérature et état des connaissances
Cette revue de littérature présente une recension sommaire des travaux et des connaissances sur la découvrabilité, en s’appuyant sur la littérature scientifique et la littérature grise qui permettent de documenter les tendances et les dynamiques à l’œuvre dans ce domaine.
La problématique de la découvrabilité y est étudiée à partir de quatre enjeux qui nous semblent les plus significatifs pour justifier de la nécessité pour l’OIF de devenir actrice de sensibilisation et de plaidoyer, mais également force de propositions pour l’expérimentation et la mise en œuvre d’actions concrètes et innovantes en la matière, et ce conformément aux objectifs de sa nouvelle programmation14 2019-2022 dont l’une des composantes vise à valoriser l’usage et l’influence de la langue française dans un contexte de diversité linguistique et culturelle.
Les quatre principaux enjeux identifiés sont les suivants :
1) l’analyse conceptuelle de la découvrabilité ; 2) la découvrabilité comme levier pour la promotion de la diversité des expressions culturelles francophones ; 3) la transformation numérique des industries culturelles et son impact sur la chaîne de valeur culturelle ; 4) la découvrabilité et la juste rémunération des créateurs francophones face au défi du piratage et de la gratuité d’accès à la culture en ligne.
1. La découvrabilité : analyse d’un concept polysémique
La découvrabilité est un concept polysémique dont l’usage peut susciter quelques ambiguïtés et confusions qui justifient un besoin d’éclaircissement et de définition afin de maximiser sa compréhension de manière contextualisée. C’est la raison pour laquelle il importe d’abord de circonscrire ce nouvel objet d’étude multidimensionnel aux significations qu’il recouvre, à travers ses différentes utilisations dans les domaines de la culture et du numérique et au croisement interdisciplinaire des sciences de l’information et de la communication (SIC), et de l’informatique.
Dans une acception purement appliquée aux Systèmes d’Information (SI) et aux interfaces des applications Web, la notion de « découvrabilité » renvoie à la capacité d’un site Web à aider un utilisateur à trouver l’information qu’il cherche. Cette approche de définition très générique et simpliste trouve ses fondements dans les travaux15 de Peter Morville, pionnier de l’architecture de l’information, qui a développé une théorie sur la trouvabilité ou repérabilité (en anglais, findability) de contenus sur le Web.
Peter Morville distinguait deux dimensions à cette qualité indispensable pour tout contenu informationnel publié en ligne : d’une part la trouvabilité interne qui consiste dans la capacité du contenu recherché à être repérable au sein même de l’interface explorée par l’utilisateur (par exemple dans le catalogue d’une plateforme ou sur l’interface d’accueil d’une application ou service Web) ; et d’autre part la trouvabilité externe liée à la capacité du contenu à être repérable par des moteurs de recherche, grâce à des balises sémantiques, des mots-clés et des métadonnées qui permettent de répertorier, d’indexer, de situer ou de (géo)localiser et de trouver le contenu partout où il est disponible en ligne. Ce paradigme de la découvrabilité est celui auquel on associe les stratégies et techniques d’optimisation (SEO ou Search Engine Optimization, en anglais) pratiquées par les professionnels du référencement, dont le métier consiste à favoriser le bon positionnement des pages, sites ou applications Web dans les résultats des moteurs de recherche.
Cependant, penser la découvrabilité dans cette unique perspective de repérabilité ou de trouvabilité des contenus en ligne peut être assez réducteur puisque la découvrabilité ne se limite pas à cette seule facette. En effet, bien qu’il y ait encore peu de tentatives de conceptualisation de la notion même de découvrabilité, les textes s’y référant au niveau de la littérature commencent à se multiplier.
La littérature anglo-saxonne fait par exemple état de plusieurs travaux16 qui se focalisent sur la découvrabilité des applications mobiles (Application Discoverability) dans des magasins ou boutiques d’applications en ligne (App Store17), à des fins d’amélioration de l’expérience-utilisateur. En 2013, trois chercheurs de l’université d’Oulu en Finlande (Simo Hosio, Jorge Goncalves et Vassilis Kostako) ont ainsi publié un article18 dont l’apport est particulièrement riche pour la compréhension des mécanismes de découvrabilité (Discoverability) à partir d’une série de mesures et d’analyses des parcours de navigation et des comportements des utilisateurs d’applications accessibles via un dispositif d’écrans (ou vitrines) d’affichage public polyvalents. Les chercheurs se sont notamment intéressés à établir des corrélations entre le succès d’une application et les facteurs qui permettent à l’application d’être facilement découverte et téléchargée par l’utilisateur, celui-ci étant exposé à une grande variété d’applications stockées au même endroit et accessible sur le même écran de terminal. Cette recherche met en exergue le fait que la découvrabilité joue un rôle déterminant dans l’augmentation du taux d’adoption et de l’utilité relative19 d’une application selon la visibilité et l’exposition dont jouit l’application dans l’ensemble de l’interface de la boutique ou du magasin d’applications.
Ce n’est qu’à partir de mai 2016, à l’occasion du Sommet de la découvrabilité20 organisé conjointement par le Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et l’Office National du Film (ONF) du Canada, que le concept de découvrabilité a commencé à être vulgarisé auprès du grand public, voyant son usage progressivement se généraliser avec une forte connotation liée à l’accès aux contenus culturels (surtout audiovisuels) dans une ère d’abondance de contenus.
Différentes parties prenantes de l’écosystème culturel canadien ont alors pris part à cette conversation initiée à l’échelle nationale dans le but de développer des stratégies et des mesures visant à améliorer la découverte des émissions et des contenus canadiens, en particulier dans l’environnement numérique.
La même année, l’Office québécois de la langue française (OQLF) a proposé une première définition de la « découvrabilité », à travers une fiche terminologique qui lui est dédiée. La découvrabilité y est décrite comme le « potentiel pour un contenu, un produit ou un service de capter l'attention d'un internaute de manière à lui faire découvrir des contenus autres21 ». Cette définition s’accompagne d’une note précisant que : « L'emploi, notamment de métadonnées, d'algorithmes de recherche, de mots-clés, d'index, de catalogues augmente la découvrabilité d'un contenu, d'un produit ou d'un service22 ».
Les efforts de définition se sont poursuivis grâce à une série d’initiatives d’études et de recherche dont l’objectif était de développer une compréhension commune du concept de la découvrabilité pour tous les acteurs de la filière audiovisuelle et des autres filières des industries culturelles et créatives canadiennes. C’est dans ce contexte qu’une étude, commandée par le Fonds des Médias du Canada (FMC) et réalisée par Danielle Desjardins, a permis d’établir un cadre de référence commun23. Ce dernier classe les différentes notions associées à la découvrabilité selon différents types de leviers24 pouvant être mobilisés au service des acteurs concernés par la découvrabilité, soit les acteurs25 de l’industrie des contenus et les publics en quête des contenus répondant à leurs nouvelles habitudes de consommation culturelle et médiatique.
Deux principaux leviers de la découvrabilité ont été identifiés : 1) les leviers institutionnels (politiques culturelles, réglementation et mesures de financement ; et 2) les leviers industriels (données d’usage, algorithmes, moteurs de recherche, systèmes de recommandations, outils marketing, etc.). Le cadre de référence commun proposé par Danielle Desjardins met en évidence la place centrale du public ou du consommateur, celui-ci étant considéré comme « la finalité de toute initiative de découvrabilité »26. L’auteure inscrit également, à juste titre, la notion de découvrabilité dans un « continuum à trois facettes »27, à savoir : la découverte (l’exposition du consommateur à l’existence du contenu) ; le choix (le fait pour le consommateur de décider d’accorder son attention et son intérêt à tel contenu plutôt qu’à un autre, sachant que cette décision peut être influencée par le contexte ainsi que par les outils et les dispositifs qui guident le consommateur et qui l’aident à repérer des contenus pertinents dans l’offre abondante à laquelle il est exposé) ; et enfin l’accès (le fait d’accéder et de pouvoir consommer le contenu de son choix, de façon simple et conviviale, au moment où on le souhaite).
Une autre étude, réalisée en 2017 par l’Observatoire de la culture et des communications du Québec (OCCQ), et portant sur « L’état des lieux des métadonnées relatives aux contenus culturels » propose une définition de la découvrabilité qui met l’emphase sur l’importance que des contenus puissent émerger spontanément lors d’une recherche sur le Web, même si ces contenus ne correspondent pas très précisément à l’objet de notre recherche initiale. L’OCCQ définit ainsi la découvrabilité comme la « Capacité, pour un contenu culturel, à se laisser découvrir aisément par le consommateur qui le cherche et à se faire proposer au consommateur qui n’en connaissait pas l’existence28 ». L’étude de l’OCCQ met en exergue l’obligation de penser la relation entre une œuvre culturelle et sa découvrabilité par le fait-même des métadonnées qui enrichissent la description de l’œuvre et lui assurent une meilleure repérabilité et visibilité sur le Web grâce notamment à des associations avec d’autres données liées du web sémantique, qui renvoient toutes à la même ressource. Ceci expliquerait par exemple les difficultés associées à la découvrabilité des œuvres et produits culturels francophones dans un univers numérique où les contenus culturels de langue anglaise occupent une place prépondérante. Les métadonnées liées et structurées ne constituent cependant que l’un des quatre piliers de la découvrabilité selon Véronique Marino et Andrée Harvey29 ; les autres piliers étant l’optimisation pour moteurs de recherche ou Search Engine Optimization (SEO), la promotion et le marketing numérique.
Figure 2 - Les piliers de la découvrabilité (Marino & Harvey, 2019)
Comme on peut le constater, la nature polysémique de la notion de découvrabilité rend difficile l’entreprise d’une définition unique et stabilisée.
Toutefois, dans le cadre d’un document de réflexion stratégique préparé en mars 2020 pour le compte du Ministère du Patrimoine canadien, Destiny Tchéhouali propose une nouvelle approche conceptuelle qui articule de manière systémique les différentes facettes de la découvrabilité sans pour autant prétendre à une définition formalisée et explicite de la notion. Pour ce chercheur, la découvrabilité numérique (se focalisant sur les plateformes numériques) intègre trois paramètres fondamentaux (« RPR »), qui permettent de l’envisager comme un processus systémique conduisant le consommateur à la découverte du contenu dans le catalogue. Il s’agit de : 1) la Repérabilité (capacité intrinsèque du contenu à être facilement repérable et trouvable en ligne) ; 2) la Prédictibilité30 (capacité du contenu à figurer parmi les résultats des analyses prédictives des algorithmes qui qualifient, de manière anticipée et sur la base d’un ensemble de variables, l’utilité, la valeur, le succès ou la popularité qu’aura une œuvre auprès du public, comparativement à d’autres contenus du même catalogue) ; 3) la Recommandabilité31 (capacité du contenu à se faire recommander de manière récurrente par la plateforme ou par des usagers et des consommateurs ou par d’autres dispositifs et systèmes ou terminaux qui hiérarchisent systématiquement les niveaux de visibilité et de mise en valeur, en lien avec la pertinence du contenu et l’objectif de satisfaction des usagers).
Figure 3 – Les trois paramètres de la « Découvrabilité systémique – RPR » (Tchéhouali, 2020)
2. La découvrabilité, un levier pour l’accès et la promotion de la diversité des expressions culturelles francophones dans l’environnement numérique
Les avancées relatives aux technologies numériques et au développement de la société globalisée de l’information au cours des dernières années ont entraîné de nombreuses préoccupations sur la manière dont les individus ou groupes d’individus découvrent et accèdent par des moyens numériques à une diversité d’expressions culturelles. La question de l’accès et de la consommation d’une diversité de contenus culturels dans l’environnement numérique offre donc un cadre d’analyse et d’interprétation assez pertinent pour la compréhension, dans la durée, des processus et mécanismes de découvrabilité.
Il importe d’abord de rappeler qu’à ce jour, la Convention de l’UNESCO sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles, adoptée à Paris en octobre 2005 et ratifiée par 193 États membres de l’UNESCO, constitue le seul instrument de référence dans l’ordre juridique international qui soit porteur d’un consensus international sur le droit souverain des États à élaborer des politiques et à prendre des mesures pour promouvoir et protéger la diversité de leurs expressions culturelles nationales, en créant un environnement favorable à l’expression de la créativité de leurs peuples. La Convention de 2005 reconnaît la double nature économique et culturelle des œuvres artistiques et considère de facto qu’elles ne doivent pas être traitées comme des marchandises ayant exclusivement une valeur commerciale puisqu’elles sont aussi l’expression de l’identité et de la diversité créative des peuples. Pourtant, les grandes plateformes numériques accordent souvent peu d’intérêt à la présence et l’accessibilité d’œuvres culturelles nationales et locales francophones sur leur catalogue, juste en estimant que ces œuvres ont une valeur marchande insuffisamment attractive. En 2005, les différentes parties prenantes qui ont contribué à l’élaboration d’un solide corpus de principes fondamentaux de la Convention, étaient unanimes autour du constat suivant : « les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres »32.
Aujourd’hui, ce constat est toujours valable puisque le déséquilibre des échanges de biens et de services culturels s’accentue à l’échelle transnationale, en particulier dans l’environnement numérique33.
En effet, cet environnement est de plus en plus contrôlé par les nouveaux diffuseurs et distributeurs mondiaux de produits culturels qui s’imposent comme l’oligopole de la découvrabilité et dont les activités, les modèles d’affaires et les algorithmes ne favorisent pas de manière équitable ni diversifiée, l’accès des artistes nationaux et locaux (surtout ceux n’ayant pas une grande notoriété) et de leurs œuvres à un large public, sur les marchés internationaux de la culture. Nombreux sont les auteurs dont les travaux étudient et rapportent ces phénomènes de concentration de l’offre culturelle numérique globale qui entraîne un manque de diversité dans l’accès et la consommation des contenus culturels à l’ère des plateformes numériques. Ce serait d’ailleurs une gageure, difficilement tenable, de les recenser de manière exhaustive dans le cadre de la présente étude.
Néanmoins, il est utile de faire référence à quelques travaux récents qui se sont évertués à mettre en lumière l’articulation des liens entre la notion de découvrabilité et celle de diversité, sans s’attarder sur les préoccupations récurrentes en lien avec les obstacles conceptuels et méthodologiques de mesure de la diversité culturelle en ligne34. Plusieurs documents35 de réflexion sur les enjeux liés à la diversité des contenus ont été produits récemment dans le cadre de la stratégie de mobilisation internationale du Ministère du Patrimoine canadien sur la diversité des contenus à l’ère numérique.
Prenons l’exemple du rapport de recherche intitulé Diversité de contenus à l’ère numérique : Découvrabilité de contenu diversifié aux échelons local, régional et national36, rédigé par Philip Napoli. L’auteur y développe les trois composantes interdépendantes qu’il associe au principe de la diversité. Il distingue ainsi : la diversité des sources ; la diversité des types et des genres de contenus ; la diversité de l’exposition. Si la diversité des sources se mesure à travers la diversification des fournisseurs de contenus et si cette diversité de sources peut être garante d’une diversité de contenus (« selon la logique que différents types de sources diffèrent probablement, en ce qui a trait aux types de contenu qu’ils produisent »37), alors on peut déjà déduire de ce postulat que l’un des problèmes de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne est lié à la faible diversité de sources puisqu’il n’existe pas – du moins pour le moment – de plateformes à vocation transnationale offrant des services de diffusion et de distribution de contenus culturels exclusivement ou spécifiquement francophones. La grande majorité des contenus culturels francophones disponibles en ligne ne sont accessibles que via une poignée de plateformes. Celles-ci sont pour la plupart détenues par des entreprises ou des propriétaires situés hors de l’espace linguistique francophone et qui n’ont pas de sensibilité particulière qui justifierait leur engagement dans la promotion de valeurs véhiculées par les expressions culturelles et la créativité francophones. En effet, à la fin de l’année 2018, plus d’un milliard de personnes dans le monde vivaient dans un foyer abonné à un service généraliste de vidéo à la demande par abonnement comme Netflix ou Amazon Prime. Deux fois plus encore avaient déjà regardé une vidéo sur YouTube.38 Comme le suggère Luis Albonorz, la véritable interrogation ici est de chercher à savoir : « […] dans quelle mesure les catalogues proposés (par ces plateformes) reflètent-ils la diversité des expressions culturelles de tout le monde ? Est-il logique d’imposer un système de quotas de contenus pour avantager la production nationale indépendante ? Comment faire en sorte que la politique long tail […] ne soit pas, en pratique, une « longue traîne » invisible en raison du manque de visibilité des expressions culturelles minoritaires ? Répondre à ces questions n’est pas une tâche aisée et tout semble indiquer qu’il faudra, pour trouver les réponses satisfaisantes, affronter un processus d’apprentissage essai-erreur »39.
Par ailleurs, la diversité d’exposition des auditoires à une grande quantité de contenus sur les plateformes transnationales n’induit pas systématiquement qu’ils peuvent accéder et consommer une diversité de contenus nationaux, régionaux ou locaux. Il existe des phénomènes tels que les bulles de filtre40 qui font en sorte que, malgré la diversité d’exposition, les systèmes de recommandation tendent à enfermer l’utilisateur dans ses préférences de consommation culturelle déjà établies, sans chercher à susciter davantage sa curiosité ou à élargir ses horizons en lui faisant découvrir des contenus autres que ceux qu’il a l’habitude d’apprécier ou de consommer. Comme le souligne bien Napoli dans son analyse41, la dynamique de la conception et du fonctionnement des systèmes de recherche et de recommandation priorisent des critères qui nuisent à la diversité, notamment : l’historique de navigation et de consommation de l’utilisateur et ses préférences ; les contenus les plus populaires auprès de ses contacts, amis et relations sur les réseaux sociaux ; les logiques éditoriales propres à la plateforme basées sur des facteurs tels que la différenciation de son offre et la mise en valeur de ses propres contenus originaux exclusif, non disponibles dans les catalogues des plateformes concurrentes ; etc.
Pour Mira Burri, si l’on souhaite atteindre de véritables objectifs de politique publique relatifs à la mise en valeur d’une diversité de consommation culturelle, il est essentiel de chercher au préalable à favoriser l’exposition et la découvrabilité d’une offre diversifiée, constituée d’un « bon mélange » 42de contenus locaux, nationaux et internationaux. Pour ce faire, des mesures doivent être prises par les autorités en charge de la régulation et de la réglementation des systèmes de radiodiffusion et de communication électronique (en particulier les nouveaux services de médias numériques), afin d’expérimenter une approche de « gouvernance par les algorithmes » appliquée aux secteurs culturels. Une telle approche peut s’avérer utile et efficace pour inciter les entreprises du Web et de l’industrie des contenus à rétablir un juste équilibre entre la manière dont les contenus sont éditorialisés sur leurs plateformes et les techniques algorithmiques utilisées pour proposer des recommandations ultra-personnalisées43 de contenus, en fonction des profils et des goûts individuels des utilisateurs. Il s’agit, selon Mira Burri, de « nouvelles formes d’intelligence éditoriale » pouvant déboucher sur un genre de « médiation d’intérêt public de l’espace numérique », qui contribuerait à atteindre des objectifs ou cibles précis de politique culturelle, comme des exigences44minimales de découvrabilité, sans toutefois négliger que les occurrences de contenus promotionnels puissent inclure des possibilités de découvertes fortuites pour les utilisateurs45. Ces analyses laissent percevoir le rôle crucial de la découvrabilité dans le passage de la diversité offerte (contenus diversifiés disponibles et mis à disposition de l’utilisateur) à la diversité consommée (contenus diversifiés effectivement consommés par l’utilisateur)46. Ce passage est aussi décisif que celui du processus permettant à l’utilisateur de passer de l’étape de la recherche en ligne de contenu à la recommandation et à la découverte effective du contenu.
Il est évident que les algorithmes, ces architectes de nos choix, exercent ici une influence sur ce processus qui renvoie à la complexité des modalités et déterminants techniques de la découvrabilité. On ne peut donc avoir aujourd’hui une meilleure compréhension de la façon dont les auditoires découvrent et accèdent à une diversité de contenus en ligne, sans tenir compte du rôle déterminant des systèmes algorithmiques.
Les effets de la découvrabilité sur l’accès et la consommation d’une diversité d’expressions culturelles, notamment francophones, en ligne peuvent ainsi être expliqués par un facteur déterminant, que Fenwick McKelvey et Robert Hunt ont nommé : la « responsabilité algorithmique ». Cette notion soulève des enjeux juridiques, politiques, éthiques et sociaux de la responsabilisation des entreprises d’Internet et des plateformes numériques œuvrant dans le domaine culturel, vis-à-vis de la façon dont elles automatisent la structuration et la présentation de l’offre de contenus de leurs catalogues en ligne ainsi que la collecte des données d’usage de leur clientèle, de sorte à orienter ou à préconfigurer les choix et tendances de consommation culturelle à l’échelle mondiale, quitte à inclure des recommandations47 biaisées. McKelvey et Hunt expliquent que : « Sur les plateformes de découverte de contenu, les algorithmes sont une solution technique pour les questions complexes de réception et d’interprétation culturelles, telles que la pertinence, le goût, le plaisir et la personnalité […]. Les algorithmes interprètent les utilisateurs et les contenus afin d’idéalement améliorer leurs interactions et de trouver des contenus pertinents pour les utilisateurs. »48.
Cependant, il arrive beaucoup plus souvent qu’on ne le conçoit que les contenus considérés comme pertinents pour l’utilisateur et qui lui sont recommandés soient en réalité le résultat d’une apparente liberté de choix, le choix étant lui-même influencé par la combinaison de différents paramètres tels que : le parcours de navigation de l’utilisateur sur l’interface de la plateforme, ses comportements par rapport aux différents flux de contenus auxquels il est exposés en ligne, les stratégies marketing ou publicitaires49 et les impératifs de rentabilité qui déterminent l’exposition, la visibilité ou la mise en valeur des contenus ainsi que les modèles de conception et de gestion éditoriale et algorithmique des interfaces par les plateformes50.
Ces profonds bouleversements qu’entraîne le numérique dans le champ culturel et qui ont des impacts tant positifs que négatifs sur la création, la diffusion et l’accès aux œuvres francophones justifient que la Francophonie se remobilise dans son combat pour la protection et la promotion de la diversité culturelle.
En effet, quinze ans après l’adoption de la Convention de l’UNESCO de 200551, on se rend compte que l’environnement évolutif des technologies numériques fait en sorte qu’on ne peut considérer la diversité culturelle comme un acquis définitif puisque l’application même des principes de la Convention se trouve constamment confrontée aujourd’hui à des défis majeurs et à de nouvelles réalités imposées par de nouveaux acteurs numériques qui n’existaient même pas en 2005. Convaincus que la Convention garde toujours toute sa pertinence face à ces défis et déterminés à en faire un instrument de gouvernance de la culture à l’ère numérique, les Parties à la Convention ont adopté en juin 2017 des Directives52 opérationnelles sur le numérique (Résolution 6.CP 11) et ont élaboré une feuille de route ouverte53 et commune, basée sur un certain nombre d’actions prioritaires.
À l’étape de la distribution et de la diffusion, les nouvelles Directives prévoient deux mesures exhortant les Parties à atteindre des objectifs spécifiques en lien avec la découvrabilité des contenus nationaux et locaux :
-
« 16.1 - Encourager la diversité des médias numériques, y compris la multiplicité des distributeurs numériques de biens et services culturels et des acteurs du numérique (plateformes en ligne, fournisseurs d’accès à Internet (FAI), moteurs de recherche, réseaux sociaux), tout en garantissant la visibilité et la découvrabilité des contenus culturels nationaux et locaux » ;
-
« 6.2 - Promouvoir le dialogue entre opérateurs privés et autorités publiques afin de valoriser une plus grande transparence dans la collecte et l’utilisation des données qui génèrent des algorithmes, et encourager la création d’algorithmes qui assurent une plus grande diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique et qui favorisent la présence et la disponibilité d’œuvres culturelles locales ».
Au stade de l’accès, les Parties sont invitées à s’efforcer d’assurer l’accès libre et pérenne aux diverses expressions culturelles dans l’environnement numérique, à travers des mesures essentielles telles que :
-
« 17.1 - Instaurer une plus grande transparence et une meilleure lisibilité des modes d’indexation et de référencement des contenus afin que les mécanismes numériques (algorithmes de recommandation) qui déterminent les contenus disponibles pour les utilisateurs offrent un large éventail d’expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique » ;
-
« 17.2 - Investir dans les infrastructures de télécommunications, les développer et les renforcer afin d’améliorer l’accès à des expressions culturelles diverses dans l’environnement numérique » ;
-
« 17.3 - Encourager la mise en œuvre de mesures de préservation numérique et le développement d’infrastructures permettant d’assurer un accès universel et pérenne au contenu culturel malgré l’évolution constante et rapide de l’environnement numérique ».
En résonance à ces dispositions et considérant la situation spécifique des pays en développement (en particulier ceux de l’Afrique francophone), Jean-Musitelli54 plaide pour une intervention urgente afin d’« accompagner les écosystèmes numériques par des politiques publiques, nationales et multilatérales, visant à garantir le pluralisme des expressions culturelles, à assurer le financement de la création et la rémunération équitable des auteurs, et à éviter que ne se créent à l’échelle planétaire de nouvelles fractures entre les populations connectées et celles qui sont privées d’accès aux réseaux numériques. Ces questions se posent avec une particulière acuité dans les pays en développement qui constituent majoritairement l’aire francophone. Au regard de leurs besoins, le numérique peut tout aussi bien, selon l’application qui en est faite, leur offrir des perspectives de rattrapage grâce au raccourci technologique qu’il autorise ; ou, à l’inverse, si le virage numérique n’est pas rapidement pris, creuser la fracture numérique. Aider les pays en développement à réussir leur entrée dans l’ère numérique représente donc une condition impérative pour y préserver la diversité culturelle. »55
3. Transformation numérique des industries culturelles et créatives francophones et impacts sur la chaîne de valeur culturelle
Le secteur des industries culturelles et créatives demeure encore à un stade embryonnaire ou d’émergence dans la plupart des pays en développement francophones. Tel est le diagnostic posé par la série d’études56 publiées par l’OIF, entre 2010 et 2012, relativement aux profils culturels des pays du Sud membres de la Francophonie. Bien qu’il y ait des spécificités liées à l’évolution des industries culturelles dans ces pays, on peut dégager de la littérature un ensemble de constats basés sur des caractéristiques structurelles et des logiques d’acteurs qui leur sont communs. En effet, la plupart des pays du Sud francophones sont caractérisés par l’étroitesse de leur marché culturel, avec des microentreprises opérant dans un secteur d’activités en cours de structuration et à prédominance informelle.
À cela s’ajoutent le manque de professionnalisation des filières culturelles, les besoins en renforcement de capacités des acteurs et opérateurs culturels, les problèmes liés au pouvoir d’achat relativement faible des consommateurs, le faible amortissement ou la capacité d’absorption des coûts de production des biens et services culturels, exacerbés par les pratiques de commerce illégal de produits culturels piratés dû aux cadres juridiques défaillants en matière de protection des droits d’auteurs et des droits voisins. Ce tableau peu reluisant pose de toute évidence des problèmes en termes de compétitivité, d’exploitabilité et de rentabilité des biens et services culturels francophones produits localement.
Pourtant, les pays francophones disposent d’un important vivier de talents créatifs et d’un patrimoine culturel diversifié dont l’accessibilité, la valorisation et l’exportation pourraient contribuer significativement à la création d’emplois et de richesse au niveau national. Comme le rapporte Raguidissida Émile Zida dans sa thèse de doctorat, soutenue en mars 2018 :
« Si au niveau mondial, les industries culturelles ont semblé convaincre de leur impact pour le développement, cela n’a pas été évident dans les pays du sud, notamment en Afrique subsaharienne francophone. Pendant que dans beaucoup de pays occidentaux, principalement nord-américains, leur contribution au développement est expliquée par des données chiffrées, dans les pays en développement au contraire, particulièrement en Afrique, leur valeur ajoutée tarde à être visible. » 57.
En effet sur le continent africain, la plupart des pays cités comme des modèles de réussite en matière de développement de leurs industries culturelles sont des pays anglophones comme le Nigéria (avec sa désormais célèbre industrie cinématographique Nollywood) ou l’Afrique du Sud. Cette situation s’explique surtout par le fait que dans les pays francophones du Sud, le secteur culturel a longtemps été relégué au second plan des politiques publiques et la prise de conscience du potentiel des industries culturelles pour le développement économique, social et culturel dans ces pays ne s’est produite que très tardivement.
Jusqu’à récemment, les dynamiques dans les secteurs de la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et du livre ont toujours révélé de flagrantes inégalités entre les pays du Sud et ceux du Nord, faisant des uns les consommateurs et récepteurs passifs des produits culturels créés, diffusés et distribués par les autres. Rappelons que l’émergence des industries culturelles des pays francophones du Sud est aussi freinée d’une part par les carences des cadres réglementaires, des politiques et des stratégies culturelles qui demeurent inadaptés face aux nouveaux enjeux et défis du numérique et l’absence de mécanismes d’accès au financement pour soutenir la création. Tous ces freins structurels limitent les opportunités d’investissements nécessaires à l’éclosion d’entreprises culturelles pouvant potentiellement développer une offre de services de diffusion et de distribution numériques de contenus francophones, en profitant d’un environnement numérique propice et en s’appuyant sur des modèles d’affaires innovants et viables.
Toujours est-il que la rapidité et l’ampleur des changements technologiques insufflent un vent de renouveau et de redynamisation pour les filières culturelles et créatives. Le premier panorama mondial de l’économie de la culture et de la création58, publié en décembre 2015 par le Cabinet EY et la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), a ainsi révélé l’importante contribution des œuvres culturelles et créatives à l’économie numérique, à travers les recettes générées par le contenu culturel aux acteurs numériques.
En effet, selon cette étude, les industries culturelles et créatives (ICC) représentaient 200 milliards de dollars des ventes numériques mondiales en 2013. Elles stimulent également les ventes d’appareils numériques (téléphones intelligents, tablettes, liseuses numériques, TV intelligentes, lecteurs de DVD, etc.) qui se sont élevées à 530 milliards de dollars cette même année. En outre, les biens culturels numériques (livres numériques, musique, vidéos, jeux) constituent de loin la plus grande source de revenus de l’économie numérique, générant 66 milliards de dollars de ventes aux consommateurs en 2013 et 21,7 milliards de recettes publicitaires pour les médias en ligne et les sites de streaming gratuits59.
Rappelons que les mutations numériques des industries culturelles sont la conséquence de la vague de dématérialisation des produits culturels, ayant marqué la décennie 2000-2010. Comme le fait remarquer Lucien Perticoz, on assiste à une évolution des pratiques de consommation culturelle qui nécessitent des ajustements au niveau des règles de jeu qui régissent habituellement les logiques des acteurs traditionnels dans les différentes filières des industries culturelles :
« La numérisation des contenus culturels et informationnels ainsi que l’évolution des pratiques de consommation corrélatives sont venues bousculer les positions que certains acteurs économiques (studio de cinéma, majors du disque, chaînes de télévision commerciale, etc.) ont parfois mis des années à se constituer. Dans un contexte où le consommateur final peut accéder à une multitude de contenus numérisés, les firmes concernées sont contraintes de revoir les modalités d’exploitation de leurs catalogues ou la manière d’élaborer leurs offres de programmes. »60
Les effets positifs de l’économie numérique sur l’attractivité des industries culturelles et créatives francophones commencent aussi à être perceptibles, comme l’illustrent la croissance des échanges culturels entre les pays de l’espace francophone et l’accès élargi des œuvres francophones aux marchés internationaux des biens et services culturels61. En réalité, la circulation transnationale des flux de produits culturels numériques francophones au cours des dernières années est directement liée à l’émergence de nouveaux circuits de distribution et aussi à l’augmentation de la quantité de contenus francophones mis en marché et disponibles dans les catalogues des plateformes mondiales.
La contribution62 de la chercheure et économiste Maria Masood au rapport annuel La langue française dans le monde, 2019 confirme la tendance à l’intensification des échanges de biens et services culturels entre francophones dans plusieurs secteurs des industries créatives, comme l’édition, l’audiovisuel et les jeux vidéo, et ce grâce à leur langue commune. Elle explique que :
« […] l’existence de l’espace francophone représente une opportunité de taille pour les pays francophones sur le marché international des biens culturels. Parce qu’ils véhiculent des symboles, des valeurs et une certaine vision du monde, les échanges culturels découlent bien souvent de l’existence d’une certaine proximité culturelle entre consommateur et producteur. Si le fait de partager une même langue implique une plus grande proximité culturelle, alors les artistes et producteurs francophones pourraient profiter de débouchés privilégiés au sein de l’espace francophone pour percer sur la scène internationale. »63.
S’appuyant sur les données de commerce fournies par l’UNESCO pour la période 2008-2015, Maria Masood démontre également qu’en moyenne sur cette période : « les exportations de biens culturels de l’espace francophone étaient destinées pour 26 % aux autres pays de l’espace (contre 13 % pour les autres biens). De façon analogue, en moyenne entre 2008 et 2015, 18 % des importations totales de biens culturels provenaient des pays de l’espace francophone (contre 12 % pour les autres biens). »64. En 2015, ces échanges de biens culturels au sein de l’espace francophone65 représentaient ainsi un total de 5,7 % dans les échanges culturels mondiaux, soit pratiquement le double de ce que cela représentait en 2008 (2,6 %). Il est également encourageant d’observer l’appétence des francophones pour la consommation de musique et de films en langue française (respectivement 19 % et 12 % des exportations de biens culturels au sein de l’espace francophone, sur la période 2000-2015)66.
L’étude du Cabinet EY et de la CISAC, qui analyse les marchés de la culture et de la création dans le monde, fait aussi état de l’appétit inégalé qu’ont les francophones, en particulier les africains, pour les biens et services culturels. En voici un extrait qui décrit, avec une pointe d’optimisme, la situation très prometteuse de la consommation de contenus culturels dans les pays d’Afrique francophone :
« Les Africains consomment de plus en plus de culture, qu’elle soit ultralocale, nationale, étrangère ou numérique. La libéralisation du secteur audiovisuel dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique au début des années 2010 – permettant l’introduction de stations de radio privées – et l’avènement de plateformes numériques de vidéo et de musique ont favorisé la diffusion de contenus culturels étrangers dans la région. […] La soif de culture se renforcera rapidement car une population jeune s’équipe de smartphones et tablettes bon marché. Le nombre d’habitants, environ 1,1 milliard aujourd’hui, devrait augmenter de 400 millions au cours des deux prochaines décennies, fournissant des bataillons de consommateurs avides de culture. […] Le contenu culturel se vend de plus en plus dans toute l’Afrique. Les producteurs africains de télévision, de films et de musique se rendent compte que pour financer les coûts de production sur un marché sensible au prix, la meilleure stratégie est de maximiser les audiences en répondant aux goûts panafricains et en vendant au-delà des frontières nationales. […] Le contenu culturel africain s’exporte de plus en plus dans le monde à la fois grâce aux acteurs locaux et internationaux. […] Les groupes de médias internationaux cherchent également à accroître la visibilité et les exportations de culture africaine. »67
Ces constats enthousiasmants qui témoignent d’une certaine maturité des industries de contenus en Afrique francophone ne doivent pas faire occulter une autre réalité importante sur laquelle insiste Octavio Kulesz dans le Rapport mondial 2018 Repenser les politiques culturelles. L’expert culturel et éditeur argentin observe notamment un écart persistant en termes d’approvisionnement et de disponibilité de contenus et de services numériques entre les pays développés et les pays en développement :
« La moyenne de "pertinence locale" des contenus numériques dans les pays développés est de 71 % alors qu’elle n’est que de 42 % dans les pays en développement. Ces données suggèrent que la probabilité de participation des citoyens à la création, à la distribution et à la consommation d’une grande diversité de contenus numériques est plus élevée dans les pays développés. De même, les pays développés atteignent une moyenne de 84 % de "disponibilité" des contenus numériques, contre seulement 42 %, soit la moitié, dans les pays en développement. Cela signifie que les pays développés jouissent d’une quantité de contenus produits dans leurs langues respectives bien plus importante. Lorsqu’on les additionne, ces deux écarts de moyenne entre les pays développés et les pays en développement indiquent qu’il est bien plus probable que les contenus et services numériques proviennent de l’étranger pour les pays en développement que pour les pays développés. Les pays en développement font également preuve d’un engagement moindre envers certains contenus et services numériques ».68
Ce constat est également valable sur une échelle de comparaison entre les pays africains francophones et anglophones. L’étude, publiée en 2016 par le Secrétariat du Groupe des Pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), sur les enjeux et les retombées économiques et artistiques de la diffusion et la distribution en ligne de contenu culturel avait conclu de l’existence d’une nette avance et d’une domination de l’offre en ligne des contenus locaux provenant des pays anglophones (Nigéria, Afrique du Sud, Kenya, Tanzanie, Ouganda, Ghana, Zambie, etc.) par rapport aux pays francophones de la région ACP. L’étude explique cet écart par le fait que les pays anglophones du continent ont plus tôt que les autres, pris des mesures visant à favoriser le virage numérique de leurs industries culturelles en soutenant financièrement les activités de production, de diffusion et de distribution numériques de contenus audiovisuels, cinématographiques et musicaux, répondant aux exigences des marchés internationaux69.
Quoi qu’il en soit, on peut déjà conclure à ce stade de notre réflexion que les transformations numériques sont porteuses de nouveaux débouchés économiques que les créateurs et artistes francophones devraient saisir, en décuplant les possibilités d’accessibilité et de monétisations de leurs œuvres en ligne. Cependant, les plateformes numériques s’imposent encore comme les nouveaux intermédiaires de la chaîne de valeur culturelle70, tentant de contrôler l’ensemble des activités culturelles, de la production à la vente, en passant par la promotion et la diffusion. La nouvelle économie des réseaux « se caractérise en effet par des coûts de structure qui, contrairement aux grandes firmes traditionnelles, n’augmentent pas à mesure que la taille de l’entreprise augmente. Les rendements croissent avec la taille car la valeur du réseau augmente avec le nombre de ses utilisateurs.71 ». Les plateformes voient ainsi leurs profits s’accroître et les coûts de production baisser à mesure que les utilisateurs se multiplient. Parallèlement, le coût de production baisse parce que le « bien-service » est utilisé « des milliers de fois » par plusieurs utilisateurs. Selon Pierre Beckouche, les entreprises qui survivent au tournant digital « sont soit les entreprises des secteurs traditionnels capables d’opérer ce virage […], soit les opérateurs numériques capables d’investir des secteurs aussi variés que les télécoms, la banque, le transport, etc.72 ». Par exemple, « Netflix a détrôné Blockbuster, leader historique des vidéoclubs, » et « les nouveaux leaders de la musique sont des sociétés de logiciels (iTunes, Spotify…)73 ». La figure 4 (voir page suivante) illustre cette recomposition de la chaîne de valeur culturelle, caractérisée par un phénomène de disruption numérique et de captation de valeur dus au positionnement, désormais central, des plateformes numériques dans le processus de désintermédiation et de réintermédiation74 des échanges culturels. Ces nouveaux acteurs se substituent progressivement aux acteurs dits traditionnels, que ce soit les industriels (producteurs/éditeurs) que les exploitants (diffuseurs/distributeurs).
Figure 4 – Disruption numérique de la chaîne de valeur culturelle
Dans le secteur audiovisuel par exemple, Netflix est devenu en 2018 le premier producteur de films d’Hollywood, tant par le nombre de films que par les sommes investies. Le leader de la vidéo à la demande a été aussi admis dans la Motion Picture Association of America (MPAA) et a remporté huit Oscars entre 2018 et 202075. D’après Alain Le Diberder, ancien Directeur des programmes et gérant d’Arte de 2012 à 2017 :
« C’est la première fois depuis un siècle qu’un outsider réussit à se faire une place au côté des majors, et c’est la première place »76.
Il étend également son analyse à la fonction d’édition de contenus en expliquant que :
« Les plateformes de SVOD77 concurrencent et remplacent certaines chaînes de télévision. YouTube a créé un nouveau type d’intermédiaire, les hébergeurs, capables non seulement de donner un cadre à la production amateur, mais plus généralement de recueillir tout ce qui ne trouvait plus sa place dans les grilles de télévision, comme la télévision scolaire. Les éditeurs traditionnels, éditeurs vidéo, distributeurs audiovisuels et chaînes de télévision entrent en crise.78»
4. Découvrabilité et rémunération des créateurs face aux défis du piratage et de la gratuité des contenus
La dématérialisation des produits culturels a facilité leur reproduction, leur diffusion massive et leur partage, en même temps qu’elle rend difficile la possibilité de pouvoir mesurer avec précision leur circulation élargie dans l’environnement numérique. Les modes diversifiés de découverte et de consommation des œuvres sur Internet posent un problème pour leur traçabilité et par conséquent pour la juste rémunération des créateurs et des ayant-droits qui perdent le contrôle sur la circulation de leurs œuvres, en raison des nombreuses transactions non enregistrées79.
Par ailleurs, les industries de contenus se trouvent confrontées de manière récurrente à la culture de la « gratuité », qui s’est développée depuis les débuts de l’Internet. À ce sujet, Serge Proulx et Anne Goldenberg nous rappellent que les premiers usages du réseau Internet ont été « fortement marqués par cette culture de la liberté, de la gratuité et de l’ouverture aux contributions informelles et décentralisées »80. Ceci reflète bien l’état d’esprit et le fantasme libertarien que nourrissaient à l’époque certains pionniers81 de l’Internet qui considéraient le cyberespace comme un « projet social émancipateur », un espace collectif autogéré (ou affranchi des logiques commerciales et étatiques) et propice à l’expérimentation de nouveaux rapports d’échanges, caractéristiques de la cyberculture.
En effet, les internautes sont habitués à accéder gratuitement à de très nombreux services et applications comme les moteurs de recherche (Google), les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ainsi qu’à des centaines de milliers de contenus comme les vidéos et les morceaux de musique sur des sites comme YouTube ou les jeux vidéo dans des communautés de joueurs en ligne ou des réseaux de partage de fichiers en pair à pair. D’une part, si cette culture de la gratuité et du partage82 sur Internet favorise l’accès libre et illimité ainsi que le partage d’un volume considérable de contenus culturels entre les utilisateurs-consommateurs qui devraient « normalement » payer pour y accéder, d’autre part elle pénalise et constitue une véritable menace pour les créateurs, les producteurs, les auteurs et autres détenteurs de droits qui n’arrivent pas à bénéficier des revenus liés à l’utilisation et l’exploitation de leurs œuvres et contenus. Un peu partout à travers le monde, et même dans les pays développés, nombreux sont les internautes qui sont encore imprégnés de cette culture de la gratuité et qui utilisent encore divers moyens détournés, voire illicites, pour accéder à des contenus protégés par le droit d’auteur, sans avoir nécessairement à payer en contrepartie83 pour leur consommation.
C’est ainsi que les pratiques de piratage qui affectent les échanges de biens culturels se sont amplifiées avec l’avènement du numérique, surtout dans les pays francophones d’Afrique subsaharienne n’ayant pas de ressources, ni de cadre législatif appropriés pour lutter efficacement contre ce fléau. Dans ces pays, la problématique du piratage et de la protection de la propriété intellectuelle est prise en charge de façon très parcellaire, bien que s’étant généralisée au niveau de l’ensemble des filières de l’audiovisuel, de la musique et du livre, avec une importante croissance des offres numériques illégales.
C’est ce que rapporte notamment l’étude technique sur les droits d’auteur, réalisée entre 2017 et 2018 sous l’égide de l’Agence française de Développement (AFD) et du cabinet Bearing Point, relativement à la situation dans les pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA), dont sept des huit États membres sont francophones84. En effet, bien qu’on note dans la région le développement d’offres légales de plateformes de vidéo à la demande et de plateformes musicales (comme Musik Bi au Sénégal, WAW Music en Côte d’Ivoire), l’étude souligne que : « les plateformes illégales de téléchargement, qui ne nécessitent qu’une courte connexion à Internet, sont plus populaires que celles de streaming, qui nécessitent une utilisation prolongée, et donc plus chère, de données. Les plateformes comme Spotify, YouTube ou Deezer, qui ne proposent pas encore d’achat à l’acte en Afrique, restent généralement trop chères pour concurrencer sérieusement les offres illégales. En outre, si auparavant les marchés parallèles étaient remplis de CDs et DVDs piratés, aujourd’hui il est possible de payer pour obtenir un fichier numérique piraté sur une clé USB »85.
En outre, il n’existe pas véritablement de dispositions dans ces pays pour collecter les droits issus des exploitations des œuvres par les plateformes numériques puisque les organisations de gestion collective ont des difficultés à négocier avec les utilisateurs des œuvres diffusées sur Internet, comme dans le cas de l’exploitation en replay (rediffusion sur des plateformes de rattrapage en ligne) de programmes ou d’émissions par une chaine de télévision86. Ces organisations ont également besoin de renforcer leurs connaissances et savoir-faire techniques en matière d’enregistrement des métadonnées sachant que cela peut faire partie de solution pour garantir une meilleure traçabilité des œuvres numériques et assurer un paiement plus adéquat des redevances aux ayant-droit.
Ajoutons à ces difficultés, une autre problématique majeure qui est celle de la non-divulgation des données collectées par les grandes plateformes telles que Netflix, Spotify ou Amazon sur la consommation des contenus francophones au niveau national. Ces données sont pourtant nécessaires pour permettre aux pouvoirs publics de mieux comprendre les besoins et préférences des auditoires et de pouvoir mieux ajuster leurs politiques ou programmes de soutien à la création et la promotion d’une offre culturelle numérique légale, qui soit favorable à la découvrabilité des contenus nationaux et locaux.
Cette situation amène à s’interroger sur les pratiques informelles de partage de contenus audiovisuels à travers le piratage des télévisions payantes, des biens culturels et des biens numériques87. Pour Tristan Mattelart, le piratage est un phénomène socioéconomique, mais également culturel et politique complexe, défiant à la fois les potentiels limites dans la disponibilité et l’affluence de contenus et l’idée même que les publics issus des pays non-occidentaux seraient passifs face aux contenus qui leurs sont envoyés. Selon lui, le piratage, en tant que nouvelle infrastructure de partage et de consommation, offrirait plutôt une alternative aux modes de production et de distribution dominants des industries culturelles et audiovisuelles occidentales :
« […] les réseaux du piratage de supports numériques sont, pour les laissés pour compte de la mondialisation, une des voies majeures d’accès aux produits culturels internationaux. Les circuits de l’économie informelle donnent de fait à ces populations un moyen de profiter de l’ubiquité croissante des biens communicationnels à l’ère digitale en leur permettant de consommer les mêmes produits que ceux consommés par les populations des grands pays industrialisés et ce, suivant le même tempo, largement accéléré »88.
Cependant, une telle analyse ne devrait pas occulter de considérer les obstacles liés au développement infrastructurel même qui conditionne l’accès aux contenus, préalable à leur découvrabilité. Ainsi, pour Liang, on peut voir l’accès soit de façon paternaliste (paternal access), soit de façon rebelle (defiant access). Si la vision paternaliste implique l’accent sur la reconnaissance d’un manque à combler, l’accès rebelle est déterminé en fonction du fait que « les gens essaient d’accéder à des choses auxquelles ils ne sont pas censés accéder »89. Cette situation coïncide particulièrement en Afrique avec la coexistence dans chaque sphère d’activités entre l’économie formelle et l’économie informelle90.
Aussi, peut-on considérer que dans les pays en développement, le piratage contribue d’une certaine manière à la découvrabilité d’une diversité d’œuvres et de produits culturels. Cela concerne toutefois spécifiquement : soit les œuvres qui, pour des raisons de qualité ou de non-respect des standards internationaux, ne se retrouvent pas dans les circuits de distribution traditionnels qui favorisent plutôt les best-sellers et le star-system ; soit les œuvres qui ne sont pas accessibles pour certaines catégories de la population, compte tenu des raisons économiques telles que le faible niveau de vie ou de pouvoir d’achat des utilisateurs-consommateurs.
La découvrabilité de contenus sur Internet par des moyens illicites nuit cependant à la rémunération des détenteurs de droits sur ces œuvres facilement reproductibles et dont la consommation ou la circulation n’est pas toujours retraçable. C’est notamment le cas pour les œuvres musicales qui pâtissent de la pratique dite de stream ripping91, consistant à créer un fichier téléchargeable à partir d’un contenu disponible en streaming. Considérée comme étant actuellement la forme prédominante de piratage de la musique en ligne, cette pratique constitue une réelle menace pour l’industrie musicale en général, et en particulier pour la rémunération équitable des artistes francophones. En effet, une fois le contenu téléchargé (par exemple l’extraction d’un morceau de musique en format audio MP3 à partir d’un clip vidéo sur YouTube92), l’utilisateur peut l’écouter à sa guise ou le partager avec des personnes de son entourage. Toutes les nouvelles écoutes ainsi générées ne seront pas comptabilisées par les acteurs du streaming audio (comme Deezer, Spotify, Apple Music ou Amazon Music).
Une telle situation peut réduire de manière conséquente le potentiel de monétisation d’une œuvre musicale par la publicité ; ce qui limite sérieusement la rémunération des ayant-droits93. Le Panorama de la consommation de la musique dans le monde en 2019 publié par la fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI) pointe du doigt les importants manques à gagner liés au piratage dans le secteur de la musique numérique94. En effet, l’enquête annuelle de l’IFPI rapporte que 27 % des consommateurs interrogés ont utilisé des moyens illicites pour écouter ou acquérir de la musique, dont 38 % des jeunes de 16-24 ans. Au cours du mois de septembre 2019, 23 % des internautes ont, quant à eux, pratiqué le stream ripping à partir de sites illicites95.
Un autre rapport publié en 2019 par l’UNESCO sur la culture et les conditions de travail des artistes relève l’« écart de valeur » contrastant qui montre d’une part l’augmentation des sommes dépensées par les consommateurs et les annonceurs dans les services de diffusion en continu et de téléchargement de musique et d’autre part, la baisse des sommes perçues par les artistes qui écrivent, composent, chantent et produisent cette musique. Le verdict des chiffres est sans appel :
« À l’heure actuelle, selon le Conseil international de la musique, 5 % des artistes perçoivent 95 % des redevances au titre de services de diffusion en continu. Auparavant, 20 % des artistes percevaient 80 % des redevances au titre de services de diffusion en continu, ce qui amène à conclure que la diversité est en voie de disparition. De surcroît, un certain nombre de services de téléchargement n’assurent pas une rémunération équitable aux artistes. Le Conseil international de la musique estime que les artistes ne gagnent chaque année que 20 dollars des États-Unis par utilisateur via Spotify et seulement 1 dollar des États-Unis via YouTube. Alors que certains chanteurs, compositeurs et musiciens ont eu accès à de nouveaux publics grâce à l’Internet, que ce soit dans leur pays ou à l’étranger, les principaux acteurs de l’industrie musicale continuent d’être en position dominante. »96
Au regard de ce qui précède, l’accessibilité et la découvrabilité s’imposent comme des conditions indispensables pour une rémunération équitable des artistes pour l’exploitation de leurs œuvres en ligne. Des dispositions adéquates et ciblées doivent donc être prises pour favoriser une meilleure protection de la propriété intellectuelle ainsi qu’une juste rémunération des créateurs et des artistes à l’ère du numérique. Il ne serait pas superflu d’accompagner de telles dispositions avec des mesures spécifiques pour sensibiliser davantage les usagers et les législateurs par rapport aux risques et menaces qui pèsent sur le travail des artistes.
Comme le recommande le Rapport 2018 sur l’état des lieux de la Francophonie numérique :
« […] Pour garantir l’intégration harmonieuse de la propriété intellectuelle dans un environnement économique de plus en plus numérisé, en proie à une dynamique disruptive sans précédent, les États francophones avec l’appui et le leadership des structures spécialisées de l’espace francophone peuvent jouer un rôle déterminant. […] En capitalisant sur les acquis de la Francophonie dans le domaine du numérique, les gouvernements des PED pourront concevoir des cyberstratégies pertinentes intégrant la prise en charge adéquate des problématiques actuelles de la propriété intellectuelle ».97
Plusieurs préoccupations peuvent être ici prises en considération, mais il importe d’accorder, de façon prioritaire, une vigilance à l’adaptation et à l’application des cadres juridiques de protection de la propriété intellectuelle par rapport aux enjeux stratégiques suivants :
-
La transparence et la loyauté des systèmes algorithmiques de recommandation et de prescription culturelle ;
-
l’interfaçage, l’interopérabilité, l’accessibilité, la sécurité et la neutralité des plateformes, des systèmes intelligents et des terminaux ou équipements servant à des transactions et échanges culturels ;
-
la collecte de données massives sur la consommation culturelle et les comportements des utilisateurs, en lien avec les modèles d’affaires basées sur la publicité ;
-
l’utilisation et la monétisation des expressions culturelles numériques en ligne ;
-
la numérisation et l’enrichissement de métadonnées descriptives des œuvres, à des fins de traçabilité, de découvrabilité et d’augmentation des revenus des artistes, etc.
III. Résultats d’enquêtes et d'analyses
Les résultats de l’étude sont issus autant des données quantitatives que des données qualitatives d’enquête et de recherche. Les résultats obtenus à l’issue des opérations de moissonnage de données en ligne s’appliquent seulement aux plateformes étudiées dans la période d’observation d’octobre 2019 à février 2020. Ils ne tiennent pas compte des éventuels changements et des évolutions dynamiques intervenus après cette période et s’appliquant à des éléments tels que les processus éditoriaux, les modèles d’affaires, les systèmes et les mécanismes de recommandation ou encore à l’interface et au catalogue et bibliothèque de contenus de ces plateformes. En ce qui concerne les enquêtes par questionnaire électronique et par entrevues, les données recueillies ne reflètent que les points du panel des répondants et des personnes interviewées et des précautions devraient être prises dans leur interprétation afin d’éviter toute généralisation inappropriée.
1. Faible présence et découvrabilité limitée des contenus francophones en ligne
1.1. La mesure de la présence en ligne des contenus culturels francophones : retour sur la démarche méthodologique
Dans le contexte actuel d’explosion de la production de données massives en ligne, il devient difficile de pouvoir mesurer en temps réel les tendances relatives à l’offre et à la demande de produits culturels numériques, d’autant plus que l’essentiel des données statistiques sur la création, la diffusion, l’accès et la consommation de ces produits et contenus est détenu par des entreprises privées. Celles-ci ne donnent pas accès à ces données et refusent même parfois de les communiquer à des fins de transparence aux autorités publiques, évoquant généralement des motifs de protection des données personnelles ou des données d’usage de leurs clients (abonnés des plateformes de diffusion culturelle) ainsi que des motifs relevant de la confidentialité ou du secret des affaires. Les chercheurs, mais aussi les instituts de statistique en charge de la production de statistiques culturelles au niveau national, ont ainsi du mal à réaliser des portraits actualisés et exhaustifs des marchés de consommation culturelle numérique, compte tenu des nombreux obstacles pour accéder à des sources de données fiables et pertinentes ou pour produire des analyses en lien avec la circulation, les échanges, la consommation et les usages de contenus culturels dans l’environnement numérique.
Bien qu’il y ait des statistiques sur les ventes numériques au niveau national, il existe donc encore des limites dans la production d’indicateurs ou d’indices solides qui permettraient de véritablement mesurer la découvrabilité des contenus nationaux et locaux sur les plateformes transnationales, tant du point de vue de l’exposition de l’offre que de la satisfaction de la demande des consommateurs culturels. Parmi les difficultés rencontrées au fil de plusieurs expériences de recherche dans ce domaine, nous pouvons témoigner d’importants défis méthodologiques auxquels n’échappe pas la présente étude et qui sont inhérents aux cadres conceptuels d’élaboration d’indicateurs de mesure des flux d’échanges d’œuvres culturelles numériques. Comment peut-on, par exemple, mesurer avec précision et en temps réel la circulation et la consommation de nouvelles formes de biens et de services culturels dématérialisés au sein de l’espace francophone et au-delà ? Comment distinguer la part de contenus nationaux francophones par rapport à la part de contenus étrangers ou internationaux sur les catalogues des plateformes mondialisées telles que Netflix, YouTube ou Spotify ? Mais tout d’abord, comment définir un contenu culturel francophone ?
Partant de la définition de contenu culturel telle que proposée par l’UNESCO98, nous désignons, dans le cadre de la présente étude comme « contenu culturel francophone » : tout élément porteur d’informations empreintes d’une forte représentation symbolique, émanant d’un produit ou d’une œuvre, à dimension artistique, en phase de commercialisation ou mise sur le marché, et ayant des attributs qui expriment des valeurs ou des identités culturelles reflétant la créativité des individus, des groupes et des sociétés de pays membres de la Francophonie. Toujours est-il que cette définition aussi englobante soit-elle, ne permet pas de résoudre en définitive la problématique de l’origine ou de la nationalité d’une œuvre. Dans la filière cinématographique par exemple, avec le nombre grandissant de coproductions internationales, il est de plus en plus difficile de déterminer la nationalité d’un film. Un film signé d’un réalisateur français, co-écrit par un Américain, tourné en anglais, aux États-Unis, avec des acteurs américains, nigérians et français, peut-il toujours être considéré comme un film français ? Pour certains dispositifs nationaux d’aide et de financement des productions audiovisuelles et cinématographiques et dans le cadre de certains festivals comme celui de Cannes en France, c’est la nationalité du réalisateur qui prime sur celle du pays ayant majoritairement financé la production de l’œuvre.
Dans le secteur de la musique, et plus spécifiquement au Québec, les critères servant à déterminer l’origine d’une piste ont été spécifiés par les associations professionnelles de la musique. Ainsi, deux éléments sur trois doivent être québécois au niveau artistique : soit l’auteur (Paroles), le compositeur (Musique) ou l’artiste principal. De même, deux éléments sur trois doivent être québécois au niveau industriel : soit le producteur initial, l’éditeur ou la Maison de disques. Par ailleurs, lorsque plus d’un individu font partie d’un même élément (par exemple, s’il y a plusieurs compositeurs), le statut québécois est attribué à cet élément s’il y a au moins un individu considéré québécois parmi eux. L’attribution du statut d’origine québécoise des individus au titre de créateur (artiste ou collectif d’artistes) est qualitative et repose sur un ensemble de critères de base, tels que : son lieu de naissance ; le lieu où il a grandi ; le lieu où il a débuté sa carrière ; le lieu où il réside ; s’il a une pratique artistique qui s’est développée spécifiquement et/ou majoritairement sur le territoire québécois ; si, de façon générale, le créateur s’identifie comme Québécois dans les cadres médiatiques de sa mise en marché ; ou s’il est considéré québécois par les médias et par des sources explicites et crédibles. À titre d’exemple, Céline Dion, Léonard Cohen, ou encore Arcade Fire sont considérés Québécois malgré leur lieu de naissance ou de résidence tandis que Daniel Lanois et Mylène Farmer ne le sont pas, malgré leur lieu de naissance au Québec99.
Pour les besoins des opérations de moissonnage de données sur les catalogues des plateformes, nous avons privilégié pour les contenus audiovisuels et cinématographiques la nationalité du réalisateur comme critère principal pour déterminer l’origine géographique de l’œuvre (en limitant le périmètre aux pays membre de la Francophonie) ; tandis que pour les contenus musicaux, l’attribution du statut d’origine francophone a été simplifiée et réduite à trois principaux critères d’échantillonnage : soit la nationalité (pays d’origine) de l’artiste principal, la prédominance de la langue française dans son œuvre et/ou la notoriété (reconnaissance sur la scène internationale) de l’artiste, de l’auteur ou du compositeur en tant que francophone.
Sur le plan technique, l’étape de collecte de données a été rendue opérationnelle par l’usage d’un outil de collecte (logiciel de moissonnage ou Web Crawler) qui utilise les interfaces de programmation applicative (ou en anglais Application Programming Interface - API100) des différentes plateformes étudiées afin d’en extraire, à partir de requêtes ciblées (principalement par mots-clés), les données les plus pertinentes pour notre recherche. Les API retournent les résultats des requêtes sur les catalogues des plateformes dans un format brut (json101). Ces données brutes non structurées sont ensuite triées, uniformisées, raffinées et rendues manipulables et facilement exploitables grâce à une interface de visualisation (Excel). Cette interface est ensuite utilisée pour construire les données de référence à partir desquelles s'organisent les données d'analyses et les exports.
En ce qui concerne la notion même de plateforme, son utilisation dans le cadre de cette étude renvoie à la définition de Nick Srnicek qui les considère comme : « des infrastructures numériques qui permettent à deux ou à plusieurs groupes d’interagir. Elles agissent donc comme intermédiaires entre différents usagers : clients, annonceurs publicitaires, prestataires de services, producteurs, fournisseurs et mêmes des objets physiques. […] La plateforme se positionne à la fois entre des usagers et comme le terrain même où se tiennent ces activités ».102 L’auteur dégage cinq grands types de plateformes : la plateforme publicitaire (Google, Facebook), la plateforme nuagique (cloud platforms : Amazon Web Services, Salesforce), la plateforme industrielle, (GE, Siemens), la plateforme de produits (Spotify), la plateforme allégée (Uber, Airbnb).
Les deux types de plateformes pertinentes pour notre étude et sur lesquelles notre attention s’est focalisée sont principalement la plateforme de produits et la plateforme publicitaire. La première catégorie « utilise d’autres plateformes pour transformer les marchandises traditionnelles en services sur lesquels elle peut collecter des frais de location ou de souscription103 », comme le fait Netflix. La plateforme publicitaire a quant à elle pour fonction d’« extraire l’information de ses usagers et d’en faire l’analyse, pour ensuite utiliser le résultat de ce processus et vendre de l’espace publicitaire104 », comme c’est le cas pour YouTube/Google, mais aussi pour les offres de services gratuits (freemium) de plusieurs plateformes de streaming comme Deezer.
1.2. Le contenu francophone audiovisuel et musical en quête d’exposition : des réalités contrastées d’un secteur à l’autre
Les résultats du forage de données sur YouTube indiquent que dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma, à peine 2 % des films francophones soutenus et financés par le Fonds Image de l’OIF entre 2014 et 2019 sont présents en ligne. En effet, sur un échantillon de 54 films, seul le film « Félicité » du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis est disponible et accessible sur YouTube. Par ailleurs, sur les 15 fictions long métrage figurant dans le palmarès des Étalons d'or, d'argent et de bronze (pour les éditions de 2009, 2011, 2015, 2017, 2019) du FESPACO, seuls 2 films francophones sont disponibles sur YouTube, notamment « Pégase » du réalisateur Marocain Mohammed Mouftakir et « Félicité » d’Alain Gomis. Sur l’ensemble des listes de films lauréats du Fonds Image de l’OIF, du FESPACO et du Festival international de cinéma Vues d’Afrique, aucun film ne figure dans les catalogues de Netflix (même pas dans les catalogues Netflix des pays d’origine de ces films). Cependant Netflix va de plus en plus à la conquête des publics francophones, notamment en Afrique, en investissant davantage dans le sous-titrage en français de ses productions originales en langue anglaise ainsi que pour ses nouvelles acquisitions de films produits par l’industrie nigériane Nollywood ; des films qui ont un certain succès auprès des auditoires des autres pays francophones de l’Afrique subsaharienne.
D’ailleurs, selon Digital TV Research, Netflix occupe déjà 45 % des parts de marché sur les services de vidéo à la demande avec abonnement en Afrique subsaharienne et pourrait atteindre 4 millions d’abonnés africains d’ici 2023105.
Tableau 1 – Présence des films francophones sur les plateformes Netflix et YouTube, juin 2019
Tableau 2 – Top 5 des films francophones africains, les plus vus sur YouTube, juin 2019
Source : YouTube, Compilation à partir de mots-clés
La situation est beaucoup plus rayonnante dans le secteur de la musique, où on a pu observer par exemple que sur les 32 lauréats des Prix Découvertes RFI entre 1981 et 2017, 96,87 % des artistes francophones sont présents sur YouTube ; 93,75 % sur iTunes et 91 % sur Spotify.
Tableau 3 – Présence des artistes et de leurs titres de musique francophones sur les plateformes YouTube, iTunes et Spotify, juin 2019
Tableau 4 – Top 5 des pièces musicales francophones les plus vues sur YouTube, juin 2019
Notons que des requêtes effectuées sur la même période (juin 2019) sur YouTube, mais élargies à l’ensemble des artistes africains (sans restriction géographique aux artistes originaires de pays francophones) révèlent une domination du top du classement par des artistes anglophones nigérians très populaires sur le continent comme : 1) Davido (132 620 204 vues pour la vidéo officielle de son titre « Fall ») ; 2) Yèmi Aladé (104 998 404 pour le clip vidéo du titre « Johnny ») ; 3) Tekno (101 471 940 de vues pour « Pana ») ; Chidinma (60 850 818 vues pour le clip vidéo de « Fallen in Love »).
Sur la plateforme Deezer, on observe que les 3 artistes francophones africains les plus recommandés font partie des plus anciens lauréats du Prix Découvertes RFI, dont les œuvres jouissent d’une certaine popularité. Il s’agit notamment de l’artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly (présents sur 33 playlists), le Congolais Zao (30 playlists) et la Malienne Rokia Traoré (20 playlists).
Tableau 5 – Présence des Lauréats du Prix Découvertes RFI Musique dans des playlists de Deezer
Une étude de cas plus approfondie sur la découvrabilité des contenus francophones a été réalisée sur la plateforme Deezer. L’intérêt de cette étude de cas se justifie par le fait que l’entreprise française, considérée comme le 3e acteur mondial du streaming (derrière Spotify et Apple Music106), compte 15 millions d’utilisateurs dans plus de 180 pays, incluant (contrairement à ses concurrents107) la plupart des pays francophones et africains108 depuis 2012.
Deezer revendique ainsi sa place de leader sur le marché musical francophone et vante, dans ses communications publiques, la capacité de son système de recommandation109 à favoriser la diversité culturelle. Dans une interview accordée en juin 2019 au Parisien, Louis-Alexis de Gemini, le directeur général France de Deezer France confiait notamment ceci :
« […] Avec 53 millions de chansons, nous avons le plus grand catalogue de musique au monde. De plus, je pense que notre application permet d'avoir la meilleure expérience utilisateur du marché. Notre niveau de recommandation est fort. Sur Deezer, on propose en permanence de découvrir de la musique. […] Nos équipes sont chargées de qualifier les dizaines de milliers de chansons reçues chaque semaine par auteur, compositeur, genre musical, maison de disques, rythme, ambiance générale, niveau de qualité et public visé. Les algorithmes se nourrissent de ces données pour recommander des morceaux à chaque utilisateur, selon ses goûts… »110.
Afin de vérifier à quel point Deezer connaît bien ses utilisateurs francophones et prend en compte leurs préférences, nous avons réalisé quotidiennement des tests sur la plateforme entre octobre et décembre 2019, afin de simuler des interactions à partir de la création de 24 profils-types d’utilisateurs francophones répartis dans 3 pays francophones (Cameroun, France et Canada/Québec) sur trois continents différents. Les profils créés sont ceux de personnes fictives (Personas en anglais) auxquelles nous avons assigné une série d’attributs (artistes préférés, style et genres de musique préférés, préférence de langue), reflétant les caractéristiques et représentations du public cible francophone.
Pour chaque profil d’utilisateur, des goûts musicaux (plus ou moins homogènes et très spécifiques) ont été également assignés : musiques africaines (notamment l’Afrobeat, le Ndombolo du Congo et le Zouglou de la Côte d’Ivoire), le Rap/Hip Hop, la Pop et l’Électro. Pour explorer le catalogue Deezer, nous avons ciblé l’univers Flow111 qui constitue un mixe de 50 % des favoris (« coups de cœur ») de l’utilisateur et 50 % de nouvelles découvertes musicales sur-mesure. Toutefois, afin de ne pas trop interférer112 dans les recommandations de la plateforme, nous avons volontairement laissé nos utilisateurs passifs (en évitant par exemple d’ajouter de nouveaux artistes « coup de cœur » au flow). Le but, ici, est de tester à quel point les découvertes113 musicales recommandées par la plateforme à partir des listes de lecture comme « Lundi Découverte » et « Nouveautés choisies pour vous » correspondraient aux goûts musicaux d’un utilisateur-type, ayant mentionné des préférences pour des artistes francophones lors de la création de son compte/profil d’utilisateur. Nous avons enregistré sur la période d’observation 261 499 recommandations pour un total de 1 333 artistes recommandés. Dans cette liste, seuls 135 artistes (soit à peine 10 % des artistes recommandés) sont originaires de pays francophones ou reliés à des titres de chansons et d’albums en français. On recense au total 33 394 recommandations de musique (chansons et albums) francophone sur les 261 499 recommandations, soit un ratio d’environ 13 %.
Tableau 6 – Artistes francophones114 les plus recommandés sur Deezer, selon les profils et goûts musicaux d’utilisateurs francophones ciblés (décembre 2019)
Comme le montre le tableau précédent (tableau 6), on retrouve dans ces recommandations beaucoup d’artistes de la scène musicale française (issus de la diaspora africaine) jouissant déjà d’une certaine popularité en France et à l’international, comme l’illustre les communautés de fans autour de leurs tubes à succès. C’est le cas notamment des artistes incarnant l’essor de la musique pop africaine (Afropop, Afrotrap) dans l’hexagone tels que : MHD, Aya Nakamura, Maître Gims, Dadju, Naza, Keblack, Hiro, Vegedream, Gradur, Sidiki Diabaté, Abou Debeing, etc.
Par ailleurs, sur l’ensemble des 135 artistes francophones recommandés, très peu proviennent de l’Afrique francophone ou d’autres pays de la Francophonie. On retrouve notamment des figures emblématiques comme Angélique Kidjo (Bénin), couronnée de cinq Grammy Awards dans la catégorie de meilleur album de musique du monde (en 2007, 2008, 2015, 2016 et 2020) ; ou Koffi Olomidé (République démocratique du Congo), connu comme le « roi du Ndombolo » et de la Rumba congolaise, vainqueur de sept Kora Awards. Cependant ces deux icônes totalisent à eux deux moins de 50 recommandations de Deezer. Or, compte tenu des préférences et goûts musicaux des profils fictifs d’utilisateurs que nous avons créés, on s’attend à voir dans les résultats des recommandations une plus grande occurrence des artistes associés aux musiques africaines ou d’autres artistes similaires ou pratiquant le même style ou genre de musique. Mentionnons tout de même la présence de plusieurs vedettes africaines reconnues à l’international comme le congolais Fally Ipupa, le groupe de rap Toofan qui fait la fierté de la musique togolaise, sans oublier les groupes de Zouglou, Magic System et Révolution, ainsi que les artistes Ariel Sheney et Bebi Philip adulés en Côte d’Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine.
Aucune des recommandations de notre échantillon ne met véritablement en lumière de jeunes talents francophones émergents, qui seraient en quête de notoriété et de découvrabilité. On doit toutefois souligner la présence (quoique faible) sur les listes de découverte Deezer de quelques nouvelles pépites de la chanson et de la musique francophone qui se sont révélées récemment via une autopromotion sur le Web, ou via des émissions de télé-crochet musical, ou encore en remportant des prix/trophées dans des festivals ou galas de musique nationaux ou internationaux.
Citons à titre d’exemple :
-
le rouennais d’origine marocaine, « Petit Biscuit » (de son vrai nom Mehdi Benjelloun) qui se définit115 comme un artiste électronique et qui s'est fait remarquer après le succès de son morceau "Sunset Lover" sur Internet ;
-
le rappeur québécois Loud116, qui a acquis sa notoriété sur le Web avant d’enchaîner une tournée solo en France et au Québec et dont la chanson Toutes les femmes savent danser a connu un important succès auprès du grand public ;
-
l’autrice-compositrice-interprète et productrice belge, Angèle (Van Laeken) qui s’est fait connaître entre 2015 et 2016 via des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et dont le premier album Brol (sorti en 2018) est certifié disque de diamant (plus de 500 000 ventes) ; elle a remporté en 2020 la Victoire de la musique du Concert de l’année et en 2019 le NRJ Music Awards dans la catégorie Artiste féminine francophone de l’année et Chanson française de l’année.
Nos analyses plus granulaires des résultats de recommandation nous amènent à la conclusion que les listes de recommandations personnalisées de Deezer qui ont la prétention de favoriser de nouvelles découvertes d’artistes et de chansons sont encore déterminées, ou à tout le moins fortement influencées, par des logiques de star-system, puisque ces recommandations semblent accorder une grande place à la popularité des chansons et à la notoriété des artistes, au détriment d’une supposée mise en avant de la diversité culturelle.
En effet, sur les 1 333 artistes recommandés au total, le haut du classement des artistes les plus recommandés est tenu par des vedettes anglo-saxonnes telles que : Drake, Kendrick Lamare, Childish Gambino, The Chainsmokers, Chris Brown, Calvin Harris, Avicii, Major Lazer, Dj Snake, Norah Jones, The Weeknd, Ed Sheeran, Beyoncé, Marroon 5 ou encore Ariana Grande. Quelques artistes nigérians (anglophones) comme Wizkid, Davido, Burna Boy, Olamide, Tekno, ou Tiwa Savage, ont réussi à imposer leur musique au-delà des frontières du Nigéria et du continent africain et s’invitent également dans le top des recommandations.
Dès lors, il n’est pas surprenant de constater, comme l’indique le tableau 7 un glissement d’erreurs ou de biais flagrants dans les recommandations de découverte de la plateforme. On voit par exemple que pour un utilisateur camerounais, amateur de Makossa, la plateforme recommande plus de 1 000 fois les artistes américains Norah Jones (qui pratiquent comme genre musical la Pop et le Jazz) et Major Lazer (Electro, Dancehall, Reggae, Hip Hop) et environ 700 fois les chanteurs de jazz canadien Diana Krall et Michael Bublé. En ce qui concerne l’amateur de Zouglou (musique populaire et urbaine née au début des années 1990 en Côte d’Ivoire), la plateforme lui recommande des artistes comme Stromae (1 523 fois), Calvin Harris (1 311), David Guetta (1 258 fois) ou Avicii (1 244). La question demeure de savoir si la non-pertinence de ces recommandations relève d’erreurs ou de choix éditoriaux assumés ou encore de biais algorithmiques. Rappelons que les biais peuvent être cognitifs, statistiques (biais des données), mais aussi économiques (dus à des manipulations volontaires de la part des entreprises, encore connues sous le nom de Search engine manipulation)117.
Tableau 7 – Exemples de biais de recommandation des listes de découverte Deezer pour des amateurs francophones de Musiques africaines (Makossa camerounais et zouglou ivoirien)
On note par ailleurs que pour chaque utilisateur-type, les trois premières recommandations sur une liste de 10 recommandations ne correspondent pas aux préférences de l’utilisateur selon le genre musical ciblé. Au contraire, les premières recommandations semblent quasi-systématiquement diriger l’utilisateur vers des hits ou tubes (tendances) de la musique pop américaine ou britannique, avec des artistes comme Camilla Cabello, Ed Sheeran ou Shawn Mendès, Dua Lipa, Justin Timberlake, ou The Chainsmokers. Dans l’exemple du tableau 8 (voir page suivante), sur 20 recommandations, on ne retrouve aucun artiste francophone.
Tableau 8 – Des recommandations orientées vers les artistes-vedettes de la musique pop occidentale, indépendamment des genres ciblés par l’utilisateur-type francophone
Malgré ces constats, les tendances de consommation musicale en 2019, révélées à travers le classement du top 10 des genres musicaux préférés dans le monde, indiquent que le public continue de plébisciter les productions et les répertoires locaux (voir Figure 5). Cela laisse suggérer que les plateformes comme Deezer ou Spotify gagneraient à recommander davantage de contenus locaux pour conquérir de nouveaux auditoires, notamment dans les pays francophones dans lesquels ils proposent leur service.
Figure 5 – Plébiscite du contenu local dans les préférences musicales du public en 2019 (IFPI, 2019)
Source118
1.3. La découvrabilité à partir de la perspective de l’offre des plateformes : au-delà de la présence, un problème de recommandation !
Les opérations de moissonnage de données et d’observation directe sur les plateformes nous confirment très clairement que la présence n’est qu’une première étape dans le processus de découvrabilité des contenus francophones en ligne. Pour que l’offre soit découvrable, il faut d’abord qu’elle soit présente, c’est-à-dire disponible et accessible sur la plateforme. La présence ne garantit pas cependant de façon systématique une découvrabilité du contenu. Le potentiel de découvrabilité du contenu n’augmente que lorsque des moyens sont pris par la plateforme (à partir de recommandation éditoriale ou algorithmique) pour exposer, rendre visible et mettre en avant les contenus sur le catalogue afin de permettre à l’utilisateur qui le recherche de pouvoir le trouver et à ceux qui n’en connaissaient pas l’existence de pouvoir le découvrir.
Parmi les facteurs qui peuvent contribuer à une bonne exposition du contenu en dehors des caractéristiques intrinsèques du contenu comme les métadonnées descriptives, on note les stratégies de marketing viral qui contribuent à amplifier l’existence de l’œuvre et la notoriété de l’artiste, à travers une promotion et une visibilité accrue sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapshat, WhatsApp, Tik Tok, etc.).
L’attention119 des utilisateurs étant devenue une denrée rare et difficile à capter dans des environnements numériques offrant un « hyper-choix », les contenus ont un avantage de visibilité en fonction de l’endroit et de la façon dont ils sont affichés et positionnés sur les pages ou interfaces d’accueil120 ou sur les listes de recommandation les plus influentes qui constituent des points d’entrée stratégiques dans le catalogue. Philippe Bouquillion souligne d’ailleurs à juste titre qu’« au sein des plateformes, la mise en visibilité s’exerce principalement grâce à des systèmes de recommandation qui sont des dispositifs algorithmiques permettant d’organiser la collecte et le traitement des données massives. Ils sont destinés à proposer de façon personnalisée des contenus convenant, en principe, aux attentes et aux goûts exprimés, ou même non exprimés, des utilisateurs des plateformes »121. On sait par exemple que 40 % de la part des ventes générées par Amazon s’appuient sur les recommandations de son moteur de recherche. De même 60 % des contenus visionnés sur Netflix sont le résultat des recommandations de la plateforme.
Au-delà de la présence du contenu et de son exposition, l’enjeu crucial pour la découvrabilité des contenus francophones en ligne est donc celui de la recommandation. Suite aux tests et mesures réalisés sur les différentes plateformes de streaming audiovisuel et musical, nous avons observé que, quelque soient leurs goûts particuliers et leurs préférences, les utilisateurs de ces plateformes sont plutôt dirigés vers des goûts conventionnels préconfigurés et vers des œuvres, des contenus ou des artistes à succès, ayant déjà fait la preuve de leur popularité auprès des usagers de la plateforme. Ainsi, selon Lucien Perticoz : « Le service rendu au consommateur correspond dès lors à un tri opéré au sein d’une profusion de contenus culturels numérisés, le but étant qu’il soit mis en relation avec ceux qui seront au plus proche de ses attentes et de ses goûts. Cette approche s’inscrirait dans une forme de personnalisation de masse des consommations culturelles et informationnelles. »122. Suivant cette logique, il y a donc moins de place à la découverte de nouveaux contenus et de nouveaux talents, notamment francophones, puisque les systèmes de recommandation semblent désormais privilégier des stratégies pouvant contribuer à construire et amplifier l’audience autour d’un contenu, quitte à créer des « effets boule de neige »123. L’algorithmisation de l’offre culturelle globale et les processus de catégorisation d’usagers et de pré-configuration de parcours de découverte sur les plateformes transnationales nuisent ainsi aux formes d’exploration autonomes et à la découvrabilité des contenus culturels francophones. Cette tendance ne s’améliorera que si les systèmes de recommandation, au lieu de fonctionner selon des logiques d’orientation vers les contenus les plus populaires, intègrent davantage des critères de diversité culturelle, susceptibles de favoriser la mise en valeur et la proéminence des contenus nationaux et locaux minoritaires. Le rapport de l’OIF sur l’Intelligence artificielle dans l’art et les industries culturelles et créatives met notamment en garde contre les risques que pourraient générer les plateformes sur l’exposition des contenus culturels francophones, au point d’affaiblir à long terme la notion d’une culture partagée124. Cependant, l’intelligence artificielle (IA) aurait ici un rôle à jouer du point de vue de la transparence dans le fonctionnement des algorithmes de recommandation automatisée qui influencent les usages et la consommation culturelle. Des solutions pourraient être apportées pour améliorer la découvrabilité de contenus culturels diversifiés en ligne, tout en prenant en compte des préoccupations relatives à la visibilité, à la mise en valeur des talents francophones, à la création en interaction avec les machines et au respect des droits de propriété intellectuelle des créateurs et artistes francophones.
L’accent devrait donc être mis sur les efforts d’éditorialisation et de qualification des contenus en amont à leur hiérarchisation et à la structuration de l’offre illimitée des catalogues. Ce travail permettra, par exemple, de mieux identifier les qualités et propriétés intrinsèques aux contenus francophones de qualité, de sorte à les corréler plus efficacement et de façon plus pertinente avec les préférences et intérêts des utilisateurs, sans pour autant que ce processus ne soit entièrement, ni systématiquement, automatisé. Comme le suggèrent Joëlle Farchy, Cécile Méadel et Arnaud Anciaux :
« Pour fournir des recommandations, même sous une forme algorithmique, les dispositifs doivent opérer une qualification préliminaire des contenus et des utilisateurs qui ne peut être intégralement automatisée. Figure d’abord la catégorisation, généralement effectuée par genres avec des degrés de granularité fort divers, regroupant nouveautés et derniers ajouts et reposant sur un certain nombre de mots-clés et métadonnées. »125
2. Focus sur les habitudes de consommation culturelle des internautes francophones
Cette sous-section de l’étude présente les principaux résultats de notre enquête par questionnaire électronique sur les habitudes de consommation culturelle des internautes des pays francophones. Nous rappelons que 231 personnes de 20 nationalités différentes de l’espace francophone ont répondu aux questionnaires. Leurs réponses permettent de comprendre les modes d’accès et de découverte de contenus culturels francophones sur Internet. Nous en rapportons ici le récapitulatif sous forme de dix faits saillants, illustrés par divers graphiques.
2.1. Le téléphone mobile : principal dispositif d’accès aux contenus sur Internet
Figure 6
61,47 % des répondants déclarent utiliser le téléphone comme principal dispositif ou équipement pour accéder à Internet. Pour se connecter à Internet, 26,41 % privilégient encore l’ordinateur portable et 7 % l’ordinateur de bureau.
En ce qui concerne spécifiquement les dispositifs ou équipements utilisés le plus souvent pour consommer (accéder, voir, écouter ou lire) des contenus culturels francophones en ligne, 43,30 % de notre échantillon déclare utiliser « très souvent » le téléphone intelligent et 35,65% l’ordinateur. La télévision est le troisième dispositif le plus utilisé (15,49 %) devant même la tablette (10,45 %). Le recours aux ordinateurs, à la télévision et aux tablettes constitue le mode le plus adapté pour visionner des contenus audiovisuels, surtout les films et séries. Les téléphones sont souvent utilisés pour l’écoute de la musique et le visionnement de vidéos de courts formats, surtout en contexte de mobilité.
Figure 7
2.2. Le visionnement de films et de séries s’impose comme l’activité culturelle favorite en ligne des internautes francophones
Figure 8
2.3. Une prédisposition des internautes francophones à consommer une variété de contenus culturels en ligne
Parmi les contenus culturels numériques francophones qui suscitent le plus l’intérêt du panel de répondants, on observe un intérêt très net (65,80 %) pour la consommation de contenus musicaux francophones. Viennent ensuite par degré d’appréciation : les films francophones (36,80 %), les séries et mini-séries (34,63 %), ainsi que les émissions ou programmes télévisuels diffusés en ligne comme les téléréalités, les émissions culinaires et sportives, le divertissement, etc.).
Par ailleurs 87 % des sondés affirment qu’il leur arrive très souvent, chaque mois, d’être à la quête de nouveaux contenus (surtout la musique et les films) à découvrir en ligne.
Figure 9
2.4. Internet, média incontournable pour la découverte des œuvres et talents francophones
Avec 71,43 % des réponses au sondage, l’Internet s’impose comme le média par excellence pour la découverte de nouveaux artistes, de nouveaux talents et des diverses formes d’expressions culturelles francophones en ligne, et ce loin devant les médias traditionnels comme la télévision et la radio qui demeurent néanmoins encore à l’origine de la découvrabilité des œuvres et des artistes francophones dans 21 % de cas.
2.5. YouTube, désignée comme plateforme no 1 de la découvrabilité culturelle francophone
À la question de savoir quelle plateforme ou application leur permet le plus souvent de découvrir et d’accéder facilement à des contenus francophones correspondant à leurs goûts et préférences, la majorité des répondants (51,52 %) portent leur choix sur YouTube. Rappelons que l’audience de YouTube est de l’ordre de 1,5 milliard d’heures par jour, environ 10 % de l’audience mondiale de la télévision ; ce qui fait de cette plateforme « le service audiovisuel agrégeant la plus grande audience dans le monde » 126. Le choix de YouTube par les enquêtés s’explique principalement par le fait qu’il s’agit d’une plateforme de contenu généré par les utilisateurs (ou User Generated Content en anglais), accessible gratuitement et proposant l’accès à une variété et à une diversité de contenus. Spotify occupe la deuxième place des plateformes les plus favorables à la découverte des contenus francophones (choix de 18,61 % des enquêtés). Netflix n’apparaît qu’en troisième position du classement, avec seulement 5,63 % des réponses. Le service iTunes recueille 5,19 % du vote, tandis que Google Play (3,46 %) et Deezer (2,60 %) se partagent quelques fans. Amazon est le bon dernier du classement, ne comptabilisant aucun vote.
Figure 10
2.6. Les francophones ouverts à la diversité linguistique en ligne et à la cohabitation entre contenus étrangers et contenus nationaux
Seuls 37,23 % des consommateurs culturels francophones ayant participé à cette enquête déclarent être plus attirés par les contenus culturels francophones (africains, français, belges, québécois, etc.) que par des contenus étrangers (contenus américains ou d’autres espaces linguistiques non francophones). Près de la moitié des répondants (49,78 %) semblent ne pas voir d’inconvénient à une cohabitation entre contenus étrangers et contenus nationaux/locaux. 13 % de personnes n’ont pas d’avis sur cette question.
Figure 11
2.7. Les facteurs déterminants la découvrabilité de l’offre culturelle francophone en ligne, selon les répondants
Il a été demandé aux participants au sondage de classer les éléments qui, selon eux, favorisent le mieux la découverte des contenus francophones. Voici par ordre d’importance les facteurs les plus déterminants de la découvrabilité de l’offre culturelle francophone en ligne d’après la moyenne des scores de classement des répondants :
-
l’exposition, la visibilité et la mise en valeur du contenu sur les interfaces ou pages d’accueil et dans les listes de recommandation éditorialisées du catalogue ;
-
les recommandations personnalisées des algorithmes ;
-
l’amplification du succès de l’œuvre via le marketing viral ou l’autopromotion ;
-
les bonnes critiques et la qualité de l’œuvre ;
-
la qualité des métadonnées et le référencement via les moteurs de recherche ;
-
la popularité ou la notoriété de l’artiste ;
-
la promotion de l’œuvre ou de l’artiste via les médias traditionnels (télévision, radio,…) ou via des événements comme des festivals ;
-
les recommandations des proches via les réseaux sociaux ;
-
les recommandations via le bouche à oreille ;
-
l’exposition de l’œuvre sur les présentoirs et dans les vitrines des magasins physiques.
2.8. Les freins et obstacles à la découverte et la consommation des contenus culturels des pays francophones sur Internet
Parmi les facteurs identifiés comme étant des freins ou obstacles à la découverte et à la consommation des contenus culturels des pays francophones sur Internet, on note par ordre d’importance décroissante :
-
la quantité limitée des œuvres et contenus francophones de qualité en ligne ;
-
les coûts élevés d’abonnement Internet et d’accès aux différentes plateformes/applications payantes de diffusion/distribution de contenus culturels ;
-
le piratage et les contraintes/barrières liées aux transactions électroniques de biens et services culturels en ligne (comme le manque de structuration de l’offre ou la faible bancarisation des populations dans les pays francophones du Sud) ;
-
la qualité du débit ou de la bande passante Internet ;
-
le manque de compétences numériques des créateurs/artistes et professionnels de la culture en matière de création, de commercialisation et de promotion de leurs œuvres en ligne ;
-
le manque de professionnalisation et la faible compétitivité des différentes filières des industries culturelles francophones.
2.9. Primauté à la gratuité d’accès à la culture !
Parmi les types d’accès aux contenus culturels, la majorité (67,97 %) du panel d’internautes francophones ayant participé à notre enquête accorde une priorité aux plateformes donnant gratuitement accès à un nombre illimité de contenus présents sur le catalogue. 25,11 % des internautes sondés sont prêts à payer pour accéder à des offres culturelles numériques illimitées, tandis que 3,03 % déclarent opter pour un « accès informel » et utilisent des moyens détournés pour accéder et partager des contenus en illimité.
Figure 12
Toujours est-il que si l’accès à du contenu illimité pour un bas prix mensuel semble avoir baissé les coûts de consommation culturelle, « dans les faits, les consommateurs paient beaucoup plus qu’il y a vingt ans pour accéder à ces contenus supposément gratuits » et cela paraît encore plus évident lorsqu’on fait « l’addition [des] factures mensuelles de câblodistribution, internet et téléphonie mobile, [et] les divers coûts [des] innombrables bidules (ordinateur personnel, télévision à écran plat, tablette, téléphone portable, etc.) »127.
2.10. Promotion, monétisation d’audience et croissance des revenus pour les artistes et créateurs francophones
Nombreuses sont encore les personnes qui sont convaincues que la présence sur Internet ne suffit pas pour permettre à un artiste ou un créateur d’accroître ses revenus et de vivre de son art. En effet, 48,48 % des personnes interrogées estiment que les prestations payantes (tournées, concerts, projections en salle, festivals, etc.) constituent encore le principal moyen pour permettre aux artistes et créateurs d’accroître leurs revenus. Cela n’exclut pas de compléter ce genre de prestations avec une véritable stratégie de présence et d’engagement interactif du public, à travers la constitution de communautés de fans, par exemple. Des moyens de promotion classique tels que le passage sur des plateaux de télévision ont toujours aussi la côte (12,55 % des choix de réponse des enquêtés) et continuent de contribuer à faire connaître les artistes et à susciter la curiosité pour prolonger la découverte et la consommation de ses œuvres en ligne.
Figure 13
3. La découvrabilité en pratique : des perceptions à la réalité expérimentée par des artistes, créateurs et autres professionnels de la culture au sein de la francophonie
Nous présentons ici les résultats des entrevues semi-directes individualisées réalisées durant les mois de septembre à décembre 2019 auprès de 30 artistes et professionnels francophones (chanteurs et interprètes, auteurs-compositeurs, acteurs, humoristes, agents d’artistes, managers, promoteurs, réalisateurs-producteurs et distributeurs), intervenant dans différents secteurs des industries culturelles de cinq pays membres de la Francophonie (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Canada/Québec, Togo).
Nous proposons de regrouper de manière synthétique les principales observations communes ainsi que les spécificités sectorielles et/ou géographiques liées aux perceptions et aux pratiques des acteurs interviewés en matière de découvrabilité, en ciblant trois principaux thèmes sur lesquels s’appuieront nos analyses, à savoir : 1) les expériences et pratiques d’utilisation d’Internet à des fins de découvrabilité des œuvres artistiques et culturelles francophones ; 2) les défis, obstacles et opportunités liés à la mise en valeur et à la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne ; 3) les propositions, pistes de solutions et perspectives futures.
3.1. Expériences et pratiques d’utilisation d’Internet et des outils numériques à des fins de découvrabilité culturelle francophone
De manière générale, on constate dans les pays où nous avons réalisé nos entrevues qu’il existe deux générations d’artistes et de professionnels des industries culturelles, si l’on prend pour référence les trois dernières décennies ayant caractérisé l’émergence et le développement des usages d’Internet ainsi que son irruption dans le domaine de la culture et des arts créatifs.
On distingue d’une part la génération des artistes-créateurs et professionnels milléniaux (nés entre les années 1980 et 2000), présents sur Internet et les réseaux sociaux numériques, et ayant une compréhension assez avancée des enjeux liés au numérique. Ils sont plus ou moins familiers à l’utilisation d’outils numériques dans leurs activités de création et de production ou de diffusion et de distribution. D’autre part, il y a la génération plus ancienne de travailleurs culturels, exerçant leur métier depuis plus d’une trentaine d’années et qui ont démarré leur carrière à un moment où l’Internet n’existait pas encore. Les artistes et professionnels de la culture faisant partie de cette ancienne génération fonctionnent encore beaucoup selon les codes traditionnels liés à leur métier et ont plus de mal à s’adapter aux impacts des technologies numériques sur leurs activités professionnelles.
Il y a donc un besoin crucial en matière de formation et de développement des compétences numériques (littératie numérique) pour de nombreux acteurs des milieux culturels francophones, qui utilisent encore peu l’Internet et les outils numériques à des fins de création, de production, de promotion, de diffusion et de distributions d’œuvres artistiques. Quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent, les acteurs des industries culturelles francophones sont unanimes sur les apports de l’Internet dans l’amélioration de leurs pratiques.
À la question de savoir s’il utilise Internet dans la production de ses œuvres, l’humoriste ivoirien Kôrô Abou (de son vrai nom Aboudramane Dramé), qui a fait les beaux jours des séries télévisées « Cour commune » et « Ma famille » répond ceci :
« Bien sûr, on n’a pas le choix. Vous savez, le monde de la technologie évolue tellement vite aujourd’hui et est pratiquement le carrefour de toutes les activités économiques ; […] Pour nous les artistes, l’Internet constitue aujourd’hui pratiquement 40 % de nos activités. C’est un outil très bénéfique, puisqu’avec l’Internet j’ai un accès direct à mes fans qui découvrent mes œuvres plus facilement sur les réseaux sociaux et qui m’apportent aussi leur soutien par des critiques constructives […] ».
Il poursuit en expliquant que :
« Avec l’Internet, le nombre de vues de nos vidéos humoristiques ont augmenté et on n’est plus obligé d’aller faire la file devant une chaîne télé pour tenter de rencontrer un responsable de la programmation qui décidera ou non de faire passer nos contenus. Directement, à partir de nos ordinateurs, et avec une connexion fiable, on peut rejoindre nos publics…Qui dit artiste, dit aussi fans. Mais, si les fans censés nous apporter leur soutien n’ont pas accès ou ne voient pas nos créations, on est perdu ».
En effet, les artistes ont compris que les auditoires ont déplacé leur attention, des médias traditionnels comme la télévision vers les nouveaux médias numériques. Or, désormais pour qu’une œuvre vive, elle doit rencontrer son public et il importe d’aller trouver les publics là où ils sont le plus présents et actifs, notamment sur les réseaux sociaux. Le comédien-humoriste, Adama Dahico, également Directeur et Fondateur du Festival International du Rire d’Abidjan (FIRA) depuis 2003, témoigne aussi des effets de la révolution numérique dans le domaine de la promotion des activités culturelles :
« Aujourd’hui, on peut rester chez soi et balancer une affiche de spectacle qui, en moins d’une heure, va faire le tour du monde. À l’époque, il fallait chercher des papiers Kaki ou des tissus et écrire là-dessus pour annoncer que vous jouiez dans tel ou tel autre endroit. Aujourd’hui, l’Internet, c’est donc une réalité qui s’impose à nous. Si on veut vraiment conquérir le monde, on est obligé de compter sur tout ce qui est numérique ».
Le passage de l’analogique au numérique impose maintenant à des producteurs et managers ainsi qu’à des techniciens du son de recourir fréquemment à l’utilisation de certains logiciels et outils technologiques depuis leur studio moderne dans la mesure où « maintenant, on n’est plus dans les bandes magnétiques comme avant ; tout est à présent synthétisé et numérisé », comme le souligne le Manager ivoirien Mister Amley.
Internet facilite ainsi le travail de l’artiste. Il n’a jamais été autant possible que par le passé de produire et de créer de nouveaux contenus culturels numériques pertinents. Le rôle des médias traditionnels ne doit certes pas être minimisé, mais le numérique apporte une valeur ajoutée au travail des artistes francophones, en stimulant leur créativité. Les plateformes numériques telles que YouTube, Instagram, Facebook, Tweeter, Snapchat et bien d’autres, sont utilisées comme instruments d’autopromotion et de diffusion des productions et réalisations. Quelques artistes (surtout ceux des pays francophones du Nord) sont plus familiers à des outils plus professionnels tels que SoundCloud128, BandCamp129, MusicBrainz130 ou encore Last.fm. Ne pas s’adapter aux nouveaux usages et aux possibilités offertes par Internet et l’environnement numérique constitue donc une forme d’isolement vis-à-vis des fans qui, de leur côté, utilisent de plus en plus les technologies numériques comme principale passerelle d’accès et de découverte de contenus culturels.
Malgré les avantages qu’offre l’utilisation d’Internet pour la production, la diffusion et la distribution d’œuvres culturelles et artistiques, « les artistes n’ont pas encore pris pleinement conscience de l’importance et du potentiel du numérique dans leur carrière », selon l’artiste chanteur ivoirien Ramzi, l’un des participants à notre enquête. La très grande majorité des acteurs interviewés ne disposent même pas de site Internet. Ceux qui ont eu l’idée d’en créer un ne l’animent pas tout le temps. Les propos de plusieurs artistes confirment ce point de vue. C’est le cas du comédien Adama Dahico :
« J’avais un site internet. Je crois d’ailleurs que je suis l’un des premiers comédiens ivoiriens à avoir créé son propre site web avant 2010, plus précisément en 2008. Mais cela fait plusieurs années que le site est hors ligne pour faute de maintenance et d’actualisation. Donc, on fonctionne plutôt en Facebook ».
Beaucoup d’artistes délaissent ainsi les sites Internet au profit de la création de pages de profils sur les réseaux sociaux, car ils considèrent que les sites Internet demandent beaucoup de travail pour peu de visites, contrairement aux réseaux sociaux où on est « dans de l’instantané, du direct et du viral ».
La notion de découvrabilité est clairement confondue à de la promotion ou du marketing. Les artistes, en particulier ceux de l’Afrique francophone, considèrent qu’ils sont découvrables dès qu’ils assurent une présence sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, et parfois Twitter ou Snapchat). L’artiste togolaise Chaneben, chanteuse et présidente des artistes Gospel au Togo déclare utiliser Internet pour se faire connaître, mais essentiellement par le biais des réseaux sociaux :
« Nous nous servons des réseaux sociaux pour faire des annonces en lien avec nos concerts et spectacles. Pour le moment, c’est sur les médias sociaux que nous pouvons faire la promotion de nos œuvres. À mon niveau, ce sont les promoteurs qui partagent et font du placement de nos produits. Ils sont dans plusieurs réseaux tels que WhatsApp, Facebook et ils sponsorisent nos œuvres en les relayant dans leurs communautés. D’autres partenaires nous aident dans la conversion de nos productions afin qu’elles soient compatibles et publiables sur les différentes plateformes numériques auxquelles nous sommes abonnés et sur lesquelles nous avons une page d’artiste. Nous avons également des chroniqueurs qui écrivent des billets publicitaires pour faire connaître nos œuvres ».
Pour la plupart des personnes interviewées, la découvrabilité se résume donc à une plus grande accessibilité et visibilité des œuvres par les fans et le grand public. S’engage alors une véritable course au marketing digital. Cette situation est illustrée par les propos de Julien Cangelosi, Président de 10 000 Codeurs Côte d’ivoire et Fondateur de la firme de marketing digital YesWeCange :
« Effectivement, aujourd’hui les artistes sont en permanence en train de faire de la publicité. Ils essaient constamment de maintenir le contact avec leurs communautés et leur base de fans virtuels. Rendre plus visibles tout le contenu qu’ils créent, c’est devenu un enjeu vital ; c’est une question de survie. En effet, le besoin de construire une communauté est une condition sine qua none pour espérer faire de la monétisation d’audience… Parce que les marques s’intéressent, malheureusement, au nombre de followers de ces artistes, au nombre de partages, de likes, et à comment ils fédèrent leur communauté. Et du coup c’est un peu la course au nombre de followers, une activité chronophage qui parfois peut réduire le temps et la qualité à accorder en amont à la création. Et finalement, c’est pour ça qu’il y a très peu d’artistes qui sont découverts surtout en Afrique francophone, car ils passent plus leur temps à vouloir créer du buzz plutôt qu’à développer des contenus de haute qualité professionnelle, véritablement attractifs et monétisables. Dans la filière de la musique en Côte-d’Ivoire, les artistes se retrouvent parfois contraints de s’auto-pirater en rendant leurs titres gratuitement disponibles sur des plateformes de téléchargement illégal, pour que les DJ puissent les télécharger et puissent les jouer dans les maquis ou en boîte de nuit, afin qu’ils soient découverts. Si le DJ les joue, ça va prendre, et si ça prend, les marques vont s’y intéresser ; les salles de spectacle vont les appeler, et du coup ils vont être invités à faire la tournée des boîtes de nuit, des cérémonies de mariages, et vont pouvoir faire de la scène… Ce sont ces prestations qui leur rapportent plus de revenus et non la mise en ligne de leurs contenus puisqu’il n’y a aucune véritable stratégie de monétisation derrière ».
En ce qui concerne le secteur cinématographique, que ce soit au Burkina-Faso et dans toute l’Afrique francophone en général, force est de constater que le numérique a redonné une seconde vie à la production cinématographique d’Afrique francophone qui avait fortement baissé du fait de la fermeture de guichets de financements131. En effet l’arrivée du numérique au début des années 2000 a considérablement réduit les coûts de production et si certains puristes du cinéma d’Afrique francophone et burkinabè en particulier refusaient de tourner des films avec du numérique, beaucoup ont fini par emboiter le pas après que de jeunes réalisateurs ont commencé à produire en numérique. Des réalisateurs bien connus en Afrique de l’Ouest francophone indiquent publiquement les apports du numérique pour le cinéma, notamment en matière de baisse des coûts de production. Dans le cadre d’une entrevue accordée au Fespaco Newsletter, le réalisateur malien Adama Drabo, répondant à la question de savoir si les cinéastes africains s’intéressent aux technologies numériques, affirmait ceci :
« Bien sûr que oui. Comment ne pas s’y intéresser, ne serait-ce que pour les connaître, à défaut de posséder cette technologie des plus pointues qui, plus est, offre d’énormes avantages en termes de coût et de temps. C’est le cas en matière de montage où un système d’ordinateur fait tout le travail. Le film est carrément monté avec les effets, les dialogues et la musique, puis envoyé au laboratoire d’où le produit sortira avec, en prime, une économie de temps et de moyens !»132.
Ainsi, le numérique a permis de faire des films avec nettement moins d’argent et le travail se fait essentiellement sur place en Afrique au lieu d’être envoyé en Europe dans le cadre de la postproduction qui consommait une grande partie des budgets des films.
S’agissant des usages d’Internet dans le milieu cinématographique133, ils varient selon les métiers concernés, qu’ils s’agissent de la réalisation, de la production, de la diffusion ou de la distribution. Il existe des représentations134 et des usages spécifiques en plus de certains aspects communs. Selon le réalisateur Dao Soungalo, Internet leur permet de mieux bonifier leurs œuvres et de réduire le temps de production, tout en produisant des films de qualité, comme les films documentaires.
« C’est un moyen de recherche complémentaire pour nous, car dans un film documentaire, il faut donner des informations justes, vraies et fiables et l’Internet nous permet par exemple d’affiner nos recherches d’information et de mobiliser la documentation nécessaire sur un sujet ou les informations techniques sur un lieu ou un plan de tournage. »
Pour d’autres, Internet permet de saisir des opportunités de participation à des festivals ou obtenir des subventions. À noter que certains producteurs ont des sites Internet où ils diffusent des extraits de films pour en faire la promotion. C’est le cas de PILUMPIKU production et aussi de l’Institut Imagine créé par Gaston Kaboré et qui fait la promotion des films des stagiaires sur le site Internet de l’Institut.
Dans le cadre des activités reliées au métier de la production, Internet permet aussi de coordonner le travail. Selon le producteur-distributeur Rodrigue Kaboré « Les recherches effectuées sur Internet permettent d’enrichir le script ou scénario d’un film et de le partager via WhatsApp par exemple avec l’ensemble des acteurs ou personnages concernés. ». En termes d’apport du numérique, Privat Tapsoba, un autre professionnel burkinabé du milieu estime qu’ : « on doit avoir des logiciels spécialisés pour faire de bons films. Aujourd’hui, au Burkina-Faso, on crée de plus en plus d’effets spéciaux dans les films que nous réalisons et ceci grâce notamment à des outils numériques modernes et plus adaptés ». Les pratiques dans le secteur de la distribution cinématographique au Burkina Faso sont également très affectées par le numérique, comme le confirme Rodrigue Kaboré :
« Aujourd’hui, avec le numérique, l’accès à certains films devient plus compliqué pour les distributeurs burkinabé, surtout les films occidentaux. Le nombre de films s’est multiplié mais l’acquisitionde certains d’entre eux est compliqué car à l’ère de la dématérialisatiion des suports physiques, il faut désormais disposer de fichiers numériques appelés "DCP" (Digital Cinema Package). Or le DCP coûte cher, environ 100 millions de FCFA sans compter les frais associés type installation, TVA, etc. Et pourtant le DCP donne des avantages même en transparence dans la gestion du film puisque le dispositif permet de connaitre quand le film a été reçu, le nombre de visionnage du film. Ce sont là des enjeux importants en termes de distribution et de diffusion de films. Jusqu’à présent au Burkina Faso, à part les salles étrangères comme celles de Canal Olympia, aucune salle de cinéma burkinabè ne dispose de DCP. Moi je prenais des films chez un distributeur français "films 26" mais depuis l’arrivée du DCP j’ai dû arrêter notre collaboration parce que je n’ai pas d’installation adaptée pour recevoir ses films » 135.
Au niveau de l’utilisation de réseaux sociaux numériques comme Facebook pour la promotion de films, certains producteurs disent avoir créé une page Facebook mais reconnaissent ne pas avoir les moyens de recruter une personne ou plusieurs pour l’animer. Et donc les usages se résument parfois à l’envoi de liens vers leurs films à des amis sur Facebook. Mamounata Nikiema, Directrice de PILUMPIKU production explique que sa société n’a pas de site Internet, mais une simple page Facebook dédiée. Elle utilise par ailleurs sa page Facebook personnelle pour diffuser des informations concernant la maison de production :
« Sur la page Facebook de ma société il y a l’actualité du cinéma mais à travers ce que fait la société de production : si on a des formations, si on a un casting, s’il y a des films produits par la société et qui sont sélectionnés dans un festival nous l’annonçons sur la page Facebook. »
3.2. Défis, obstacles et opportunités liés à la mise en valeur et à la découvrabilité des contenus culturels francophones sur Internet
Les entrevues révèlent un certain nombre de défis et obstacles perçus par les acteurs culturels francophones interviewés. Parmi ces défis et obstacles, ceux qui reviennent le plus souvent dans les préoccupations des acteurs sont la barrière que constitue la langue française, le piratage des œuvres numériques, le manque de compétences numériques des acteurs culturels et leur faible capacité de négociation avec les plateformes en ligne, les coûts élevés d’accès à Internet ainsi que la faible connectivité (lenteur du débit). Ces deux derniers éléments constituent une source d’accentuation de la fracture numérique, une problématique symptomatique de l’inégal accès et de la faible consommation en ligne des contenus culturels francophones. Seuls quelques-uns de ces défis, qui peuvent aussi se transformer en opportunité pour la découvrabilité, seront traités ci-dessous.
Considérons d’abord la question de la langue française. La question qui se pose ici est de savoir si le français constitue un obstacle pour une meilleure circulation et pour la découvrabilité des contenus culturels francophones, y compris hors de l’espace linguistique francophone. En effet, il est tout à fait légitime de s’interroger quant à savoir si les produits musicaux et audiovisuels nationaux ou locaux francophones qui obéissent souvent à des ancrages sur des aires géoculturelles spécifiques peuvent aujourd’hui, à l’ère du numérique, aller à la conquête d’autres territoires culturels en se faisant accepter ou adopter par les publics internationaux.
Bien que ce type de questionnement sur la part d’influence du paramètre linguistique dans les phénomènes de mondialisation culturelle ne soit pas si nouveau, la problématique doit être à nouveau explorée à la faveur des préoccupations actuelles en matière de promotion de la diversité des expressions culturelles en ligne. Une telle démarche aurait le mérite de proposer une lecture actualisée des dynamiques de circulation transnationale des flux de contenus culturels numériques nationaux ou locaux au prisme des contextes de leur réception à l’étranger.
Contrairement à l’anglais qui s’impose comme la langue des affaires à l’international et la langue dominante, y compris sur Internet, et qui de fait est perçue comme un vecteur d’impérialisme culturel ou une menace à la souveraineté culturelle des nations, le français bénéficie d’un a priori favorable lorsqu’il est utilisé comme un instrument de diplomatie culturelle. Toujours est-il que dans le domaine des industries culturelles, de nombreux impératifs de rentabilité économique conditionnent la mise en marché et la commercialisation des produits et des talents selon les logiques du star-system, imposées par les majors et les multinationales du secteur de la diffusion et de la distribution. Les modèles commerciaux de l’offre culturelle globale ont été façonnés par les standards internationaux d’influence anglo-américaines et ont progressivement contribué à faire émerger au tournant des années 1990-2000 un phénomène d’acculturation par l’anglais, surtout prégnant dans l’industrie musicale et accentué par l’ère du streaming. De plus en plus d’artistes francophones sont maintenant convaincus ou sont incités à chanter en anglais ou à produire des versions anglaises de leurs titres afin de mieux s’exporter et de dépasser ce qui est souvent perçu comme « la barrière de la langue ».
Ce phénomène se manifeste aussi bien en France136, en Belgique, au Québec, que dans les pays francophones d’Afrique. Michael Spanu, chercheur et spécialiste des langues chantées dans les musiques populaires, a récemment écrit un article à ce sujet dans lequel il fait magistralement la démonstration d’une situation qui semble s’imposer comme une nouvelle norme :
« Aujourd’hui, grâce à l’Internet (notamment YouTube) les artistes du monde entier diffusent avec succès leurs clips accompagnés de sous-titres anglais. L’Internet offre de nouvelles perspectives de diffusion internationale pour les artistes amateurs du monde entier, faisant apparaître l’anglais comme le langage "naturel" de cette diffusion. Les services de streaming renforcent cette logique, comme on peut l’observer avec les playlists de Spotify qui n’autorisent la sortie d’un titre que dans une seule version, alors que l’industrie musicale traditionnelle a historiquement préféré segmenter les marchés, sortant des versions différentes d’un même titre, parfois en ajoutant une collaboration avec un artiste local. De fait, de nombreuses tensions subsistent entre les grands labels visant des marchés nationaux et les artistes locaux cherchant à dépasser les frontières […]. »137
Ces observations font échos aux travaux des chercheurs Gisèle Sapiro, Jérôme Pacouret et Myrtille Picaud qui soutiennent également que la langue a une influence sur la faible visibilité et l’accès marginal aux expressions culturelles minoritaires ; les œuvres produites et conçues dans les langues qu’ils qualifient de « centrales » ayant un plus grand pouvoir de reconnaissance, à l’international notamment, que celles produites et conçues dans les langues dites « périphériques »138.
Dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma, les pratiques de doublage et de sous-titrage constituent un moyen de surmonter les obstacles de la langue puisqu’elles favorisent une circulation transnationale et internationale des œuvres. L’industrie cinématographique nigériane, Nollywood, a très vite compris que son rayonnement passerait aussi par la conquête du public francophone. Ainsi, « les films et les feuilletons nigérians, en version originale ou adaptée, sont regardés avidement en Afrique centrale et orientale. Parallèlement, ils sont devenus si populaires en Afrique de l’Ouest francophone que la chaîne de télévision Nollywood a obtenu l’audience la plus forte de la région »139. Il en est de même pour les télénovelas140 latino-américaines qui s’exportent bien et font l’objet d’une consommation frénétique dans les foyers africains francophones, grâce aux technologies du doublage. Alors, cette même recette peut être appliquée aux films et séries en langues locales (pouvant être sous-titrées en français) ; ainsi qu’aux œuvres cinématographiques en français dont le sous-titrage ou le doublage en anglais pourrait multiplier leurs chances de distribution et de découvrabilité à l’international, notamment via les plateformes numériques.
Les entrevues menées ont mis en lumière des points de vue très contrastés sur la question de la langue comme barrière à la découvrabilité des contenus francophones, indépendamment des pays et aussi des secteurs culturels. Par exemple en Côte d’Ivoire, les populations se sont appropriées le français avec des déformations et réadaptations notables qui laissent apparaitre un « français ivoirien » dans le langage courant. Le nouchi, une création linguistique ivoirienne, est une variante141 de ce français de Côte d’Ivoire qui déteint sur les productions d’œuvres musicales locales. Les professionnels du secteur cinématographique interrogés en Côte d’Ivoire affirment que le français dans leur métier constitue une limite réelle dans leurs aspirations à un positionnement international. Chez les actrices de cinéma interrogées, même si les doublages en anglais permettent une meilleure diffusion des films, la conquête d’autres marchés de production de films est largement limitée par les barrières linguistiques. Dans le secteur de la musique en revanche, les artistes chanteurs ivoiriens considèrent que le rythme dansant et mélodieux d’une chanson peut permettre au public de faire abstraction de la langue. La majorité de ces chanteurs admettent néanmoins qu’ils tentent avant tout de conquérir et de fidéliser le public national et local à travers des chansons en langues locales, sans toutefois véritablement se préoccuper des auditoires internationaux qui pourraient apprécier leur musique.
Pour l’ensemble des professionnels du cinéma interrogé au Burkina Faso, contrairement aux témoignages recueillis en Côte d’Ivoire, la langue de tournage d’un film ne constitue pas un frein à sa circulation à travers le monde. Si ce constat s’applique pour les productions cinématographiques nationales projetées dans des salles de cinéma ou diffusées via des chaines de télévision, la réalité est toutefois différente dans l’environnement numérique (en particulier sur Internet) où l’œuvre a besoin d’un sous-titrage ou d’un doublage pour être plus largement accessible et pour prétendre conquérir un auditoire mondial en bénéficiant d’une plus grande exposition sur les catalogues des grandes plateformes de diffusion et de distribution numériques.
Certains professionnels burkinabé interviewés ont expliqué que le choix de la langue de tournage du film dépend d’une part, de la langue parlée par les principaux acteurs, et d’autre part, du contexte local dans lequel le film se tourne. Travailler en langue locale donne également à ces acteurs la possibilité de s’exprimer dans toute leur plénitude. Selon le réalisateur/producteur Dao Soungalo :
« Le cinéma c’est aussi une question de diversité culturelle et de langue. Je dirai donc que la langue n’est pas un obstacle à la découvrabilité de mes films. Au contraire ! L’essentiel pour moi, c’est d’exprimer artistiquement ce que j’ai envie de montrer aux gens. Donc je peux travailler en Dioula, en Bambara, l’essentiel c’est de construire mon histoire autour des personnes à filmer ».
Les langues utilisées dans les films burkinabè sont en effet très variées : certains films sont en français d’autres en langues locales et cela concerne aussi bien des films de fiction que des films documentaires.
Il convient également de préciser que selon le métier du professionnel rencontré, la perception de cette question de langue utilisée pour le tournage des films n’est pas tout à fait la même. Si les réalisateurs trouvent que la langue compte peu comme un obstacle pour la circulation et la découvrabilité de l’œuvre (qu’il s’agisse du français ou d’une langue locale, le plus important étant d’avoir une œuvre cinématographique de bonne qualité), du côté des distributeurs, les propos sont plus nuancés.
Prenant l’exemple du producteur-distributeur Rodrigue Kaboré, il explique avoir l’habitude de mixer les langues dans ses films. Un film, confie-t-il, peut être principalement tourné en français, mais certaines scènes peuvent être en langue locale (mooré par exemple). Ce qui est tourné en langue locale est sous-titré. Mamounata Nikiema, responsable de la maison de production PILUMPUKU, développe également une pratique qui va dans le sens d’une plus grande ouverture et accessibilité de ses productions à un public international : « depuis un certain temps je produis toujours les films en deux versions : français, anglais pour donner plus de chance de jouer évidemment dans beaucoup de pays. ». Ainsi, pour augmenter les chances de circulation de leurs films, les professionnels Burkinabè font presque systématiquement des sous-titrages142 surtout en français, mais aussi de plus en plus en anglais, pour tenter de rejoindre des publics pouvant être potentiellement intéressés partout dans le monde.
En définitive, ce qui importe c’est que les pays francophones comme le Burkina qui disposent d’une riche production cinématographique nationale en langues locales puissent développer une véritable stratégie d’exportation et de valorisation de leur mémoire audiovisuelle et de leur patrimoine cinématographique dans l’environnement numérique afin de contribuer à une meilleure promotion de la diversité des expressions culturelles et linguistiques sur Internet.
Toujours est-il que la langue ne constitue pas le seul obstacle potentiel pour la découvrabilité des produits culturels francophones en ligne. Il y a aussi la problématique de la connectivité, surtout dans les pays en développement francophones. Mamounata Nikiema explique ainsi que la difficulté majeure réside surtout dans les conditions d’accès à Internet qui, selon elle constituent un important frein à l’utilisation du numérique dans les pratiques visant à favoriser la découvrabilité des productions locales et nationales, surtout en Afrique francophone :
« Pour moi, il y a d’abord la contrainte d’accès à Internet qu’il faut préalablement lever. Voilà depuis pratiquement 4 heures que j’essaie d’envoyer un fichier à ma réalisatrice qui est actuellement en formation au Ghana. Moi je pars dimanche, et elle en a besoin pour le présenter devant les bailleurs mais la connexion Internet ne passe. Donc, c’est vraiment la galère. Tant qu’on ne va pas résoudre cette question de connectivité dans nos pays africains on ne peut pas parler vraiment d’avantage à tirer des films en ligne. Par exemple lorsque je dois envoyer un film de deux gigas à un festival qui attend mon film, je dois laisser mon ordinateur de montage tourner pendant deux nuits avec cinq gigas de connexion. En fait, je lance l’ordinateur, je ne l’éteins pas pendant deux nuits pour que le fichier parte. C’est un vrai défi. Mais nous savons que la présence de films en ligne offre des avantages parce que nous voyons ce que NETFLIX fait ».
Cette anecdote, loin d’être une situation isolée, constitue une réalité partagée par de nombreux professionnels de la culture de la Francophonie du Sud. Les inégalités en matière d’accès et d’usage de l’Internet demeurent très présentes au sein de l’espace francophone. Or, sans accès à Internet, il ne peut être question de contenu, ni de découvrabilité.
Selon le rapport 2018 sur l’état des lieux de la Francophonie numérique, seuls deux pays francophones (la Suisse et le Luxembourg) font partie des dix premiers du classement de l’indice de développement des TIC de l’UIT (IDI)143, qui permet de mesurer et de comparer la performance de 175 pays en matière d’infrastructures, d’utilisation et de compétences en matière de TIC. L’Île Maurice, premier pays africain membre de la Francophonie à faire son apparition dans ce classement, pointe à la 72e place. Tous les autres pays de l’Afrique francophone occupent la queue du peloton, avec des indices bien inférieurs à la valeur moyenne de l’ensemble des pays francophones qui est de 5,11 points sur 10.
Ceci est révélateur du fait qu'il y a encore beaucoup de problèmes de connectivité au sein de l'espace francophone, et ce malgré les progrès accomplis par plusieurs pays au cours des dernières années surtout au niveau de la pénétration du téléphone mobile et du développement d'usages innovants, permis par les réseaux 3G et 4G.
Sur ce sujet, l'étude signée par Véronique Guèvremont et Ivana Otasevic (avec la collaboration d'Ivan Bernier) sur la coopération internationale avec les pays africains francophones en vue de mettre en œuvre la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, apporte un éclairage intéressant. Elle confirme des difficultés :
« […] notamment liées au faible taux de pénétration du haut débit et au coût élevé des services à haut débit, à la lenteur de la vitesse de téléchargement (ascendant et descendant) des réseaux haut débit et aux limites que cela impose aux activités productives liées à Internet, et finalement à l’équipement TIC disponible dans chacun des pays concernés. Ainsi, le faible taux de pénétration du haut débit dans les pays de l’Afrique de l’Ouest pose des problèmes de connectivité et limite par exemple la capacité des internautes à télécharger les films et les séries, tant africains qu’étrangers, accessibles sur les différentes plateformes de vidéo à la demande (VOD) »144.
Par ailleurs, les professionnels des industries culturelles francophones que nous avons interrogés soulignent unanimement que l’inexistence d’une masse critique de productions culturelles numériques francophones de qualité constitue le véritable obstacle à la disponibilité et à la découvrabilité des cultures francophones en ligne. Comme l’explique Dao Soungalo :
« Le premier obstacle à une vente de nos films en ligne c’est qu’aujourd’hui pour exister il faut produire. L’autoproduction a ses limites. Moi j’ai beaucoup évolué dans l’autoproduction et je fais d’autres activités en plus du cinéma qui me permettent d’économiser pour produire des films. Je vous ai dit que j’ai commencé en 2005 et nous sommes en 2019 donc ça fait quatorze ans, j’ai fait neuf films documentaires et trois films de fictions. Les rares subventions que j’ai reçues sont de petites sommes ».
L’ignorance du mode de fonctionnement des plateformes de diffusion et de distribution numériques est aussi ressortie pendant les enquêtes comme un obstacle à une plus grande présence de films francophones sur Internet. Bien que les professionnels connaissent l’existence de ces plateformes et savent ce qu’elles peuvent apporter en termes de revenus, et surtout en termes de visibilité pour les films, ils manquent de connaissances sur leurs mécanismes de fonctionnement, et aussi de compétences pour négocier avec les plateformes, notamment tout ce qui concerne les aspects relatifs à la monétisation et à la signature des contrats de cession des droits de diffusion aux plateformes. Cela contribue fortement à alimenter le manque de confiance envers ces plateformes :
« Il y a plusieurs raisons qui limitent la présence de films burkinabè sur les plateformes en ligne dont le fait qu’il s’agit d’une pratique nouvelle dans la plupart des pays africains. Il est donc nécessaire de communiquer autour de ce type d’offre de visionnage de films. Il faut aussi aller vers les réalisateurs, les producteurs, et les distributeurs pour leur expliquer comment ça marche afin de les convaincre de mettre leurs films en ligne. On doit les rassurer sur le fait qu’ils seront payés et que leurs droits d’auteurs seront respectés. Il faut donc aussi une règlementation pour encadrer tout cela, sans oublier le fait qu’il faut que nous ayons un débit Internet conséquent. » (Zongo Toussaint)
Rodrigue Kaboré partage avec nous son expérience personnelle en tant que distributeur et donne dans le témoignage qui suit les raisons détaillées qui font qu’il hésite à signer des contrats pour la diffusion de ses films en ligne :
« Concernant les plateformes en ligne j’ai été contacté par 3 ou 4 structures différentes. L’idée est bonne, je n’ai pas de problème pour vendre par Internet. Mon seul souci c’est la transparence. Il faut qu’il y ait une vraie transparence dans la gestion du film. En fait, ils veulent que tu leur donnes le film et que tu leur fasses confiance à 100 %. Or c’est le propriétaire de la plateforme qui sait vraiment comment le décompte des visionnages se fait. C’est eux qui font le point pour t’informer. Moi, personnellement en homme d’affaires, cela me cause problème. Certains qui m’ont contacté m’ont dit que du fait qu’il est question de gestion de logiciel, ils ne peuvent pas me donner les codes parce que je ne suis pas seul. Mais moi je leur donne mon film, il faut aussi qu’ils me fassent confiance. Deuxièmement, en tant que distributeur professionnel je ne sais pas comment ces plateformes de diffusion en ligne qui me contactent font leur promotion. Or je veux m’assurer qu’ils ont de la visibilité et un nombre élevé d’abonnés qui visionnent les films, donc qui peuvent me faire gagner de l’argent. Et là aussi je ne suis pas rassuré. Sinon, comme je distribue des films, certains m’ont contacté pour qu’on ait d’autres moyens d’exploitation des œuvres notamment en ligne en plus des salles et des chaines de télévision. Mais jusqu’à présent je n’ai pas envoyé ou vendu des films en ligne. J’ai vendu à TV5, à Canal plus, à BF1(chaine privé burkinabè) via échange marchandise (publicité en contre partie). Et je distribue aussi au Mali, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. »
Ce panorama ne saurait être complet sans quelques exemples d’opportunités ou d’avantages que les acteurs pensent tirer de la découvrabilité de leurs œuvres en ligne. Selon les enquêtés, le principal avantage à rendre leurs films ou leurs musiques accessibles en ligne est lié à la visibilité. Qu’il s’agisse de professionnels qui se font rémunérer en mettant leurs films ou leurs musiques sur des plateformes numériques, ou qu’il s’agisse d’usage des réseaux sociaux numériques pour la promotion des œuvres, la visibilité est le premier gain évoqué. Ceux qui gagnent de l’argent affirment recevoir de petites sommes, mais ils apprécient bien le fait que leurs œuvres gagnent en visibilité. En musique, par exemple, un chanteur exprime que cela peut s’avérer très frustrant de passer des heures et des heures en studio pour que sa musique soit finalement écoutée par une poignée de personnes. C’est la raison pour laquelle certains artistes préfèrent miser sur une plus grande accessibilité et visibilité de leur titre sur des plateformes en ligne, même si cela ne leur rapporte pas dans l’immédiat ou à moyen terme des gains conséquents.
Marshall Cyano, producteur de musique, originaire du Bénin, illustre bien ces enjeux :
« Les artistes que je produis ont une large visibilité. Je donne l’exemple de Fanicko qui totalise plus d’un million de vues sur YouTube pour ses œuvres. Certains artistes que je produis partagent gratuitement leurs œuvres sur les sites de téléchargement. Le seul intérêt positif est la visibilité : s’afficher pour se faire connaître. […] Il faut reconnaître qu’à cause de l’Internet, les gens n’achètent plus nos œuvres puisqu’ils sont attirés par la gratuité des vidéos et de la musique sur YouTube ou l’accès et le partage illégal de contenus ; mais le bon côté est qu’on peut se faire de l’argent avec l’offre du streaming. Malheureusement, les services de vidéo ou de musique à la demande par abonnement, qui devraient nous permettre de monétiser nos productions ne fonctionnent pas encore très bien, et ceux qui existent ne sont pas accessibles à tous, à cause des coûts encore élevés de l’accès Internet haute vitesse. Nous n’avons pas nos propres structures locales/nationales de distribution de nos œuvres sur le numérique. C’est un grand obstacle ! Toujours est-il qu’en visionnant des œuvres béninoises sur YouTube, des gens m’identifient par ma signature de producteur et m’appellent de partout ».
Dans le secteur de la production cinématographique, Dao Soungalo explique que « certains professionnels occidentaux, distributeurs ou diffuseurs par exemple, utilisent Internet pour chercher des films africains qu’ils pourraient distribuer ou diffuser. De ce fait, avoir une présence sur Internet offre des opportunités. Parfois certains viennent à l’occasion du Fespaco et on se rencontre physiquement. Dans ce sens, j’ai eu à rencontrer des professionnels occidentaux au FESPACO ».
En termes de rémunération, un producteur qui diffuse ses films sur la plateforme AFRICA SHOW affirme que pour chaque film distribué via la plateforme, 40 % des revenus générés par la monétisation de l’œuvre reviennent au propriétaire de la plateforme et 60 % lui reviennent en tant que producteur. Un état des visionnages de films est périodiquement réalisé, puis les sommes lui sont reversées, même s’il s’agit en réalité de petits montants. La plupart des artistes interviewés estiment tout de même qu’il y aurait de réelles opportunités d’amélioration de leur rémunération et de leurs conditions économiques s’ils étaient mieux outillés pour capter l’attention des auditoires et mieux contrôler la circulation et l’exploitation de la diffusion de leurs œuvres en ligne, grâce aux technologies numériques.
Les exemples sont également légion, d’artistes et de créateurs francophones qui signent avec de gros labels ou nouent des partenariats avec des grandes chaînes de télévision, après s’être faits découvrir en ligne. Mais le tout ne suffit pas pour un artiste d’être découvrable, puisqu’une fois découvert il doit engager son public afin que celui-ci puisse contribuer à le faire davantage découvrir auprès d’autres publics.
Jérôme Dufour, Directeur Général du Marketing, de la Distribution et des Communications à l’Office national du film (ONF) du Canada exprimait bien cette réalité dans une entrevue qu’il nous a accordée :
« La découvrabilité, ce n’est pas qu’une question d’accessibilité ou de visibilité. C’est aussi un processus continu et interactif d’engagement avec le public et d’entretien d’une relation de proximité. Ce qu’on veut, c’est que les gens puissent voir nos contenus, et susciter un important niveau d’engagement. Donc, d’un point de vue de stratégie de distribution et de mise en marché, il importe de se demander comment on est en mesure d’engager la conversation avec le public. En effet, il faut garder à l’esprit que les auditoires ont aujourd’hui aussi leur propre auditoire. Donc nous ce qu’on cherche, c’est de savoir comment on réussit à engager une personne, comme vous, à partager nos contenus à son auditoire. Comment réussit-on à faire en sorte que vous puissiez parler de nos contenus à vos amis, à vos proches, ou sur vos réseaux sociaux pour augmenter la portée de diffusion ou de promotion de nos œuvres. Il faut être capable d’utiliser une stratégie multicanale ou multiplateformes pour aller rejoindre les auditoires où qu’ils se trouvent. YouTube nous permet par exemple d’élargir notre audience. C’est un vecteur de croissance pour nous et un véritable relais de découvrabilité pour les contenus que nous avons à offrir ».
IV. Pistes de recommandation et mobilisation pour un plaidoyer international
1.Propositions de pistes de recommandations et perspectives des acteurs culturels francophones par rapport à la découvrabilité des contenus locaux ou nationaux en ligne
L’inventaire des défis, des obstacles et des opportunités pour la découvrabilité des contenus francophones en ligne tels que présentés dans la section précédente débouche sur un ensemble de proposition de pistes de solutions faites par les acteurs culturels francophones avec lesquels nous nous sommes entretenus.
Quelques-unes de ces propositions méritent qu’on s’y attarde, en tant que pistes de recommandations pouvant potentiellement déboucher sur des actions et mesures concrètes, dont les différentes parties prenantes francophones impliquées dans la gouvernance des industries culturelles (tant à l’échelle nationale que locale) pourraient s’inspirer ou qu’elle pourrait se réapproprier :
-
Piste de recommandation no 1 : Positionner les contenus locaux/nationaux francophones comme des produits de niche, à travers des mesures de quotas applicables aux systèmes de recommandation des plateformes transnationales.
-
Piste de recommandation no 2 : Soutenir et encourager le développement de plateformes alternatives à celles des oligopoles de la découvrabilité.
-
Piste de recommandation no 3 : Renforcer les collaborations entre artistes/créateurs et opérateurs culturels de la Francophonie, dans une perspective de coopération Sud-Sud, Nord-Sud et Sud-Nord.
-
Piste de recommandation no 4 : Accroître le renforcement des compétences numériques des artistes, des professionnels, mais aussi des organisations de la société civile impliquées dans l’éducation du public et la médiation interculturelle, en sollicitant l’expertise des chercheurs, des acteurs locaux et des diasporas francophones.
-
Piste de recommandation no 5 : Réaffirmer et engager l’intervention de la puissance publique pour une gouvernance culturelle susceptible de garantir une meilleure promotion et protection de la diversité des expressions culturelles francophones dans l’environnement numérique.
Piste de recommandation no 1 : En ce qui concerne le positionnement des contenus locaux/nationaux francophones comme produits de niche, le recours aux services des curateurs de contenus des grandes plateformes est nécessaire. L’idée consisterait à développer des stratégies afin de déjouer ce que l’on peut considérer comme étant une découvrabilité programmée145 par les géants du Web.
En effet, il faut partir du constat que pour faire émerger une œuvre musicale ou audiovisuelle locale/nationale francophone en ligne et la faire rayonner durablement comme un contenu de niche (alors même qu’elle est en concurrence frontale avec des dizaines de milliers d’autres œuvres du catalogue), il est nécessaire de compter sur la complicité, non pas uniquement des algorithmes146, mais surtout des responsables éditoriaux et des curateurs de contenus sur les grandes plateformes de musique ou de vidéo à la demande.
La curation de contenus est devenue le nouveau nerf de la guerre pour la visibilité. Le placement du titre d’un artiste peu connu du grand public sur une liste d’écoute (playlist) très populaire de Spotify, d’Apple Music ou de Deezer (comptant 200 000 abonnés) peut par exemple changer la vie de cet artiste en lançant sa carrière du jour au lendemain et en décuplant ses possibilités de rémunération. Les labels, les producteurs, les agents d’artistes francophones doivent donc désormais intensifier leurs activités de représentation et les négociations de sorte à convaincre les plateformes d’intégrer et d’exposer leurs artistes et leurs titres dans leurs listes d’écoute.
Les acteurs culturels enquêtés plaident donc pour le développement de plus de listes d’écoutes et de recommandations éditoriales mettant en avant les nouveaux produits et talents francophones. Ce n’est que de cette manière qu’on réduira, par exemple, le fossé existant (que nous avons pu démonter à travers les résultats de nos opérations de moissonnage sur les plateformes) entre les goûts et les préférences des utilisateurs des plateformes francophones et l’offre de contenus à laquelle ils sont exposés, parfois de manière très aléatoire. C’est aussi de cette manière qu’on élargira les possibilités pour des œuvres ou des artistes francophones de se faire recommander à des publics anglophones (ou qui ne parlent pas français) qui pourraient être incités à les découvrir, ne serait-ce que par curiosité.
Ceci pourrait passer par l’imposition de mesures de quotas de contenus francophones, non pas sur l’ensemble du catalogue, mais de manière plus efficace et précise sur des listes de recommandations faites « à la main », qui pourraient être labélisées comme des listes de « découverte de la diversité » et qu’on retrouverait systématiquement bien positionnées sur les interfaces et pages d’accueil de toutes les grandes plateformes de streaming.
Piste de recommandation no 2 : Le développement de plateformes alternatives est une proposition qui est revenue fréquemment lors des différentes entrevues. Face à l’hégémonie des puissants acteurs transnationaux qui se sont constitués en oligopole de la découvrabilité, les acteurs des secteurs culturels francophones (et particulièrement ceux du Sud) revendiquent une remise en cause des configurations idéologiques qui sous-tendent les mécanismes du capitalisme numérique et qui ont enclenché le processus toujours en cours de « plateformisation » des industries culturelles. Avec le risque accru d’une perte de souveraineté numérique des États francophones face aux fournisseurs mondiaux de contenus, dont les modèles d’affaires et l’expansion fragilisent les équilibres des écosystèmes culturels nationaux.
Les acteurs interviewés croient, pour la plupart, qu’il serait opportun de développer des plateformes alternatives à l’échelle de la Francophonie, susceptibles de faire converger et de rendre plus facilement accessible et découvrable l’offre de contenus francophones disponible au sein des différentes filières culturelles, au niveau de chaque pays.
Olivier Thuillas et Luis Wiart, qui ont mené plusieurs travaux sur ces nouveaux types de plateformes alternatives, préconisent le cas échéant : « de s’organiser selon une coopération horizontale entre des acteurs situés au même échelon de la chaîne de valeur – par exemple, des producteurs de cinéma ou des librairies indépendantes qui se réunissent autour d’une plateforme –, ou selon une coopération verticale entre des acteurs différents d’une même filière qui s’engagent ensemble sur un projet de plateforme. »147.
Soulignons que plusieurs initiatives de plateformes de vidéo à la demande, portées par des institutions du service public médiatique (notamment les télédiffuseurs nationaux), ont vu le jour (ou sont en attente d’être lancées) au niveau national, dans plusieurs pays francophones. C’est le cas par exemple de « Tou.TV »148, lancé en 2010 par la Société Radio Canada (SRC), en réaction à la vague de désabonnements des Canadiens des services de câblodistributeur suite à l’arrivée de Apple TV et de Netflix au Canada, la même année149. On peut également mentionner l’exemple en Belgique de la plateforme audio et vidéo, Auvio150. Lancée en 2016 par la Radio et Télévision Belge francophone (RTBF), elle constitue un point d'accès unique pour voir et écouter, revoir ou réécouter un très large choix de contenus de la RTBF et même de découvrir certaines nouveautés en exclusivité. Avec déjà plus de trois millions d’inscrits, Auvio ambitionne de s’imposer comme la plateforme des Belges francophones, avec une offre locale de référence complémentaire aux plateformes internationales. En France, on annonce aussi le lancement d’ici cet automne de Salto, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement détenue par France Télévisions, TF1 et M6, et cherchant à se démarquer de la concurrence américaine, en offrant une vitrine de la création française et européenne, enrichie d’une programmation conçue expressément pour un public français.
Cette effervescence au niveau du paysage audiovisuel en Europe, fait d’ailleurs dire à Alain Le Diberder qu’« au moment où les nationalismes se réveillent politiquement en Europe, les nations s’estompent dans le marché des images. Les deux nouveaux cœurs du système audiovisuels, YouTube pour l’audience et Netflix pour l’argent, ne connaissent pas les frontières, parlent toutes les langues et n’ont avec les États qu’un rapport de politesse151 ».
Se prononçant sur d'autres expériences similaires de plateformes alternatives développées au Brésil, en Inde, au Maroc et en Afrique du Sud, Christine Ithurbide et Vassili Rivron mettent toutefois en garde :
« On constate rapidement que de nombreuses initiatives locales rencontrent des difficultés à s’imposer, à s’exporter voire tout simplement à survivre, dans un marché dominé par des acteurs verticalisés et disposant d’un puissant capital financier et communicationnel. La concentration des pouvoirs anciens ne se dément pas. […] Les plateformes alternatives, solidaires, nationales, voire décoloniales, peinent à fidéliser une offre et une audience massive car les mécanismes sont faussés par l’inégalité du capital informationnel (millions de références au catalogue) qui fonde l’hégémonie sur les publics et l’inégalité des capacités financières, communicationnelles ou juridiques.152 ».
Dans le même ordre d’idées, il ne faudrait pas minimiser les effets potentiellement négatifs de la multiplication des initiatives nationales de plateformes alternatives, sachant qu’elles peuvent entraîner une fragmentation des auditoires et une dispersion de l’offre sur un marché francophone où les utilisateurs se voient déjà proposer une offre de contenus internationaux de qualité. Dans ce contexte, le projet de la plateforme numérique TV5 Monde Plus qui sera lancée au mois de septembre 2020, innove et se distingue des autres plateformes nationales et constitue un exemple de bonne pratique, par son approche mondiale (ciblant les francophones et les francophiles du monde entier). Avec une contribution initiale du gouvernement canadien à hauteur de 14,6 millions de dollars sur 5 ans, cette plateforme AVOD (accès gratuit, avec un financement publicitaire) vise à favoriser la découvrabilité et le rayonnement de la création audiovisuelle francophone à l’échelle planétaire, à travers une diversité de programmes (cinéma, fiction, documentaires, magazines, divertissement) canadiens, québécois, français, suisses, belges, africains, en provenance des chaînes partenaires et de TV5 Monde. La plateforme disposera dans un premier temps des fonctions de sous-titrages français et anglais avant de les décliner en espagnol, arabe et allemand153. Il s’agit d’une initiative novatrice et fédératrice qui présente de véritables potentialités en matière de développement d’une offre francophone alternative et diversifiée, dont ne pourrait se prévaloir même le leader mondial de la Vidéo à la demande, Netflix.
Piste de recommandation no 3 : S’agissant du renforcement des collaborations entre artistes/créateurs et opérateurs culturels de la Francophonie, dans une perspective de coopération Sud-Sud, Nord-Sud et Sud-Nord, plusieurs propositions vont dans le sens du développement de projets de co-production ou de co-diffusion internationaux s’appuyant sur l’utilisation des technologies et médias numériques dans les différentes phases du projet. D’autres témoignent des vertus de réaliser des featuring entre artistes locaux/nationaux et étrangers pour diversifier les publics et accroître la notoriété sur la scène musicale internationale.
Piste de recommandation no 4 : Afin de combler les besoins en matière de littératie numérique des artistes, des professionnels et des organisations de la société civile impliquées dans l’éducation du public et la médiation interculturelle, des ateliers ou séminaires nationaux, régionaux ou internationaux de renforcement de compétences devraient être organisés en ciblant les compétences numériques en culture. À titre d’exemples, ces formations et activités de sensibilisation pourraient porter sur un certain nombre de carences identifiées par les acteurs lors des entrevues, comme : l’initiation et le développement d’aptitudes en matière de techniques d’indexation et de référencement, l’utilisation de métadonnées, la planification et la mise en œuvre de stratégies de marketing digital et d’engagement du public (animation de communautés), les méthodes de commercialisation et de monétisation d’audience, les enjeux liés à la protection des droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique, à la compréhension du fonctionnement des plateformes ainsi qu’à leurs modèles d’affaires, etc.
Piste de recommandation n° 5 : Enfin, en ce qui concerne l’intervention de la puissance publique, les acteurs suggèrent une certaine urgence pour l’adaptation et la révision par les États et gouvernements francophones des cadres réglementaires et de politiques culturelles, en tenant compte des enjeux, défis et opportunités numériques (tels qu’ils ont été explorés et analysés dans le cadre de la présente étude). Il y a également lieu d’établir des feuilles de route nationales incluant des mesures stratégiques pour favoriser la mise en œuvre des directives opérationnelles de mise en œuvre de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (incluant les expressions culturelles francophones et des minorités linguistiques) dans l’environnement numérique.
La capacité d’action et de régulation des États et gouvernements francophones doit être renforcée afin que les décideurs publics puissent réaffirmer leur souveraineté culturelle à l’heure du numérique. Pour ce faire, ils doivent pouvoir intégrer, de façon proactive, cohérente et articulée, dans la formulation ou la mise en œuvre de leurs nouvelles politiques/stratégies en matière de culture, de commerce, d’éducation et de numérique, l’ensemble des transformations et évolutions qui affectent les activités de création, de production, de diffusion, de distribution numériques et d’accès et de consommation en ligne de biens et de services culturels francophones.
2. Vers un plaidoyer international pour la découvrabilité des contenus culturels francophones sur Internet
À l’issue des réflexions et analyses produites dans le cadre de la présente étude, il nous paraît opportun de jeter ici les bases d’une nécessaire mobilisation de la communauté internationale, face au danger du nouvel impérialisme culturel qu’ont engendré les acteurs transnationaux hégémoniques de l’univers numérique. L’état des lieux inédit de la découvrabilité et de l’accès aux contenus culturels francophones sur Internet montre de belles occasions et opportunités à saisir, ainsi que de nombreux défis à relever en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles francophones numériques. C’est la raison pour laquelle il semble, maintenant plus que jamais, impératif de mener des actions concrètes afin d’une part, de préserver la souveraineté culturelle des États et gouvernements francophones et, d’autre part, de renforcer leur capacité d’intervention et d’accompagnement des acteurs clé des écosystèmes culturels locaux/nationaux, engagés dans la défense et la promotion de la langue française à l’ère du numérique.
Pour ce faire, et en vertu de son rôle prioritaire de défense du français et de la diversité culturelle et linguistique, l’OIF pourrait s’engager dans une action de diplomatie culturelle et mettre en œuvre un plaidoyer international en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l’environnement numérique. L’OIF confirmerait alors sa position comme l’un des acteurs influents dans la mondialisation à l’heure du numérique, en attirant l’attention de la communauté internationale sur un enjeu aussi crucial que celui de la découvrabilité, de l’accès et de la mise en valeur des cultures et des expressions identitaires francophones dans un espace numérique qui leur a été, jusqu’ici, très peu favorables.
Le plaidoyer visera, à travers une approche structurante et inscrite dans la durée, à atteindre les principaux objectifs suivants :
-
Sensibiliser les principaux décideurs et leaders d’opinion de la Francophonie aux enjeux en lien avec l’accès et la découverte d’une offre culturelle riche et diversifiée de contenus locaux/nationaux à l’ère numérique.
-
Influencer les principaux décideurs et leaders d’opinion de la Francophonie en vue d’obtenir des changements de politiques et de pratiques, contribuant à une meilleure inclusion et intégration du numérique dans les politiques de soutien aux industries culturelles nationales (création de lois, réforme de politiques, mais aussi mise en vigueur, application et suivi efficaces des politiques).
-
Intervenir dans une logique de complémentarité avec les autres acteurs de la coopération internationale (exemples : Unesco, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle/OMPI, Organisation mondiale du commerce/OMC, Union internationale des télécommunications/UIT, Union européenne/UE, Union africaine /UA, Secrétariat du groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique /ACP, Forum sur la Gouvernance de l’Internet/FGI, etc.) et les opérateurs de la Francophonie, afin de définir des priorités communes et agir de manière concertée en faveur du rééquilibrage des échanges et de la circulation des produits culturels numériques, dans une perspective de découvrabilité, de rayonnement et de consommation de la riche diversité des expressions culturelles francophones (en particulier celles des pays en développement).
La mise en œuvre du plaidoyer pourra s’appuyer sur les principaux documents154 suivants, servant de cadre de référence et de repères d’action :
-
Le rapport final de la présente étude sur l’état des lieux de la découvrabilité et de l’accès aux contenus culturels francophones sur Internet.
-
L’ouvrage collectif intitulé Accessibilité et découvrabilité des contenus culturels francophones à l’ère numérique : Regards croisés entre chercheurs, acteurs culturels et décideurs publics, faisant suite aux Journées d’étude internationales co-organisées par l’OIF et l’UQAM, à Montréal les 23 et 24 octobre 2019.
-
L’Appel à l’action en faveur de la découvrabilité (dit Appel de Montréal) : Adopté par les participants aux Journées d’étude internationales de Montréal et incluant 15 énoncés de principes et propositions d’actions concrètes en faveur de la découvrabilité culturelle francophone, ce texte constitue un incitatif à l’engagement de toutes les parties prenantes (États et gouvernements membres de la Francophonie ; industriels, opérateurs et acteurs privés ; acteurs et organisations de la société civile ; Organisations internationales et intergouvernementales).
-
Les directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention de l’Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique.
-
La Déclaration conjointe Canada-France sur la diversité culturelle et l’espace numérique (avril 2018)155
Conclusion
Alors qu’on assiste à une croissance sans précédent du volume des échanges de biens et de services culturels transfrontaliers, les plateformes numériques s’imposent comme les nouveaux vecteurs d’une mondialisation culturelle aux accents hégémoniques. Constitués en oligopole de la découvrabilité, ces acteurs contrôlent désormais l’amont et l’aval de l’ensemble des activités créatrices de valeur (production, diffusion, distribution, accès) au sein des différentes filières des industries culturelles. Ceci interpelle directement la capacité des États et gouvernements francophones à prendre des mesures et des initiatives susceptibles d’accroître l’accessibilité, la découvrabilité, la consommation et le rayonnement d’une diversité de contenus locaux et nationaux francophones en ligne.
Au regard de cette réalité, l’étude réalisée établit un état des lieux inédit des enjeux de découvrabilité et d’accessibilité des contenus culturels francophones sur Internet et propose des pistes d’action concrètes émanant directement des acteurs de l’espace francophone ayant participé aux enquêtes.
La revue critique de littérature a permis d’explorer le cadre théorique de la découvrabilité et de situer ce concept à la croisée de ses différentes utilisations dans les domaines de la culture et du numérique ainsi que des disciplines des sciences de l’information et de la communication (SIC) et de l’informatique. Plusieurs enjeux sous-jacents à la notion de découvrabilité et les interrogations qu’elle soulève ont rendu possible de la problématiser en la mettant en perspective avec des phénomènes et des processus connexes de diversité culturelle, de gouvernance algorithmique, de transformation numérique, de chaîne de valeur culturelle, de piratage des œuvres culturelles et artistiques et de juste rémunération des créateurs.
L’analyse des résultats des enquêtes confirme la faible présence et l’accessibilité des contenus culturels francophones en ligne et dévoilent également les erreurs d’appréciation ainsi que les biais des recommandations automatisées et algorithmiques par rapport à des goûts et des genres musicaux aléatoirement pris en considération par les plateformes étudiées. L’absence de critère de diversité dans la recommandation culturelle par les algorithmes incite l’utilisateur-type francophone à réviser ses attentes et à se contenter de catégories préconfigurées de goûts, déterminées par des critères de popularité et de logiques de star-system se concentrant sur les créations originales et les contenus exclusifs des Netflix & Cie.
De nombreux progrès restent à réaliser du côté des fournisseurs de contenus qui doivent, notamment par des leviers réglementaires, être incités à trouver des moyens pour adapter leur contenu aux publics francophones. Tout l’enjeu consiste à faire en sorte que le marché francophone de consommation culturelle, bien réel mais déconsidéré par les nouveaux diffuseurs et distributeurs mondiaux tels que Spotify, Deezer, Amazon, ou Netflix, devienne plus attractif. Il convient donc de ne plus penser ce marché uniquement en termes de taille, mais aussi en termes de productivité et de qualité de production de contenus culturels à haute valeur ajoutée. De gré ou de force, les plateformes sont déjà en train de s’adapter puisque dans leur processus de croissance internationale, elles sont obligées d’identifier de nouveaux débouchés comme l’Afrique francophone, caractérisée par une richesse culturelle prolifique et une forte demande en contenu local.
Un détour par l’univers des consommateurs culturels francophones nous apprend davantage comment est façonné le marketing de la demande et du « sur-mesure de masse ». Les résultats du sondage mettent en exergue plusieurs faits saillants. Le téléphone intelligent ravi la vedette à l’ordinateur et aux tablettes en tant qu’équipement le plus utilisé pour consommer des contenus culturels francophones en ligne. Le visionnement156 de films et de séries s’impose comme l’activité culturelle favorite en ligne des internautes francophones sondés, mais le contenu musical francophone est celui qui séduit et intéresse le plus ce même panel de répondants parmi tous les autres types de contenus. Internet est le média incontournable pour la découverte de contenus culturels francophones, bien loin devant les médias traditionnels. Et YouTube est plébiscitée comme plateforme la plus favorable à la découvrabilité des talents et des œuvres francophones, en partie parce qu’on y regarde et qu’on y écoute gratuitement des contenus provenant du monde entier, mais aussi parce qu’il y a un biais induit par le fait que la majorité des répondants sont ces fameux milléniaux dont émerge toute une génération de YouTubeurs francophones.
Le sondage démontre également que les consommateurs francophones ne sont pas beaucoup plus attirés par les contenus locaux et nationaux francophones que par les autres contenus étrangers. Au contraire, ils semblent manifester une grande appétence pour les succès internationaux puisqu’à défaut d’avoir ce qu’ils auraient aimé voir ou écouter, ils se contentent et finissent par n’aimer que ce à quoi les algorithmes et les recommandations éditoriales les exposent le plus, c’est-à-dire les contenus internationaux. D’ailleurs, sur YouTube, sans action ou requête de l’utilisateur, l’algorithme de la plateforme prend totalement le contrôle et propose de manière continue une playlist de musique sans que cela ne soit aussi spontané, aléatoire ni même personnalisé, tel que la plateforme veut bien le faire croire.
D’un côté, l’exposition sur les pages d’accueil et dans les listes de recommandation éditorialisées du catalogue, les recommandations personnalisées des algorithmes, le marketing viral ou l’autopromotion en ligne, les bonnes critiques et la qualité de l’œuvre ainsi que la qualité des métadonnées constituent selon les répondants les facteurs les plus déterminants de la découvrabilité. De l’autre côté, la quantité limitée des œuvres et des contenus francophones de qualité en ligne, les coûts élevés d’abonnement Internet et d’accès aux différentes plateformes et applications payantes de diffusion et de distribution de contenus culturels ainsi que le piratage et les contraintes liées aux transactions électroniques de biens et de services culturels en ligne constituent les principaux freins ou obstacles à la découvrabilité. Les sondés déclarent aussi en grande majorité privilégier les plateformes proposant un accès gratuit à un catalogue illimité de contenus. Enfin, ils estiment que les prestations payantes (tournées, concerts, projections en salle, festivals, etc.) constituent encore le principal moyen pour permettre aux artistes et créateurs d’accroître leurs revenus.
Les entrevues semi-dirigées réalisées auprès des artistes et des professionnels de la culture de 5 pays francophones ont démontré la place prise par l’Internet et les outils numériques dans les activités et les pratiques des différents domaines des industries culturelles. Mais les retours d’expérience indiquent que le rythme d’adoption et d’intégration des outils numériques dans les pratiques professionnelles varient beaucoup d’une génération de travailleurs culturels à l’autre, les plus anciens étant moins à l’aise avec ces outils que les plus jeunes. On relève généralement une méconnaissance des professionnels de la culture par rapport aux sites, aux outils, aux techniques et aux stratégies d’optimisation, de référencement et d’utilisation des métadonnées pour accroître la découvrabilité d’une œuvre ou d’un contenu. Les degrés de compréhension des enjeux de littératie numérique des acteurs ainsi que les défis liés à la fracture numérique et à la connectivité varient sensiblement entre les pays francophones et ces facteurs influencent également les dynamiques et les tendances à l’œuvre en matière de découvrabilité. En ce qui concerne la langue française, il n’y a pas de points de vue consensuels sur le fait de la considérer comme une barrière à la découvrabilité des artistes, différentes considérations entrant en jeu, que l’on soit dans un secteur ou dans l’autre (les réalités du milieu cinématographique se distinguant de celles du milieu de la musique, par exemple).
Les acteurs culturels ont également proposé cinq principales pistes de recommandations concernant 1) la mise en place de mesures de quotas applicables aux systèmes de recommandation des plateformes transnationales, 2) le développement de plateformes alternatives à celles des oligopoles de la découvrabilité, 3) une coopération Sud-Sud, Nord-Sud et Sud-Nord accrue entre les artistes-créateurs et les opérateurs culturels de la Francophonie, 4) le renforcement des compétences numériques des artistes, des professionnels et des organisations de la société civile impliquées dans l’éducation du public et la médiation interculturelle en mobilisant l’expertise des chercheurs, des acteurs locaux et des diasporas francophones, 5) l’intervention de la puissance publique pour une gouvernance culturelle susceptible de garantir une meilleure promotion et protection de la diversité des expressions culturelles francophones dans l’environnement numérique.
Comme l’étude le démontre, l’avenir de la problématique de la découvrabilité et l’efficacité de sa mise à l’agenda international en tant qu’enjeu de développement culturel durable dépendra surtout de la réactivité des institutions en charge des politiques publiques, en matière de culture et de numérique, au sein des États et gouvernements membres de la Francophonie. Les réponses aux menaces que font peser les GAFA sur la découvrabilité et l’accès à une diversité d’expressions culturelles locales, nationales, régionales dans l’environnement numériques ne doivent pas être des réponses isolées, ni uniques d’États désemparés ou désespérés, en perte de moyens et de repères d’action. Une conversation multi-acteurs à l’échelle globale doit pouvoir être amorcée sur cet enjeu. Espérons que le projet d’un plaidoyer international en faveur de la découvrabilité des contenus culturels francophones puisse être concrétisé, avec le leadership de l’OIF.
À cet effet, le prochain rendez-vous du XVIIIe Sommet de la Francophonie qui devrait porter sur le thème « Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone » offre l’occasion idéale aux États et gouvernements membres de l’OIF de se saisir de cet enjeu.