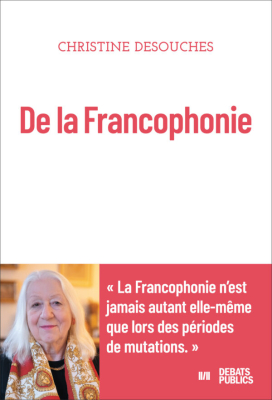L’ouvrage se veut une présentation partisane des grands traits et des étapes importantes de l’histoire de la Francophonie afin de mieux interroger son avenir. L’auteure, docteur en science politique, maître de conférences honoraire à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et présidente de l’Académie des sciences d’outre-mer, se décrit comme « une observatrice et une actrice privilégiée de cette histoire, [pouvant] articuler une pensée et un regard dont la focalisation, à la fois interne et externe, permettrait de dégager du sens » (p. 7). Elle a suivi la construction de la Francophonie puis activement participé à son affirmation politique en exerçant plusieurs hautes fonctions de cette organisation. Elle pressent la Francophonie à un moment décisif de son avenir et souhaite éclairer le chemin qui s’ouvre pour l’institution. La Francophonie évolue tout en restant méconnue et parfois critiquée. Elle s’attache néanmoins à déconstruire ces critiques, souvent fruits de l’ignorance malgré les travaux universitaires. Cet ouvrage à l’écriture amoureuse cherche dans son ensemble à vulgariser, aller au-delà des spécialistes pour que « ce texte touche un plus grand nombre » (p. 14). L’ouvrage s’attache à fournir « quelques repères sur le processus qui a conduit à l’émergence, à la structuration et au déploiement de la Francophonie » (p. 15). L’auteure se focalise en grande partie sur la Francophonie à travers la paix, la démocratie et les droits de l’Homme, du fait des fonctions qu’elle a exercé. Elle soulève beaucoup de questions sans toujours y répondre : ce sont autant d’interrogations qu’elle se pose à elle-même comme au lecteur et plus largement à la Francophonie.
Partie 1. De quelle Francophonie parle-t-on ? Construction et affirmation
L’histoire de la Francophonie dépasse celle de son institutionnalisation. Cette histoire est méconnue, particulièrement (et paradoxalement) des Français qui la résume parfois à des combats d’arrière-garde voire à du néo-colonialisme. Elle est plus connue des autres pays francophones mais demeure la source de quelques mystères et interrogations. Dépositaire et promotrice de valeurs et de réalisations qui ont fait d’elle « un vecteur significatif de politiques nationales et un acteur reconnu sur la scène internationale » (p. 22), l’histoire de la Francophonie permet de comprendre les processus qui l’ont constitué mais aussi de mettre en exergue les caractéristiques qui en découlent. Cette construction volontariste nécessite un acte de foi, une adhésion et des efforts renouvelés : ce sont « des convictions fortes et une mobilisation sans pareille » (p. 25) qui ont fait la Francophonie.
Une idée dynamique de la Francophonie prend forme dans les années 1960 et se fait d’un ensemble d’initiatives privées puis publiques « ayant toutes en commun d’être portées par un esprit militant et inventif » (p. 27). Elle s’inscrit dans un contexte de déploiement de stratégies d’indépendance et de coopération, au Canada comme en Afrique, notamment du côté de l’enseignement et de la recherche, investissant le projet d’une forte charge intellectuelle et culturelle avant de suivre dans le domaine juridique et parlementaire. Le projet politique d’un regroupement des États francophones apparaît très tôt dans la bouche de plusieurs chefs d’État. Plusieurs avant-projets ambitieux (aux dimensions économique, culturelle et non uniquement linguistique) voient le jour mais sans emporter le soutien de la France. La création d’un texte plus modeste de coopération culturelle et technique aboutit à la victoire du plus petit dénominateur commun à Niamey en 1970. L’Agence de coopération culturelle et technique est « une organisation internationale vouée non à la défense de la langue française mais à la coopération grâce à la langue française » (p. 36). Elle s’appuie sur des principes au cœur des évolutions du monde : la solidarité par le partage d’une langue commune, la coopération dans le respect de la souveraineté, l’égalité et la diversité, l’ouverture et la complémentarité.
Le projet politique retrouve force et vigueur dans une organisation où « la langue du colonisateur [est] utilisée comme un outil d’émancipation puis de solidarité innovante » (p. 39) : des sommets sont organisés régulièrement pour échanger et arrêter des positions communes dans l’intérêt mutuel. Le Sommet de Dakar de 1989 affiche les valeurs portées par la Francophonie et se munit d’un mandat pour les traduire rapidement en actions concrètes. L’Afrique confirme son poids dans la Francophonie et son aspiration au droit au développement, à un État de droit consubstantiel à la démocratie et aux libertés. Le sommet ouvre aussi sur la coopération juridique et judiciaire : « la communauté francophone se voyait dotée d’une matrice conceptuelle, méthodologique et programmatique exigeante » (p. 46). Une délégation dédiée est chargée d’accompagner les processus électoraux au moment d’un renouveau démocratique en fournissant l’assistance d’experts régionaux. L’existence de la Francophonie sur la scène internationale est progressivement reconnue, notamment par l’Organisation des Nations unies. Les notions d’exception culturelle mais aussi de prévention des crises et des conflits mêlant initiatives politiques et suivi technique se précisent au sein du groupe francophone jusqu’au Sommet de Hanoï et la Charte de la Francophonie en 1997. Les premiers secrétaires généraux sont des personnalités brillantes qui incarnent les hautes ambitions de la Francophonie et transforment durablement cette dernière.
L’adoption de la déclaration de Bamako en 2000 bouleverse la Francophonie : « véritable charte globale de la démocratie, elle embrasse dans un seul document l’expérience francophone en la matière » (p. 59). La déclaration est aussi un instrument de sauvegarde des principes et engagements proclamés. Cette nouvelle étape de la construction francophone « scelle l’existence d’une communauté dont les membres, souverains et unis autour de valeurs déclinées et partagées, acceptent désormais de se donner un droit de regard mutuel sur leurs pratiques » (p. 61). La démocratie est déclarée inséparable du développement et ils forment ainsi les facteurs d’une paix durable alors que plusieurs pays francophones traversent des crises. L’auteure était au cœur du processus de rédaction participative et délibérative répondant à l’exigence fondamentale de diversité et de consensus. La déclaration rend intelligible la spécificité de l’approche francophone, ouvrant la porte à de nouveaux partenariats. Elle entame, pour l’auteure, « l’une des périodes les plus fastes de l’histoire de la Francophonie » (p. 68). Le rôle des envoyés spéciaux des secrétaires généraux s’épaissit en œuvrant par la facilitation, l’alerte et la médiation démocratique. La déclaration audacieuse et précurseure de Saint-Boniface en 2006 poursuit le travail en s’ancrant sur la prévention des conflits et la sécurité humaine mais sans mécanisme de suivi collectif. En quarante ans de construction, la Francophonie « avait constitué un ensemble institutionnel rationnalisé, mobilisable, qui lui permettait d’accomplir des missions complexes et de plus en plus importantes au service de la paix, de la construction démocratique et de la défense des droits humains » (p. 83).
Partie 2. La Francophonie politique et ses défis
La Francophonie s’inscrit dans le développement du multilatéralisme et de la mondialisation ; son bilan positif est toutefois nuancé par des fragilités récurrentes commençant à faire jour et menaçant son avenir dès les années 2010. L’auteure fait part de son ennui et de son impuissance après vingt ans au sein de l’institution. Elle interroge sa capacité d’action politique face aux attaques diverses et fait preuve de l’essoufflement de l’organisation, des dysfonctionnements sur le terrain et des manquements dans la gestion collective. « La force du projet francophone vient de ses fondations, de l’engagement collectif qu’il a suscité et de sa capacité à opérer sa propre mue » (p. 91).
L’auteure décèle des signes de flottement voire de tarissement de l’engagement collectif avec l’abandon de repères communs à partir de 2009. La Francophonie demeure trop prudente pour être suffisamment efficace et consistante dans la prévention des crises. Elle se concentre par ailleurs presque exclusivement sur certaines (rupture démocratique, crise électorale) tout en restant tolérantes avec d’autres (manipulation de la Constitution, violation des droits de l’Homme) : l’auteure critique ce « laisser-faire » détestable et un traitement sélectif des États selon des rapports de force. Elle interroge les moyens limités de l’Organisation mais aussi le poids des raisons d’État sur les engagements collectifs, elle questionne aussi son élargissement au mépris d’une vision commune. Devant ces doutes, l’auteure estime qu’il est nécessaire de redonner de l’élan en posant une nouvelle réflexion collective qui n’a pas encore eu lieu, faute de conviction partagée. La Francophonie subit le cours des évènements plus qu’elle ne pose de stratégie collective : elle applique facilement le même schéma (condamnation, suspension, accompagnement, levée de la suspension, consolidation) sans qu’il demeure efficace. La priorité est désormais ailleurs (lutte contre le terrorisme, migrations massives et pauvreté). La Francophonie fait face, comme le reste du monde, à un désordre mondial résultant de la désintégration progressive de l’ordre établi. Elle doit trouver sa place dans cette reconfiguration et du fait de sa vaste étendue géographique, gérer de nombreux dossiers. La Francophonie doit spécifiquement composer avec la persistance du terrorisme au Sahel et des coups d’État militaires en Afrique. La France recule en Afrique, au profit de puissances peu compatibles avec la déclaration de Bamako. L’emballement du monde questionne l’efficacité du système multilatéral ainsi que l’utilité voire la légitimité des mécanismes de sauvegarde de la démocratie et de la paix : « la Francophonie paraît largement impuissante à prévenir les crises dans des pays pourtant si présents dans son histoire et aux côtés desquels elle fut longtemps et intensément mobilisée » (p. 107).
La Francophonie est (re)devenue un acteur secondaire, appliquant difficilement ses propres normes ou s’accommodant de pratiques discutables. Ce n’est toutefois pas la seule organisation internationale à voir se réduire sa capacité d’intervention et les opérations de maintien de la paix font l’objet de nombreuses critiques. La démocratie connaît un recul poussant les populations à un désenchantement démocratique ainsi qu’à la défiance envers les gouvernements alors que la Francophonie s’est longtemps associée indiscutablement à la démocratie. Les organisations régionales ont connu une montée en puissance rapide, plaçant la Francophonie dans un environnement complexe et compétitif. Les crises se veulent sécuritaires et militaires, minorant l’impact et le savoir-faire francophone en matière de défense des droits de l’Homme, de démocratisation et de sécurité humaine. Il est temps de faire preuve de persuasion et d’imagination pour trouver sa place dans un contexte en évolution constante. Plusieurs contraintes endogènes entament sa crédibilité (budget et ressources humaines dérisoires, absence de priorité dans les politiques étrangères, manque de direction incontestable, méconnaissance de la Francophonie). Elle apparaît déclassée et les démocraties plus anciennes se désengagent du volet politique au profit de la coopération économique, culturelle et linguistique. La démocratie libérale est visée par des critiques plus globales contre l’Occident et ses valeurs universelles. L’auteure interroge alors l’avenir de la Francophonie politique, à l’heure où ce climat délétère peut aussi se voir comme le signe d’un renouveau nécessaire.
La Francophonie n’a pas réussi à prévenir ou régler durablement la multiplication des crises et des conflits, malgré des efforts louables, provoquant un mouvement de déception quant au fait démocratique et un retour des autoritarismes. Elle a ainsi pris tôt l’initiative d’améliorer ses programmes et ses outils, notamment en matière de sécurité humaine et de responsabilité à protéger, tout en coordonnant les ressources et les efforts avec d’autres organisations. Sa gestion lacunaire voire complaisante de situations de crise est vivement interpellée par certains alors que d’autres contestent ses valeurs et ses instruments dans un ordre mondial rénové. Tout cela amène la Francophonie à des questionnements profonds, préludes à un repositionnement clair pour mieux préparer son avenir. Le projet politique francophone n’apparaît pas encore caduc pour l’auteure qui souhaite un renforcement ou la réactivation de certains mécanismes permettant de revenir dans la compétition géopolitique globale. La Francophonie dispose des atouts et des ressorts pour concourir à relever les défis du siècle alors qu’un désir de liberté s’exprime dans tout son espace. La déclaration de Bamako, complétée par celle de Saint-Boniface, loin d’appartenir au passé, est une source d’inspiration et d’action. La démocratie s’incarne dans les élections représentatives et pluralistes mais aussi au quotidien avec la participation de la société civile, la recherche de consensus et l’ouverture, ce qui nécessite une vie politique apaisée et une intériorisation de la culture démocratique. Par son étendue géographique, la Francophonie affirme que la démocratie n’a pas de mode d’organisation unique au-delà du respect des principes universels car elle s’inscrit dans des réalités et des spécificités historiques. La question du suivi des engagements est toutefois centrale : l’auteure milite pour son application dans toute son entièreté (prévention, observation, alerte et évaluation) mais aussi une concertation accrue avec des opérateurs plus agiles. Les déclarations reposent sur « la philosophie du dialogue collectif, qui met l’accent sur l’échange et le respect mutuel, particulièrement importante en matière de démocratie et de dialogue démocratique » (p. 146). L’auteure appelle de ses vœux un exercice semblable pour élaborer de nouveaux outils en matière de Francophonie politique. Elle relève un retour à la Francophonie culturelle et linguistique qu’elle ne critique pas tout en craignant que cela ne retarde les avancées en matière politique. Le multilatéralisme est dans les veines de la Francophonie depuis sa création et elle en demeure un acteur important. Elle repose aussi sur plusieurs réseaux efficaces et favorisant une coopération multilatérale horizontale : cette pluralité est un atout géopolitique certain mais présuppose aussi une coopération entre tous.
Partie 3. Les voies d’une solidarité renouvelée
La Francophonie doit évoluer dans un contexte mondial tourmenté alliant crise du multilatéralisme et montée des nouveaux impérialismes : elle recherche pour cela un nouveau souffle. La langue française redevient le prisme d’approche des trois piliers de la coopération : cultures et éducation, démocratie et gouvernance, développement durable.
La Francophonie est forte de nombreux atouts économiques mais injustement déconsidérés. La dimension économique est un levier stratégique pour les membres francophones dans un contexte de concurrence entre les organisations internationales et régionales. L’exemple du Commonwealth inspire « que la maîtrise de la langue française devienne un atout sur le plan économique et commercial, la dynamique d’une langue étant indissociable de la puissance économique des pays qui l’utilisent » (p. 172). Plusieurs membres ayant la double appartenance, les deux organisations travaillent souvent pour défendre des positions communes. L’héritage colonial et pragmatique du Commonwealth diffère toutefois de l’initiative francophone polycentrique et postcoloniale. Le Commonwealth jouit d’un attrait plus important auprès des pays francophones africains, économique comme politique : la langue, son rejet ou son choix, redevient une arme politique. La stratégie économique francophone est-elle en voie de prendre son essor ? Cette question apparaît tardivement dans le processus francophone et une priorité est placée sur la sécurité des échanges et des investissements, favorisée par les similitudes juridiques des membres. La Francophonie est en faveur d’une uniformisation du droit des affaires dans son espace et défend la préservation d’un droit continental menacé par la mondialisation. La première Stratégie économique pour la Francophonie voit le jour en 2014 mais cet élan est ralenti par les doutes et la grande disparité d’intérêts des membres francophones. L’auteure relève que la situation serait en passe d’évoluer favorablement dans un contexte de concurrence accrue entre blocs régionaux : des missions économiques sont déployées pour mettre en relation et faire naître des contrats. Les valeurs éthiques et politiques de la Francophonie participent à développer son attractivité économique. Le numérique apparaît aussi comme un futur prometteur. Il peut être un levier de croissance économique à condition que les membres francophones agissent ensemble. Ces derniers accusent pourtant des disparités importantes d’accès et cela impacte la connectivité mais aussi l’innovation en limitant l’accès des jeunes à l’éducation numérique. La Francophonie regorge de talents implantés dans l’industrie numérique mondialisée et une stratégie se développe véritablement depuis quelques années pour réduire cette fracture, désenclaver certaines populations, améliorer la connectivité, encourager le transfert de technologies et former. La découvrabilité est un nouvel enjeu francophone d’actualité alors que le développement numérique de la Francophonie se veut inclusif, respectueux des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le développement durable pourrait participer à bâtir la Francophonie du futur. Cette dernière a été pionnière en la matière (notamment avec la fondation de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable en 1988). Elle s’est d’abord concentrée sur l’énergie avant de s’élargir à l’environnement, elle travaille aussi d’autres programmes internationaux.
« Même si elle est interpellée, parfois mise en difficulté, souvent à contretemps depuis une décennie ou même décriée, la Francophonie est bien vivante » (P. 197). Le français est riche de la jeunesse de ses locuteurs et de leur diversité. La survie de cette langue passe par une action robuste, notamment dans le domaine scientifique, grâce à des politiques volontaristes. Plus qu’une langue de communication, c’est une composante de l’identité culturelle de ses locuteurs. L’auteure est persuadée qu’elle sera de plus en plus parlée dans le monde, confiante dans un avenir poussé par la démographie africaine. L’enjeu, au-delà de savoir si la langue française profitera vraiment de cet essor démographique, est d’accompagner ce potentiel par des programmes éducatifs. « L’éducation est (re)devenue une priorité incontournable de la Francophonie » (p. 201) tout en prenant en compte la diversité des contextes linguistiques. Le français est la deuxième langue la plus apprise au monde et répond à des mécanismes de distinction sociale ou d’ouverture de nouvelles perspectives. C’est une langue diplomatique mais aussi « non alignée ». Une prise de conscience est à l’œuvre en France et au Québec pour protéger la langue française du recul voire du déclin. Le ton employé par la Francophonie évolue de la promotion à la défense, appuyé par un constat détaillé et documenté. L’auteure défend un activisme assumé et cohérent dans la bataille géopolitique qui se joue aussi sur le champ des cultures et des langues. L’auteure appelle à inventer une politique ambitieuse pour le français, langue de culture et d’éducation. L’Agence universitaire de la Francophonie est le premier réseau universitaire au monde : elle offre des ressources concernant la réflexion prospective et l’évaluation des pratiques grâce à la Francophonie scientifique. Le développement et la coopération internationale incluent la dimension culturelle aux côtés de la dimension politique comme un principe actif du projet francophone. La mobilité universitaire francophone promeut l’employabilité et la professionnalisation tout en encourageant aussi le développement d’une identité francophone. « Alors que la question de la transmission de la connaissance et de la pensée est devenue une donnée fondamentale de notre modernité, la Francophonie, lieu de dialogue et de partage de valeurs universelles, constitue un espace dans lequel la réflexion collective, portée par les points cardinaux du monde francophone, peut s’épanouir » (p. 213). L’Organisation pourrait s’appuyer sur les intellectuels de son espace et les mobiliser sur des sujets sensibles afin de nourrir la qualité de sa pensée et l’originalité de sa réflexion croisée, comme l’auteure l’a déjà fait pendant sa carrière afin de nourrir par la réflexion et la formation les stratégies francophones structurantes. « Il a existé (et il existe manifestement encore) une envie d’associer les intellectuels francophones à l’invention de la Francophonie » (p. 218) malgré la crainte de structures budgétivores ou le risque de dépossession de la décision. L’importance de cette réflexion collective demeure et s’exprime sous d’autres formats pour œuvrer en faveur de la diplomatie scientifique. La Francophonie scientifique peut offrir une production unique de normes et de concepts sur les questions internationales qui fondent l’ordre géopolitique.
Partie 4. Des futurs possibles pour la Francophonie
Le monde est dans une situation d’instabilité caractérisée par des jeux d’acteurs complexes et des conflits armés de plus en plus nombreux. Les institutions internationales de sauvegarde de la paix paraissent inefficaces et parfois contestées au profit d’un multi-alignement de nouveaux acteurs géopolitiques concurrençant l’Occident. L’auteure parle d’un « contexte d’usure généralisée du système actuel et de tentatives de recomposition » (p. 229) dans lequel la Francophonie doit trouver sa place. Dès son origine, elle a su largement répondre à la reconfiguration de l’ordre mondial en investissant des créneaux spécifiques de l’action multilatérale mais elle se heurte à la définition de sa volonté, de sa stratégie et de ses moyens. Le sous-financement, le principe de subsidiarité et l’élargissement hétérogène de la Francophonie sont des obstacles connus. La recherche de consensus sur les valeurs comme sur les actions déterminantes devient complexe et la question politique s’efface parfois devant d’autres dimensions. Son image est écornée sur la scène internationale du fait de son immobilisme face aux grands débats et périls actuels. Les critiques de néo-colonialisme sont réactualisées par les concurrents directs de la Francophonie en Afrique et les relations franco-africaines se redéfinissent autant sous l’impulsion volontariste du président français Emmanuel Macron que sous la contrainte des juntes militaires au pouvoir. « Il s’avère indispensable de dissiper et de surmonter ces pesanteurs, dans le but de préserver quelques espoirs de crédibilité, d’efficacité et de cohérence politique du projet – conditions, à mon sens, de sa survie » (p. 236).
Les atouts de profondeur stratégique de la Francophonie sont pourtant bien existants et son attractivité est paradoxalement plus importante aujourd’hui. La Francophonie doit se positionner sur les différents coups de force au sein de l’espace francophone, quel que soit le contexte, tout en conservant le dialogue au-delà des points de crispations. Elle doit sortir de son confort et aborder clairement ces évolutions en arrêtant des décisions fortes. « Cela passe par un renouvellement du pacte d’adhésion à la Francophonie et aux valeurs qu’elle porte, à travers une démarche propre ainsi que par l’énoncé, sur des bases encore actualisées et pleinement assumées, d’une stratégie globale intégrée redonnant le cap pour les décennies à venir » (p. 239). Elle doit, sans complaisance ou embarras, rappeler et défendre ces valeurs. Son corpus normatif est audacieux, appuyé par une doctrine précise et cohérente qui n’est pas la copie ou l’imposition d’organisation extérieure. Ces textes invitent voire obligent la Francophonie à prendre position et à intervenir quand ces engagements sont menacés : elle dispose à cet effet de mécanismes éprouvés pour encadrer les voies d’action solidaire. Ce corpus est encore trop méconnu : les membres doivent se le réapproprier et même, en connaissance de cause, l’amender au besoin, pour l’appliquer fidèlement. Le dialogue et la prévention ne sont pas suffisants, bien qu’importants : les sanctions et les interventions doivent se poursuivre sans complaisance. La Francophonie doit s’appuyer sur ses domaines d’intervention d’excellence pour assurer une prévention structurelle réussie, proposer de nouvelles contributions dans différents domaines mais sans diminuer le budget de ses actions historiques.
La Francophonie est une organisation de son propre genre, unique et inclassable : ces atouts dans une grande diversité permettent son attractivité. Elle doit toutefois rechercher la décentralisation de l’institution globale et valoriser la complémentarité. Un rééquilibrage de la gouvernance est demandé par les membres afin de permettre la libération et la mobilisation de toutes les compétences disponibles. Le développement des diplomaties sectorielles est un signe d’encouragement, elles permettent de rénover un dispositif dont le volet gouvernemental a montré des limites. Les opérateurs et autres entités liés à la Francophonie sont trop souvent minorés et devraient au contraire monter en puissance afin de rester au plus près des besoins francophones. La société civile, notamment à travers la Conférence des OING, pourrait être incluse au plus tôt des décisions et avoir un espace d’expression dédié. La multiplicité de ses voies potentielles et la complexité de sa réalité ne doit pas cacher le fait que la Francophonie demeure bien plus qu’un objet de recherche. Elle doit s’assumer pour porter à nouveau un projet fort sur la scène internationale, nourrie par ses valeurs communes, tout en restant réaliste et consciente des contraintes conjoncturelles et structurelles qui peuvent parfois la mettre hors-jeu. « Ce tableau incite ainsi à porter un regard nuancé sur la capacité de la Francophonie à constituer une puissance de premier ordre. Il autorise toutefois à nourrir des espoirs raisonnables pour la considérer comme un acteur qui peut compter pour chacun de ses membres et sur la scène internationale » (p. 268). La Francophonie est reconnue au sein des organisations internationales et elle doit maintenant développer le sentiment d’appartenance en son sein. La question de l’intégration politique et économique pourrait se poser pour faire converger des politiques et des lois. Chaque État doit s’engager dans la promotion de la Francophonie en son sein. « La Francophonie n’est jamais autant elle-même qu’en mouvement, lors de périodes de mutations » (p. 276).